Pascal Quignard
« Les ombres errantes »
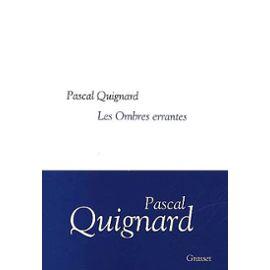
Texte plus beau que ça, - ode-poème inconnue pour moi à ce jour, parlant des livres et de la littérature, et qui entretient une sorte de dialogue avec les dieux - tu meurs. Envie de pleurer, le lisant.
« Il est des façons de dire qui font trembler.
D’autres qui blessent.
Il est des façons de dire qui dans le souvenir blessent encore au-delà de la mort de ceux qui les proféraient.
Ces voix et ces intonations forment ce qu’on peut appeler la « famille ».
Il est des façons de dire qui entêtent le souffle d’une voix morte ou sourde. Mais des voix ou échos qui ne procèdent pas directement de ces morts. Provenant d’un souffle qui n’est pas directement aïeul. Ou qui assiègent la gorge d’une voix secrète, d’une oralité plus dissimulée que la résonance vocale, plus basse que le murmure, qui donne envie de pleurer.
Ce sont les livres.
L’ensemble des livres – cet ensemble exclut tous les volumes dans lesquels l’oralité ou la société n’ont pas été sacrifiés – forme ce qu’on peut appeler la littérature – qui est une famille afamiliale, non directement généalogique, une société asociale ».
Les livres me parlent, c’est très intime ; parfois, je ne comprends pas tout de suite, je laisse porter, je les rêve, je les reconstruits, je les imite ; ils me bercent, me provoquent plus souvent, et je laisse faire. Je les relis, alors je suis pris. Ils doivent me rendre des comptes, je suis exigeant ; mais rien n’y fait parfois, je ne comprends pas, la rime est fausse, le mot dit me maudit, je suis pantois, décontenancé par la surprise de la non-découverte du mot, désorienté par l’émotion.
De même que le pantalon cache ce qu’on ne saurait voir, le mot cache sa signification, hormis les fois où, porté par l’envie de voir ce qui se cache, je me triture l’esprit jusqu’à ce que le mot rende l’âme. La mienne est alors touchée, je suis vaincu, vainqueur. Telle « la sirène échevelée à queue de serpent », je pousse un cri perçant, je sors du lit, et écris.
« Éprouver en pensant ce qui cherche à se dire avant même de connaître, c’est sans doute cela, le mouvement d’écrire. D’une part écrire avec ce mot qui se tient à jamais sur le bout de la langue, de l’autre avec l’ensemble du langage qui fuit sous les doigts. Ce qu’on appelle brûler, à l’aube de découvrir ».
Les mots provoquent ma pensée, ils naissent seuls, sur le bout de la langue, comme le dit Quignard, ils m’absorbent, me devancent, oui, ils sont là naissants et je ne le sais même pas, ils m’emportent. Souvent je comprends que la plume (le clavier) n’est pas assez rapide. Que de mots perdus à cause de ma lenteur technicienne, de ma paresse aussi quand, dans l’aube revenue, je me repose des idées et des mots, à demi-mort de rêves trop présents au matin, endolori de fantasmes qui ne me quittent pas. Que de sens perdu. Que de joies évanouies avant qu’elles n’arrivent.
Ou je lis.
« Sortir de la nuit antérieure toutes les choses. Incendier de perte le perdu, voilà ce qui à proprement parler est lire. (souligné de Quignard) Procurer sa couleur d’onzième heure à tout ce qui s’éteint.
Retrouver l’aube partout, partout, partout, c’est une façon de vivre...
Naître ».
Quand c’est bon, lire me donne cette impression d’« héler la perdue dans l’introuvable ». Et alors je suis « médusé ». Alors seulement, je trouve la beauté et le sens, les sens, l’essence du texte. Puis je comprends : « la lettre qui signale en silence le chant perdu, et derrière le chant perdu, l’antique audition perdue, est la littérature ».
Elle « occupe tout le volume de la tête humaine quand elle invente encore, juste avant qu’elle trouve ses mots. Quand elle pense avant qu’elle remémore dans le temps. Quand elle trouve plus que quand elle sait. Quand elle écrit plus que quand elle reconnaît.
Quand elle jouit plus que quand elle écrit.
Quand elle désire plus que quand elle jouit.
La littérature tient tout entière dans ce prélude silencieux ».
Conclusion de Quignard pour ce chapitre XLIII: « L’humanité doit plus à la lecture qu’aux armes... Quand tout le monde aura cessé de lire, la littérature redeviendra prisée ».
Lire me semble errer à travers des ombres errantes. J’éprouve ce plaisir chaque jour, un petit peu. Et parfois je ne sais plus, ombre errante, où j’en suis avec tout ce fatras de mots qui me bercent, m’illusionnent, me cherchent et souvent ne me trouvent pas. J’ai cette impression alors d’être analphabète – c’est souvent ainsi quand je lis Michon – mais je m’accroche.
Et chaque matin tout recommence. « Le chant du coq, l’aube, les chiens qui aboient, la clarté qui se répand, l’homme qui se lève, la nature, le temps, le rêve, la lucidité, tout est féroce ». (incipit de ce livre)
Et chaque matin, je lis. Ça ne s’arrêtera jamais.
Quignard dit qu’il ne cherche que des pensées qui tremblent. Tout comme je cherche des images, des mots, des idées qui me nourrissent, m’ébranlent et me laissent affaibli, avant que je ne retrouve mes forces, car je sais qu’avant d’être, je fus, et ça je ne le savais pas. Toutes ces idées d’avant que je ne sois sont ma mémoire, immémorielle, immémorable, celle des temps perdus, des temps anciens, celle de l’amibe (née des abîmes désespérées) jusqu’à ce jour.
Mais jusqu’où peut-on aller avec la pensée, celle qui est au devant ? avec ses sentiments, ceux qui ressassent le passé ? avec son âme, celle qui se languit d’être et d’apparaître au grand jour ? Quignard nous dit « qu’il faut haïr ce qui interdit tout accès à l’imprévisible et à l’irréversible ». Bref il ne faut pas avoir peur, ni de sa génitalité, ni de ses envies, ni de ses folies. Tout est accessible à l’envie de connaître et de comprendre, même ce qui ne peut l’être. Rire de sa vie peut être un credo, rire de ses déconvenues peut être bâtir son expérience, rire des autres, de ceux qui le méritent, peut être salutaire. L’esprit humain est tel qu’il n’a - ni bornes, pourquoi faudrait-il en mettre ? - ni morale primaire, sinon une morale primitive qui le protège des envies et attaques d’autrui et de ses malversations et agressions, une sorte d’éthique esthétisante, plastique, que l‘humain a en dedans de lui, - ni de mal en lui car il serait odieux de le penser tel, - ni d’indifférence à ce qui est différent car il serait raciste, - ni de fausse sensibilité car il deviendrait pleurnichard, geignant, - ni absence, il n’est jamais absent, car il serait mort.
« Ne respirez plus ! C’est le mot de toute société à ses citoyens ».
Oui, tout comme cette main terrible qui est intervenue brusquement sur la terre – « Elle a le son vert et neuf d’un dollar qui craque » - ce mot d’ordre est celui qui se cache dans l’enfer de la consommation. « Malheur à celui qui a connu l’invisible et les lettres, les ombres des anciens, le silence ». Et pourtant, on sait bien que la délivrance, le rejet de cet ordre, est possible. Mais nul n’en a cure. Chacun est Boétien. L’aveuglement est tel que la mort guette. Les guerres ne sont que l’apparence d’une mort plus grande, celle des esprits enfermés dans cet ordre, maintenant mondial.
Tanizaki regrette l’ombre ; mais l’ombre fuit, elle a aussi son sens perdu ; elle n’est pas que silence et méditation, elle est aussi l’ombre protectrice de l’ordre qu’elle cache, ou enveloppe, c’est selon ; qu’elle masque. Je peux le voir ainsi. Certes elle permet la solitude, le rejet de l’ordre, une sorte de paix intérieure qui peut l’accompagner, mais elle laisse une lueur insuffisante pour qui veut voir clair, et pas que ce qui est terni, pas que ce qui est intempéries, pas que les déchets cachés. J’aspire à respirer plus à l’aise dans un monde qui serait moins ombragé et plus connu. Quel mot infâme : « connu ». Je tourne en rond quand je m’exprime ainsi. Assoiffé de connaissances, j’en fais aussi des indigestions qui me laissent obsessivement dans un sommeil impossible. Que faire d’autre ? Vomir et vomir : est-ce la seule issue ?
Lire, écrire, et la littérature : sont-ils des mentirs ? Quignard se dit : « Je vais aller y voir. Je vais aller voir ce que j’ignore. Mes lèvres vont trembler. Je vais souffrir. Pourquoi pas ?
Alors oui, pourquoi pas ? Et je continue de lire, d’écrire.
