Antonio Gramsci
« Pourquoi je hais l’indifférence »
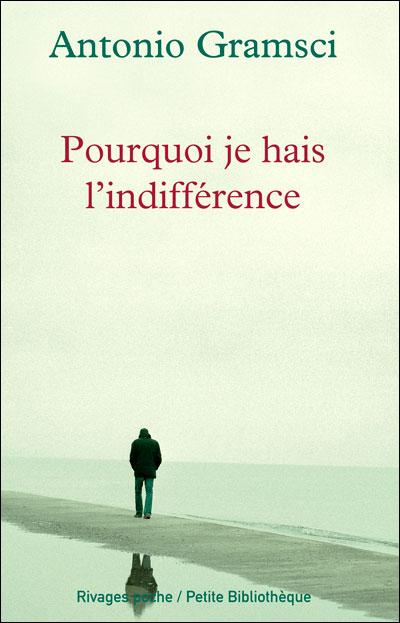
Antonio Gramsci, un jeune intellectuel sarde, victime d’une sinistre malédiction, le 4 juin 1928, du procurateur Isgrò au moment d’envoyer Gramsci en prison : « Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant vingt ans ». En fait il ne fera pas « son » temps, « ce » temps ; à peine sorti de prison, après dix ans, très malade, il meurt dans les jours qui suivent. Gramsci est reconnu comme l’un des plus éminents théoriciens du marxisme : visions puissantes, observations méticuleuses de la vie au travail et en société, conceptions très imaginatives et, de surcroît, une langue « ferme et précise ».
Martin Rueff, dans une longue introduction, nous rappelle :
- la puissance formulaire de certains de ses énoncés, « je suis pessimiste avec l’intelligence et optimiste par la volonté » ; formule d’ailleurs à laquelle il renoncera un peu plus tard quand, dit-il, il ne voit plus d’issue concrète possible à sa lutte politique.
- « l’intuition essentielle que le prolétariat n’a pas besoin des intellectuels pour se rendre compte de son aliénation ».
- le mot de Lasalle que Gramsci inscrit sur la première page du quotidien qu’il dirige, L’Ordine Nuovo : « Dire la vérité, c’est révolutionnaire ».
- sa conception de l’intellectuel. Premièrement, on ne saurait séparer l’homo faber de l’homo sapiens, soutient Gramsci. Il dénonce le rêve de « l’autonomie de l’intellectuel » qu’il voit plutôt comme un artisan de la superstructure hégémonique. Et il voulait que l’intellectuel établisse un « rapport organique » avec la classe révolutionnaire. En fait, il voulait que l’intellectuel se mêle activement à la vie pratique ; ce n’était pas évident à cette époque, ça ne l’est toujours pas davantage aujourd’hui.
- Son article « Je hais les indifférents » qui fait de son engagement politique une responsabilité éthique. Pour Gramsci, l’indifférent est un « dégagé » de la vie ; « or vivre, c’est résister », martèle-t-il.
- Un petit résumé de la doctrine de Gramsci : « Nous avons la sensibilité pour percevoir les souffrances du monde, l’intelligence pour les analyser, et l’imagination pour inventer les solutions politiques qui devront y mettre fin ».
Les indifférents
Gramsci écrit : « Je hais les indifférents. Comme Friedrich Hebbel, je pense que vivre, c’est résister. Il ne peut y avoir seulement des hommes, des étrangers à la cité. Un homme ne peut vivre véritablement sans être un citoyen et sans résister. L’indifférence, c’est l’aboulie, le parasitisme, et la lâcheté, non la vie. C’est pourquoi je hais les indifférents ».
Pour Gramsci, les choses arrivent dans la vie, non pas tant parce que l’on les souhaite, mais parce que trop de gens abdiquent leur volonté : ils laissent faire, sorte de fatalisme ancré en chacun, une sorte d’absentéisme de la vie. Et pourtant, ces choses n’arrivent pas uniquement inopinément, certaines surgissent comme de nulle part, il est vrai, mais certaines ont été longuement muries, pensées, dans le noir de la vie politique, à l’abri des regards, par des gens qui eux, ont des intérêts, et des pouvoirs, et de l’argent. Certaines personnes voient tout cela venir – des intellectuels par exemple – mais ils ne font qu’imaginer des solutions, réfléchies et pensées certes, mais qui restent infécondes parce que non rattachées à la vie réelle. Des solutions qui ne s’ancrent pas dans le réel parce qu’elles sont le produit de « curiosités intellectuelles » auxquelles ne s’attachent aucun sens des responsabilités historiques et civiques.
Comment construire alors des solutions vraies ?
Pour Gramsci, l’activité politique peut le faire, à condition de le faire à partir de faits de la vie : « en politique l’imagination concerne les hommes, leurs douleurs, leurs affects et les nécessités qu’ils rencontrent dans leur vie d’hommes ». Cette imagination doit être illuminée par une force morale : « la sympathie humaine », et s’appuyer sur ce que l’homme politique actif comprendra des drames de la vie de ces gens, et de leurs besoins.
Un beau moment littéraire de ces textes de Gramsci se trouve aux pages 154 et suivantes, et décrit de façon brûlante (il mettrait au feu tous leurs dossiers) le travail des fonctionnaires. Si le texte pouvait parler, je dirais que c’est un grand coup de gueule de Gramsci : contre un travail inutile à 90 % parce que passé à inventer et à faire remplir des formulaires, à rédiger des normes – presque des sacrements - auxquelles il faut se plier et obéir, sinon... « Vous la connaissez l’histoire du timbre » ? écrit Gramsci ; alors il faut lire cette histoire P. 155 et 156.
Gramsci est dur, trop dur pour moi, avec les fonctionnaires. Mais c’est écrit au début du 20ième siècle. Alors ! « Il s’agit d’une mentalité purement anti sociale, d’un égoïsme qui n’est rien d’autre que de la pure animalité qui essaie de se libérer de tout poids, de toute peine de la chaîne sociale qui devrait incomber à tous ». Texte d’une autre époque ? Sans doute. Mais je retiens ce constat, encore vrai aujourd’hui – et si vrai en France à l’heure actuelle ; il faut lire ce pamphlet dénonçant l’absurdité de cet univers professionnel, « Absolument dé-bor-dée ! » de Zoé Shepard, paru en 2010 chez Albin Michel -, ce constat de Gramsci : « Les fonctionnaires ont créé une espèce d’État dans l’État ».
De la nécessité des Etats-Unis d’Europe. Et oui, déjà, au début du siècle dernier, Gramsci avait cette intuition quand il soutenait que « la séparation de la vie économique des différents États était nuisible à leur fusion politique ». Quand je vois aujourd’hui ces remises en question de l’Europe qui trouvent souvent leur origine dans des revendications étroites de territoire, j’entends, ici les pêcheurs français, là les mineurs anglais, là les Finlandais et les Allemands qui ne veulent pas partager leurs richesses durement acquises... et, qu’en même temps, j’entends les leaders européens, ceux-là gagnés à la cause commune, s’époumoner à demander une Europe Politique, alors je me dis que cette Europe-là n’est pas pour demain. Pourquoi faut-il d’abord des liens économiques entre les pays ? C’est simple, Monnet, un père de la formation d’une Europe unie, l’avait bien vu quand il avait d’abord mis au point un compagnonnage économique France-Allemagne avec propriété commune de l’acier et du charbon. Les besoins économiques des pays de l’Europe sont évidents ; - un partage des besoins et des richesses, - la nécessité d’échanges fréquents, - l’évidence de richesses qui se complètent, et même avec de petits pays à petites économies... tout cela est à la base, d’abord du comblement des besoins de tous les pays, et, éventuellement de leur regroupement éventuel sous des formes plus politiques.
Le dernier texte de Gramsci dans ce volume :
« Nous devons nous changer nous-mêmes (lectures) »
Gramsci fait ce constat : il parle avec des amis, des camarades, il voit bien que chacun a changé, que les choses aussi ont changé, et que des besoins nouveaux sont apparus... ils sont inquiets, il est inquiet aussi... Ils voient tous que ces trois années de guerre qui se terminent ont rendu le monde sensible. Il écrit : « Nous sentons le monde, alors qu’auparavant nous nous contentions de le penser ». Avant, remarque-t-il, les gens se satisfaisaient de la vie de tous les jours, innocemment, et, tout à coup, la guerre était là, et chacun s’est retrouvé désarmé face à la tempête. « Nous avions mécanisé la vie, nous nous étions mécanisés nous-mêmes ».
La guerre a eu ceci de bon : « une énorme crise spirituelle a été provoquée, des besoins inouïs sont apparus », en même temps que l’on a compris que cette guerre avait provoqué la plus grande destruction de biens que l’histoire ait jamais connue.
Il est urgent de faire de l’ordre en nous-mêmes, écrit-il. Des livres s’écrivent et sont à la disposition de chacun. Les occasions d’échanger nos points de vue sont innombrables, profitons-en. Ils représentent pour Gramsci « des sollicitations, des occasions de penser, pour creuser en moi, pour retrouver en moi les raisons profondes de mon être, de ma participation à la vie du monde ».
C’est le dernier message de ce livre.
