Parmi les bouquins reçus des éidteurs, celui-ci a attiré mon attention. Je ne suis pas un spécialiste de la période, mais le sujet m'a semblé fort intéressant. Voici l'introduction du livre, qui dit beaucoup mieux que moi l'intérêt du sujet et de son traitement.
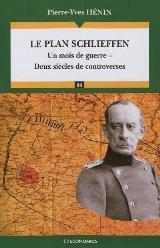
Voir aussi l'entretien donné par l'auteur au blog Guerre et conflit.
Le plan Schlieffen, par P-Y Hénin, Economica, 2012.
O. Kempf
« Imaginons que le commandant en chef des armées alle-mandes s’en soit tenu à la lettre du Plan Schlieffen. Verdun et les forts stratégiques de l’Est auraient été neutralisés…, Reims serait tombé vers le 10 septembre… Quinze jours plus tard, les premiers Ulhans seraient venus patrouiller autour de Bercy, tandis que le corps expéditionnaire britannique aurait rembarqué depuis Le Havre. Alors, le Lorrain Poincaré, inconsolable de sa province sans doute définitivement perdue, aurait cédé la présidence de la République à Joseph Caillaux, adversaire d’une inutile boucherie, et l’on aurait négocié, à Sans-Souci, le château des Hohenzollern, sous les regards du Grand Frédéric et de Bismarck » : c’est en ces mots que Rowley et d’Almeida proposent de refaire l’histoire de 1914. Sans juger ici du réalisme du scénario, remarquons qu’il atteste de la fascination que continue d’exercer, après un siècle de controverses, le plan stratégique dont s’inspirait l’armée alle-mande.
Dans la mémoire collective, la Première Guerre mondiale est restée la guerre des tranchées, ce long affrontement poursuivi jus-qu’à l’épuisement mutuel et l’effondrement de l’adversaire le plus fragile. Ni dans le temps, ni dans l’espace, la Grande Guerre ne s’est pourtant limitée à la guerre des tranchées. Si l’on pense au front est, c’est plutôt l’image d’une guerre de mouvement qui s’impose. Cette image caractérise aussi les premiers comme les derniers mois des opérations à l’Ouest. Bien plus, ces quelques mois de guerre de mouvement ont été décisifs. Décisifs bien sûr ces mois de l’été et de l’automne 1918, où s’est dégagée la déci-sion finale, mais sans doute aussi décisives ont été ces six semaines de l’été 1914 où les armées allemandes se sont ruées de la Meuse à la Marne, pour voir leur élan se briser sur le sursaut d’adversaires mettant un terme à leur retraite – surmontant un commun épuisement. On a bien oublié que 31 jours suffirent aux fantassins de Kluck pour arriver en vue de Paris, moins que les 35 jours qu’il faudrait aux blindés de la Wehrmacht en 1940. Après cela, « la guerre s’enlisera dans une guerre de positions, une guerre d’usure, négation de tout génie militaire et de toute stratégie. La ‘vraie guerre’ aura duré six semaines » écrira le colonel Goutard . Point n’est besoin de s’associer à cette dernière appréciation, provocatrice à l’égard de la mémoire des millions de morts tombés ensuite dans ce qui n’aurait plus été une ‘vraie guerre’, pour re-marquer qu’après la Marne la guerre a changé de nature, et aussi d’enjeu : le moment est passé où l’Allemagne peut espérer s’imposer par les armes. À défaut d’obtenir une paix de compro-mis, l’épreuve redoutée d’une guerre d’usure faisait surgir la pers-pective d’un effondrement de l’empire.
Sur ces six semaines de ‘vraie guerre’ plane le spectre du Plan Schlieffen, le concept stratégique audacieux conduisant à recher-cher la victoire par un débordement aussi ample que rapide de l’aile gauche française en violation de la neutralité belge. « S’il est un plan qui ait jamais mérité de réussir, c’est bien le Plan Schlieffen », devait écrire en 1940 le général Wavell, comman-dant des armées britanniques au Moyen-Orient. On est bien revenu aujourd’hui de cette appréciation, dont Rowley et d’Almeida nous livrent un écho tardif. De nos jours encore, où l’admiration a fait place à une critique souvent sévère, ce plan ne vaut-il pas à son auteur de figurer au premier rang des chefs de guerre qui n’ont jamais livré une bataille – peut-être le plus célèbre, mais aussi l’un des plus contestés d’entre eux ? A. J. P. Taylor n’a-t-il pas pu con-sidérer le Plan Schlieffen comme seule cause directe de la guerre et Gerhard Ritter dénoncer en lui le commencement des malheurs de l’Allemagne et de l’Europe ?
L’enjeu, on le voit, va bien au-delà d’un simple plan de cam-pagne. Si l’on a pu dire que « le Plan Schlieffen a structuré la Première Guerre mondiale » , c’est qu’il a déterminé les condi-tions de déclenchement du conflit et que son échec, avec l’abandon de la perspective d’une victoire rapide des empires cen-traux, conduisait à l’enlisement fatal dans la guerre de tranchées. Fil directeur d’un premier mois de guerre, le Plan Schlieffen est aussi l’aboutissement d’un siècle de réflexion stratégique alle-mande, tendue vers une revanche supplémentaire à l’humiliation d’Iéna, puis vers le besoin de consolider et de parfaire les acquis de Sedan. La défaite de 1918 une fois consommée, c’est alors l’objet d’un nouveau siècle de controverses historiographiques, de construction et de dénonciation de mythes.
Quand éclate la Première Guerre mondiale, le Plan Schlieffen a déjà neuf ans et son auteur est mort au début de l’année précé-dente. C’est en effet au printemps 1905 qu’entre en vigueur un nouveau plan de déploiement des armées allemandes en cas de mobilisation, assorti de directives qui orientent ces armées en vue d’effectuer un vaste mouvement d’enveloppement des défenses françaises par la Belgique et la Hollande. Quittant ses fonctions le 1er janvier 1906, Alfred von Schlieffen rédige alors un mémoire – un Denk-schrift – dans lequel il imagine et discute le déroulement possible d’une campagne menée sur cette base. Comme dans ses grandes lignes le Plan Schlieffen continue à guider la stratégie du Reich en 1914, c’est en général comme un facteur déterminant de cette stratégie qui nous est habituellement présenté. Pourtant, chercher à comprendre le Plan Schlieffen à l’aune des questions qui se posaient en 1914, n’est-ce pas courir le risque de passer à côté de sa spécificité historique ? N’est-ce pas déjà ouvrir la voie aux différents mythes qui ont été attachés à ce « monument de l’histoire militaire » finalement mal connu ? Les circonstances, il est vrai, n’ont guère favorisé l’étude sereine des plans de guerre du Grand État-Major à l’époque de Guillaume II.
Dans les années 1920, c’est dans un climat d’autocensure na-tionale que s’écrit en Allemagne l’histoire de la guerre. Le déve-loppement de la réflexion stratégique y apparaît expurgé des élé-ments qui pourraient étayer la thèse de la responsabilité allemande inscrite dans le traité de Versailles. Instrumentalisée au service d’un véritable déni de la défaite, l’histoire du Plan Schlieffen fait alors une large place au mythe d’une recette infaillible pour la victoire, qui n’a pu échapper au Reich qu’en raison de la défail-lance de quelques-uns. Dans le second après-guerre, c’est une tout autre forme de censure qui va handicaper la recherche. Quand, dans la nuit du 14 avril 1945, 500 bombardiers britanniques dé-versent leur charge de projectiles incendiaires sur Potsdam, les archives de l’armée allemande partent en fumée. Avec elles dispa-raissent la plupart des documents relatifs aux travaux du Grand État-Major. Retrouvé et publié en 1955 par Gerhard Ritter, le « Grand Mémoire » rédigé par Schlieffen à son départ, polarisant à l’excès l’attention des historiens, va devenir à leurs yeux le Plan Schlieffen. Depuis la chute du mur de Berlin et le retour d’archives saisies par l’Armée rouge en 1945, la redécouverte de documents ayant survécu à l’incendie permet de mieux suivre les travaux de l’état-major et l’évolution de ses plans de déploiement. Ainsi peut-on proposer aujourd’hui une vision moins réductrice du plan légué par Schlieffen à son successeur. Produit d’un siècle de maturation de la pensée militaire prusso-allemande, ce concept stratégique se dégage de différentes études et exercices de 1904 avant de se traduire dans les faits, quand Schlieffen décide, à la mi-novembre, de réorienter profondément le dispositif de dé-ploiement applicable à compter du 1er avril 1905. Contrairement à une idée largement répandue, le contexte politique est aussi dé-terminant pour cette évolution que la logique propre d’une ré-flexion stratégique étroite, menée sur la base de considérations purement militaires. Le Plan Schlieffen, contemporain de la pre-mière crise marocaine mais préparé sur la base d’options arrêtées antérieurement, n’a donc pas pu être conçu pour y répondre. Ve-nant après l’Entente Cordiale, la guerre russo-japonaise est le véri-table déclencheur politique de la décision stratégique. Avec l’affaiblissement temporaire de la Russie, il s’agit certes d’éliminer la France, mais pour atteindre indirectement l’Angleterre qui apparaît alors comme l’ennemi principal.
La genèse du Plan Schlieffen s’inscrit dans le siècle qui s’écoule d’Iéna à Algésiras, de l’humiliation militaire de la Prusse à l’échec diplomatique de l’empire de Guillaume II. Elle pose toutes les grandes questions discutées par Clausewitz : guerre et politique, anéantissement de l’adversaire ou recherche de buts limités, planification opérationnelle et hasards du champ de ba-taille. Aux yeux du Grand État-Major prussien, érigé en institution phare du nouvel empire à la suite des victoires de Sadowa et de Sedan, le traité de Francfort de 1871 ne représente qu’une trêve pour une Allemagne menacée d’une guerre sur deux fronts, et il convient d’actualiser en permanence des plans répondant à toutes les éventualités.
Deux personnalités dominent le processus d’élaboration des plans et de préparation de l’empire à la guerre. Entré de son vivant dans l’histoire, Moltke l’Ancien prévoit de se tourner d’abord contre la Russie, quitte à n’y atteindre que des objectifs limités. Schlieffen, dont l’ascendant, progressivement affirmé, s’exerce principalement sur le corps d’état-major, va réorienter les plans allemands vers l’ouest. Puis, prenant conscience de la force des défenses françaises, il va concevoir le projet d’un débordement par la Belgique, d’abord limité dans son ampleur, mais qui fait place en 1905 à un audacieux mouvement d’enveloppement par la rive gauche de la Meuse. Les grands traits de cette évolution sont aujourd’hui bien connus. On sait moins en revanche par quel pro-cessus de réflexion et d’interaction a progressé la démarche de l’état-major. Si le Plan Schlieffen a eu l’importance que lui accorde à juste titre l’histoire militaire, s’il est souvent considéré aujourd’hui comme un pari désespéré ou un cauchemar logistique, il est important de revisiter sa genèse pour en comprendre les ob-jectifs et les modalités – non dans la logique de nos raisonnements rétrospectifs, mais à l’aune de la rationalité et des mentalités de ses auteurs. Pour ce faire, il faudra cerner la personnalité mal connue du comte Schlieffen, et retracer l’enracinement de ses conceptions stratégiques et opérationnelles dans le développement de la pensée militaire allemande depuis Clausewitz. Il faudra aussi resituer la réflexion stratégique menée au Grand État-Major dans les tâtonnements d’une politique étrangère souvent maladroite et les incohérences d’un empire défiant l’Angleterre par une politique navale hasardeuse.
En 1906, à la retraite de Schlieffen, c’est à Moltke le Jeune, le neveu du vainqueur de Sedan, que revient la charge de l’état-major et, en particulier, l’actualisation des plans de déploiement et d’opérations. Là encore, l’examen minutieux ne confirme pas l’image galvaudée d’un successeur dilapidant l’héritage. Continui-té et rupture, ou du moins adaptations, se combinent en effet dans la démarche de Moltke. En même temps, les paradoxes présents chez Schlieffen ne font que s’accentuer. Si on a reproché à Moltke son incapacité à assumer l’audace de Schlieffen, les nouveaux arbitrages effectués par lui viennent parfois amplifier les risques pris par son prédécesseur. Plus conscient que Schlieffen des enjeux attachés à la Triple Alliance, le nouveau chef du Grand État-Major va plus conforter l’allié autrichien dans une politique aventureuse que construire une véritable stratégie de coalition.
Avec l’épreuve de la guerre éclatent au grand jour les forces et les faiblesses d’une armée allemande tendue vers la recherche d’une victoire rapide. Trompeurs, les succès initiaux encouragent Moltke à laisser agir ses commandants d’armée. Mal exploités, ces succès ne permettent pas de conférer un caractère décisif à l’avantage pris sur les armées alliées. Au moment où l’affaiblissement normal de l’offensive aurait nécessité une con-duite vigoureuse de la campagne, Moltke laisse son action se dis-perser, et ses subordonnés réagir sans coordination à la contre-offensive de la Marne.
Lorsqu’avec la défaite vient le temps des comptes à régler, l’insuffisance du commandement fournit l’excuse évidente pour exonérer le Plan Schlieffen de toute responsabilité dans la défaite de la Marne, elle-même grosse de l’effondrement de 1918. C’est dans ce climat que l’histoire du Plan Schlieffen confine au mythe, instrumentalisée au profit d’un déni de défaite. Trente ans plus tard, le renversement des perspectives qui suit l’échec du nazisme s’accompagne d’une nouvelle instrumentalisation. Le Plan Schlieffen y apparaît comme un monument d’un militarisme spé-cifique, rejeté comme un bouc émissaire par une société allemande qui doit exonérer son histoire de toute continuité avec le syndrome hitlérien.
À travers les trois temps de cette étude du Plan Schlieffen, c’est à une compréhension globale du premier conflit mondial que nous invitons le lecteur. Retracer d’abord la genèse de ce concept stratégique, c’est retrouver le processus par lequel l’institution mili-taire allemande pensait et préparait la guerre. Examiner ensuite sa réception par Moltke, mais aussi sa perception par les adversaires potentiels, c’est envisager comment la guerre des plans préfigurait la vraie guerre, une guerre dont un mois suffira pour révéler les illusions des états-majors et acter la faillite des projets allemands. Évoquer enfin l’historiographie du Plan Schlieffen, c’est illustrer la difficulté de rendre compte d’un grand conflit à travers les dé-marches successives d’instrumentalisation de l’histoire et l’imagination d’autres issues possibles à l’affrontement fondateur du XXe siècle.
Comme tous les sujets tenant à la Première Guerre mondiale, le Plan Schlieffen a fait l’objet d’une littérature considérable, qui s’organise en strates très marquées par la date et le lieu de leur rédaction respective, qu’il s’agisse de l’avant-guerre, des après-guerres qui ont suivi 1918 et 1945 ou de la période récente, posté-rieure à la chute du mur de Berlin. Ce foisonnement ne saurait pourtant dissimuler un manque : depuis 80 ans en effet, aucune étude d’ensemble n’a été, en France, consacrée au sujet. Cet ou-vrage voudrait contribuer à combler ce manque paradoxal, car c’est bien le Plan Schlieffen qui donne toute sa portée à la victoire de la Marne. Les documents allemands utilisés pour cette étude ont été consultés et cités d’après leur traduction française ou an-glaise lorsqu’elle était disponible. Pour exploiter les documents originaux ou non traduits, le concours de Martine Hénin, mon épouse, a été essentiel. Qu’elle veuille bien trouver ici mes remer-ciements pour sa collaboration, sans laquelle cet ouvrage n’aurait pu voir le jour.

