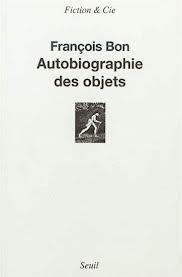 Ce livre n’est pas un livre de poésie au sens où il serait formellement marqué,
estampillé, catalogué « poésie ». Cela est clair. Mais si l’on
reprend le nom de la collection « Fiction & Cie », il est tout
aussi évident que ce livre est tout entier du côté « Cie ». Il n’y a
strictement rien d’inventé, de fictif ou d’imaginaire dans ces pages. On
penserait plutôt au Parti-pris des choses,
pour lequel Ponge s’interrogeait sur la dénomination de « poèmes »,
préférant celle de « textes », plus neutre, mais n’interdisant pas le
rangement dans le tiroir « poèmes en prose ».
Ce livre n’est pas un livre de poésie au sens où il serait formellement marqué,
estampillé, catalogué « poésie ». Cela est clair. Mais si l’on
reprend le nom de la collection « Fiction & Cie », il est tout
aussi évident que ce livre est tout entier du côté « Cie ». Il n’y a
strictement rien d’inventé, de fictif ou d’imaginaire dans ces pages. On
penserait plutôt au Parti-pris des choses,
pour lequel Ponge s’interrogeait sur la dénomination de « poèmes »,
préférant celle de « textes », plus neutre, mais n’interdisant pas le
rangement dans le tiroir « poèmes en prose ».
La différence entre Bon et Ponge tient à ce que le premier ne cherche pas
seulement les mots au bout des choses, il traque ce que les objets lèvent de
mémoire vive, et non leur permanence. Ponge éternise l’objet, Bon le remet dans
l’histoire. D’une certaine façon, dans sa visée, le livre se situe entre Ponge,
Barthes et Proust : objet objectif, objet collectif, objet personnel,
c’est selon. Le facteur commun reste le trajet dans le temps : usage,
perte d’usage, relégation parce que l’objet est remplacé par d’autres, plus
adaptés ou plus performants. On peut prendre pour exemple la machine à
écrire : « J’ai possédé en propre six machines à écrire mécaniques
puis électriques, enfin à sphère et marguerite, avant de disposer d’un premier
ordinateur à traitement de texte, l’Atari 1040 en 1988. » (p44)
Le titre Autobiographie des objets reste
énigmatique. Au début on pourrait penser à une collection de prosopopées,
chaque objet racontant sa vie. Il n’en est rien. Lire « Autobiographie via les
objets » serait plus juste, un peu comme s’ils étaient des clés pour
repasser le film du passé par bribes ou courts-métrages sans ordre ni montage
final. Un bric-à-brac de mémoire, un vide-grenier de tête : il suffit de
lire la table des matières : « nylon, miroir, Telefunken, le litre à
moules, jouets, le mot Dodge, hélices d’avion, boîte aux toupies… » La
plupart de ces objets ramènent sur le devant de la page un environnement
d’enfance auquel ils sont liés : des personnes (famille, amis,
relations..), des lieux (souvent entre Saint-Michel-en-l’Herm et Damvix), des
expériences (la pêche aux grenouilles, les lectures, l’univers sensoriel du
garage d’enfance…)
Jusque-là, on serait dans une postérité proustienne, si l’on remplace la
madeleine ou les pavés inégaux de la cour de Guermantes par un panonceau
Citroën ou une lettreuse Dymo, et si l’on passe de la mémoire involontaire
(l’expérience présente imposant le retour du passé) à un travail de mémoire
volontaire autant qu’aléatoire à partir d’une liste. « Tout au long du
travail, j’ai tenu à la fin du fichier de mon traitement de texte une liste.
Parfois j’y supprimais une ligne : chapitre écrit. D’autres restent
longtemps en suspens : savoir qu’il y a une trappe à ouvrir, mais n’en pas
trouver l’orifice, le déclenchement. Souvent, une prise d’écriture très loin de
ce qui était évoqué dans la liste l’a aspiré à distance, de façon
imprévue. » (p232) Si l’idée de liste fait penser à Pérec plutôt qu’à
Proust, la circulation à l’intérieur de cette liste n’a ici rien de
contraignant, de programmé.
On voit bien que François Bon poursuit son travail de déconstruction du récit
linéaire pour passer à une construction/prolifération rhizomatique du texte. Tumulte était déjà une façon de claquer
la porte au « roman ». Ici, c’est l’autobiographie classique qui vole
en éclats : la chronologie n’est plus régnante et il n’y a pas de volonté
de sérialiser les objets. On passe sans prévenir d’un appareil pour poser les
dalles en ciment à un vieux poste TSF, puis à deux casquettes russes, un litre
à moules… « Je vais sans ordre. Je prends les choses selon qu’elles me
viennent là dans la main. » (p23)
Pourtant, il s’agit bien de dire une vie, de la rassembler :
« Cinquante ans, une paille. » (p8). Simplement, le mode de
rassemblement est minimal : le tas, le vrac d’une mémoire.
Et au fond, cette nouvelle forme d’autobiographie est plus juste, plus vraie.
Notre mémoire n’est ni continue, ni linéaire, ni chronologique. Ici, François
Bon prend acte de ce fonctionnement aussi intermittent qu’hasardeux. On
n’accède à sa propre mémoire que par pans, jamais globalement, sauf s’il est
vrai qu’au moment de mourir on voit repasser en accéléré le film de sa
vie. Ici, pas de cinéma, seulement des
images fixes, des objets perdus le plus souvent au fil des déménagements, ou
parce qu’ils n’ont pas été possédés mais fréquemment vus, à un moment de
l’existence, dans leur étrangeté ou leur magie, même pauvre, comme cette corde
de nylon qui fascine l’enfant mais finira bien vite en corde à linge
utilitaire.
Un autre versant du livre, qui n’explique sans doute pas, mais éclaire
certainement : le goût précoce pour le métal, la mécanique, la technique,
l’expérimentation, l’outil et le travail… On ne joue pas durant les années
d’enfance dans un garage Citroën sans qu’il n’en reste rien. De là sans doute
le plaisir d’une description claire, froide, de tel ou tel objet : « De
même, sur mon bureau, cette rondelle d’acier forgé, épaisseur 12 millimètres,
les traces de fraisage même pas rectifiées, et la tige à section pentagonale de
20, six centimètres de long environ. » (p24) L’objet posé, exact, on
pourra aller ensuite vers la vie du grand père, tourneur avant d’être
garagiste. Un autre versant encore, mais tout aussi précoce, ce sont les
livres, la littérature. Et là, on retrouverait plutôt la figure de la mère,
mais aussi Tout l’Univers, Jacques
Rogy, Le Haut-parleur… À la fin du
livre, François Bon évoque toute sa trajectoire complexe de lecteur.
Nul doute qu’il s’agit donc d’un livre personnel. Mais il s’agit d’une vie, et il faut donner à l’article à
la fois sa portée singulière et indéfinie. Dans le premier texte, François Bon
établit une distinction nette dans son appréhension du temps : « On
n’a pas de nostalgie – l’idée d’une mélancolie
est plus riche, plus subversive même, à la fois quant au présent et au
passé. » (p8) On pourrait dire peut-être que la nostalgie est
individuelle, alors que la mélancolie est historique, collective. Et c’est bien
elle qui domine à la fin du livre : la génération de l’auteur a connu la
fin d’un monde, celui des « objets », et le passage à celui des
produits jetables, consommables, substituables, à rotation si rapide qu’elle ne
laisse qu’une mémoire de traîne, qui ne dépasse pas sans doute celle d’une
génération : « Le temps des objets a fini. »(p232)
Objets perdus redevenus mots mais perdurant par leurs syllabes capables pour un
temps encore d’évoquer des vies qui n’étaient déjà plus dans l’éternel mais
pensaient être encore dans le durable. Mélancolie, là, oui.
[Antoine Emaz]
François Bon , Autobiographie des objets,
Editions du Seuil, collection Fiction & Cie – 245 pages – 18 € – sur le site de l’éditeur

