Défi audacieux relevé par le Centre de recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC), celui de faire débattre un groupe d’universitaires et de spécialistes du monde militaire sur le rôle réel ou supposé des armées dans les "révolutions arabes" de ces deux dernières années, devant un public de civils et de militaires dont des officiers-élèves des écoles de Coëtquidan. Le colloque se déroulait les 26 et 27 septembre au Cercle de la Monnaie à Rennes.
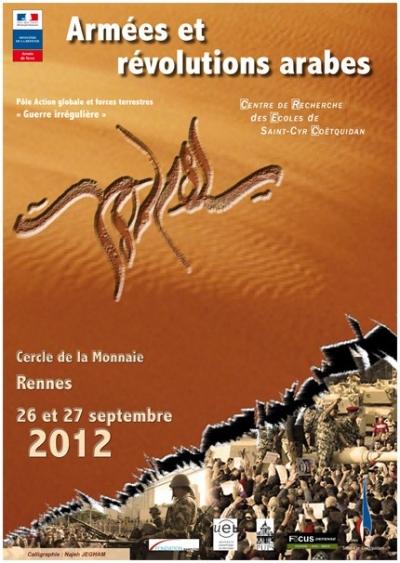
En guise de démarrage, les débats ont commencé par un comparatif intéressant avec l’armée roumaine et la révolution de 1989 qui a mis fin au régime du dictateur Nicolae Ceaucescu. Actrice centrale sans l’avoir voulu, l’armée roumaine s’est retrouvée "révolutionnaire malgré elle", selon le politologue roumain Radu Cucuta, d’autant plus objectif qu’il avait cinq ans à l’époque… Et il est vrai que les militaires roumains ont été perçus par l’opinion publique comme les garants du processus de démocratisation, comme le scandaient les manifestants de l’époque ("Armata è cu noi").
En Tunisie, pays ayant inauguré le "printemps arabe", l’armée tunisienne était traditionnellement à l’écart du jeu politique depuis le président Bourguiba, même si à plusieurs reprises elle a été le recours du régime pour mater des vagues de manifestations, voire des émeutes. La tentative de suicide du jeune vendeur de légumes Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid ayant provoqué une vague d’émeutes à travers le pays, le régime du président Ben Ali a mobilisé les forces de sécurité dans une répression sans précédent. Cette fois, le tournant des événements a été la déclaration faite par le général Rachid Amar au président Ben Ali le 13 janvier, après que la répression policière eut déjà fait 60 morts, que "l’armée ne tirera pas sur le peuple", et son limogeage par le président.
Discussion intéressante, Hédia Khadhar, professeure à la faculté de Tunis, se demandant si cette phrase avait jamais effectivement prononcée devant le président Ben Ali, ou si c’est un propos prêté et qui a fait le tour du net. Idem pour son limogeage, jamais vérifié puisqu’il est resté en fonctions et que c’est le président qui est parti. Une autre universitaire, Florence Gaub du NATO Defense College à Rome, a rappelé que de la même façon l’armée libanaise avait refusé d’intervenir contre la population civile après l’assassinat de Rafic Hariri.
Vraie ou pas à ce moment-là, car elle a été confirmée ensuite, la déclaration de neutralité de l’armée tunisienne, par opposition à la police, a provoqué un mouvement d’émotion populaire, les manifestants allant se réfugier derrière les blindés de l’armée avant de fraterniser avec l’armée et de lui offrir des fleurs, des images très symboliques de militaires avec des slogans comme "tous ensemble pour dire merci à nos militaires", ou "merci à notre armée, vous êtes notre fierté".
Ces images ont fait le tour du monde et le professeur Khadar a insisté sur le rôle d’Internet comme phénomène amplificateur mais également comme élément déclenchant de toute une série de manifestations qui ont accéléré la chute du régime. Le général Amar lui-même a fait l’objet d’une couverture de Jeune Afrique avec en titre : "l’homme qui a dit non".
Internet restera une référence récurrente de ce colloque, notamment lorsqu’a été souligné l’échange entre internautes du "printemps arabe", blogueurs tunisiens et égyptiens échangeant activement des conseils et des expériences.
Cette distanciation du régime a permis à l’armée tunisienne de consolider sa légitimité auprès de l’opinion et d’en être écoutée. A partir du 15 janvier, il y a une concertation entre militaires et manifestants, ces derniers acceptant le couvre-feu imposé par les militaires et étant autorisés à créer des comités d’action pour protéger les maisons et préserver les quartiers des émeutes et du pillage. Le 28 janvier, le général Amar fait un pas de plus en déclarant publiquement, au milieu d’un sit-in de la "caravane de la liberté" : "mes enfants, l’armée nationale se porte garante de la révolution". Une participation émouvante et émue puisque, raconte Hédia Khadhar, la manifestation s’ouvre par un hymne national suivi d’une Fatiha, prononcée d’une même voix par la foule. Un communiqué de l’armée confirmera les limites de son intervention : "l’armée a protégé et protège le peuple et le pays, elle est fidèle à la Constitution, nous ne sortirons pas de ce cadre". C’est donc sans problème que le général Amar finit par demander aux manifestants de lever le siège du palais du premier ministre, "pour permettre au gouvernement de travailler".
Dans les explications possibles sur le rôle positif des militaires dans la crise tunisienne, plusieurs facteurs sont relevés notamment par Mourad Chabbi du CLESID (Lyon 3), dans un intéressant panorama comparatif des armées arabes : l’armée tunisienne est petite comparée aux forces de sécurité lato sensu (25.000 hommes contre 120.000) ; il y a eu une relève des chefs de l’armée après l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à 17 généraux en 2002, relève dont a fait partie le général Ammar ; l’armée tunisienne s’est tenue à l’écart non seulement de la politique, mais du monde des affaires, d’où sa réputation d’intégrité au sein d’un Etat critiqué sur ce plan ; enfin, même s’il n’a pas été évoqué ici, le soutien avéré de l’administration américaine au général Ammar comme facteur d’évolution pacifique d’un régime dépassé a certainement joué aussi.
En Egypte, les militaires n’avaient pas non plus prévu d’être impliqués dans les mouvements sociaux, et ils ont mis plusieurs jours avant de réagir et de prendre position, comme du reste les Frères musulmans, a remarqué le docteur Amin Terzi, spécialiste du Moyen Orient à l’US Marine Corps University de Quantico. L’institution militaire égyptienne était vieillissante, une nouvelle génération d’officiers aspirait à prendre la relève de la "génération d’octobre 1973", ceux qui avaient restauré l’honneur de l’armée égyptienne en se battant fièrement dans la guerre de 1973.
Ces nouveaux officiers voyaient surtout que la police était le bras armé du régime Moubarak, qu’elle se compromettait en participant à une répression massive, et les militaires ont donc fait le choix d’être, comme en Tunisie, les défenseurs du peuple. Ils l’ont fait avec une grande maturité et habileté politique, remarque le Dr Tarzi (à gauche avec les officiers-élèves participant au colloque), sans idée de coup d’Etat, et finalement en soutenant le président élu Mohamed Morsi et en s’accordant avec les Frères musulmans, dans une perspective de stabilisation du processus sur le long terme. Le professeur Amal Hamada, de l’université du Caire, a émis un avis plus mitigé en parlant d’une participation de l’armée égyptienne à la "déconstruction" de l’Etat, mais c’est sans doute oublier que le facteur le plus important de cette déconstruction a été le président Moubarak lui-même, on revient là évidemment à un débat politique.
Pour Florence Gaub, l’armée égyptienne était capable de se distancier du régime à cause du "narratif social : l’armée est l’émanation du peuple". Comme en Tunisie, où l’armée a fondé sa légitimité dans la crise sur sa défense des intérêts de la population civile, et à la différence de l’armée libyenne, perçue de toute façon par la population comme l’armée du régime de Mouammar Kadhafi même si celui-ci la tenait à distance.
En Libye, le contexte était en effet particulier du fait que l’armée régulière avait été progressivement marginalisée par le colonel Kadhafi qui s’en méfiait, préférant s’appuyer sur sa garde prétorienne et sur des milices affidées et des mercenaires étrangers, a expliqué Saïd Haddad, du CREC. Le paradoxe était qu’on assistait ainsi à une militarisation du régime, avec la création des comités de la révolution, de milices populaires et d’organisations paramilitaires pour le contrôle politique interne et la répression, en même temps qu’à une mise à l’écart de l’armée sauf quelques unités privilégiées comme la 32e brigade commandée par Khamis, un des fils de Kadhafi.
Cette frustration des militaires libyens a pu les compromettre dans certains tentatives de coup d’Etat, difficile de le vérifier, mais toujours est-il que le régime en a pris prétexte pour les museler encore plus, ce qui fait qu’à la veille de la crise l’armée régulière était modeste avec 73.000 appelés, était peu équipée, inefficace et démotivée.
Luis Martinez, du CERI, a rappelé qu’entre 1993 et 1998, le colonel Kadhafi avait surtout dû affronter des islamistes armés qui avaient décrété un jihad contre lui, et qu’au lieu de s’appuyer sur son armée il l’avait littéralement désarmée, lui retirant ses munitions désormais stockées dans les casernes de la Garde nationale. Cette même Garde, renforcée par quelque 10.000 mercenaires étrangers, était autorisée à avoir et utiliser armements lourds, blindés, hélicoptères et avions de combat – c’est à la Garde nationale qu’étaient destinés les Rafale que la Libye voulait acheter à la France… Pour ce directeur de recherches du CERI, l’armée libyenne avait été réduite en lambeaux au moment de la crise, à cause de l’embargo international, de l’épuration de ses cadres et du véritable abandon qu’en avait fait le régime.
Pour autant, cette armée n’était pas démissionnaire et s’est honorablement battue face à la double offensive des insurgés et de la coalition internationale. Elle avait beaucoup appris de ses campagnes au Tchad, a rappelé pour sa part Saïd Haddad, par exemple en manœuvrant, en se camouflant dans les villes et en se ménageant face à la supériorité aérienne adverse. Quant aux forces prétoriennes, il est reconnu qu’elles se sont battues jusqu’au bout.
Sur la question du soutien supposé de l’armée égyptienne aux rebelles de Benghazi, au moins par le fait qu’elle laissait passer par la frontière égypto-libyenne les envois d’armes et de munitions venant du Golfe, il n’est pas jugé invraisemblable par les analystes, et pour deux raisons. La première, c’est que l’Egypte compte près d’un million de travailleurs émigrés en Cyrénaïque, où ils travaillent notamment dans le pétrole, et que la perspective d’une Cyrénaïque autonome offrirait plus de complémentarités encore entre cette région et l’Egypte ; la seconde, c’est qu’en adoptant cette attitude, les militaires égyptiens ont noué des relations avec les Frères musulmans libyens, ce qui était une carte potentiellement utile dans leur jeu.
Il est à noter, remarque Saïd Haddad, que l’armée libyenne, évidemment épurée, a été maintenue comme structure étatique et utilisée par le nouveau régime pour fédérer et endiguer les innombrables milices nées de l’insurrection anti Kadhafi, dont le contrôle reste une préoccupation majeure du nouveau régime. Il existe un plan d’intégration des combattants de ces milices qui prévoit d'en réintégrer 50.000, les plus opérationnels, dans les rangs de l’armée régulière, et 200.000 autres dans la société civile. Si je peux me permettre ici une remarque personnelle, a contrario la décision catastrophique de dissoudre l’armée irakienne en 2003 avait jeté dans les rangs de l’opposition armée des dizaines de milliers de militaires révoltés de leur mise à l’écart par les Américains, alimentant ainsi une déstabilisation durable en Irak et fournissant des bataillons de volontaires aux mouvements islamistes armés.
Autres pays : il serait trop long de rapporter ici l’intégralité des présentations, également passionnantes, sur le positionnement des armées dans les autres pays arabes, notamment au Maroc. Quelques mots tout de même sur l’Algérie, dont l’évolution a certainement inspiré les armées des pays voisins, a estimé Luis Martinez. Notamment et a contrario, sur la considération que pour les militaires, le coût de la répression est disproportionné par rapport à l’intérêt pour l’armée de nouer un compromis en changeant de partenaire politique : il a cité un bilan circulant chez les chercheurs sur les pertes en Algérie entraînées par la reprise en mains de la situation à partir de 1992 par l’armée algérienne dont ce n’était pas la mission : 8.000 morts pour les forces de sécurité (toutes catégories confondues), 20.000 morts sur les 40.000 combattants présumés des groupes islamistes armés, mais surtout 150.000 à 200.000 civils, chiffre évidemment jamais confirmé.
L’autre élément de comparaisons utile pour les pays voisins est le renforcement considérable des moyens du ministère de l’intérieur et la professionnalisation des forces de sécurité en Algérie, permettant un transfert de compétences des militaires vers les forces de police et libérant l’armée des accusations d’ingérence politique.
Dans un retour en arrière sur une période charnière de l’Algérie contemporaine, les années 1988-89, Myriam Aït Aoudia (Sc. Po Bordeaux) raconte de façon passionnante qu’après des émeutes violentes en octobre 1988, suivies par une lourde répression, le FLN avait proposé une nouvelle Constitution qui supprimait le parti unique comme référence et écartait l’armée de tout rôle politique. Le 4 mars, la direction de l’armée prolongeait cette évolution constitutionnelle et annonçait, sans qu’on lui ait rien demandé, le retrait des militaires de toutes les instances du FLN, anticipant sur la fin du parti unique.
En réalité, explique Myriam Aït Aoudia dans une analyse très détaillée des profils des dirigeants militaires qui mériterait d’être publiée, cette mutation, hâtée par l’évolution conjoncturelle, était l’aboutissement logique d’une vaste réforme des armées lancée en 1984 par le président Chadli Bendjedid afin de moderniser un outil militaire inefficace et dépassé : création d’un état-major centralisant les compétences opérationnelles dispersées entre régions militaires ; création de quatre commandements de forces (terre, air, mer et défense aérienne) ; création d’un grade de général, mise en place d’un mécanisme permettant de nommer des commandants militaires plus jeunes, formés à l’étranger et ayant eu une carrière de terrain sans responsabilités politiques.
Cette réforme, estime-t-elle, est "oubliée" par les analystes qui considèrent que l’armée algérienne, qui a repris un rôle politique face à l’émergence du FIS, n’avait donc jamais renoncé à être un acteur politique de premier plan – un sujet de débat animé au cours du colloque. En réalité, les militaires ont pris acte en 1984 du renoncement par le FLN au parti unique, avec l’apparition en 1989 de deux nouveaux partis, le RCD berbériste et le Front islamique du salut (FIS). L’armée a donc cessé d’être un instrument au service du FLN ; et si l’armée a joué à nouveau un rôle majeur après la victoire électorale surprise du FIS en décembre 1991, ce n’était pas pour le FLN mais pour l’intérêt collectif du peuple algérien, au moins dans l’esprit des officiers…
Le mérite du CREC est d’avoir ouvert un débat qui n’a évidemment pas été épuisé, non seulement parce que les sujets sont vastes mais parce que toute la matière est encore en mouvement, donc n’appartient pas encore à l’Histoire. Pour des universitaires, une matière mouvante est un risque d’erreur ou de subjectivité dans leurs analyses. Au moins l’étude de cette actualité leur permet-elle d’identifier des clés de compréhension communes en comparant ces différentes crises, ce qui est aussi d'un grand intérêt pour les militaires. Pour Luis Martinez, dans l’analyse des relations entre militaires et politiques à travers les crises du monde arabe, une distinction nette est à faire, que je trouve d’une grande pertinence : d’un côté il y a les pays moins riches, dont l’économie est très dépendante du tourisme et qui offrent par conséquent une grande vulnérabilité aux mouvements d’opinion publique internationale : ces pays sont obligés de mesurer la répression pour éviter les attaques médiatiques et leurs effets collatéraux sur l'économie et le tourisme. Explicitement, il s’agit pour lui de la Tunisie et de l’Egypte. Dans ces pays, une approche plus réaliste a entraîné les armées respectives à ne plus considérer les mouvements islamistes comme "l’ennemi", mais comme une force dont il faut tenir compte et avec lequel il faut pouvoir éventuellement s’entendre. D’où l’évolution des militaires tunisiens envers Al-Nahda et des militaires égyptiens à l’égard des Frères musulmans.
A l’opposé, plus un pays est riche en ressources propres, notamment pétrolières, moins il est sensible aux attaques de presse, intérieures et extérieures, et cela vaut pour l’Algérie comme pour la Libye de Kadhafi, qui ont démonisé les islamistes et n’ont jamais eu de complexe à les réprimer sévèrement. Cela vaut aussi dans une certaine mesure, il ne les a pas nommés, pour les pays du Golfe, occupés à réprimer ensemble les mouvements de contestation à Bahreïn et au Yémen...
Un autre distinguo important, conclut Luis Martinez, est qu’il ne faut pas oublier, quand on considère l’institution militaire et son poids sur le déroulement des crises, le poids écrasant des services secrets, même si par nature leur rôle est difficile à établir.
Le débat a également abordé les armées syrienne et irakienne, mais l’évolution de ces deux pays ne semble pas liée au calendrier du "printemps arabe", en Irak parce que le changement de régime a été imposé par l’intervention anglo-américaine de 2003, et en Syrie parce que la conjoncture actuelle ne permet absolument pas d’avoir du recul pour faire une analyse de l’évolution de l’armée, entre cohésion préservée et risque d’éclatement interne. Suffisamment de problèmes à approfondir pour souhaiter un nouveau colloque du CREC sur les armées dans les crises du monde arabe !
Pierre BAYLE : Pensées sur la planète

