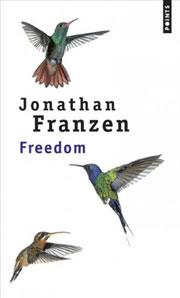 Depuis Les corrections, son troisième roman paru en 2001, Jonathan Franzen a pris place parmi les écrivains américains les plus en vue. Lauréat du National Book Award et nommé pour de nombreux autres prix littéraires, encensé par la critique et plébiscité par les lecteurs, il recueillait ainsi les fruits de sa réflexion sur l’écriture. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à être lisible », aime-t-il à dire maintenant. En effet, comme Freedom, Les corrections est un livre qui ne présente, au moins en apparence, aucune difficulté de lecture. Le style est limpide, les personnages développent leurs singularités au fil du temps qu’il est nécessaire d’y mettre. Seule la structure du récit présente quelques caractéristiques plus complexes, rompant avec la linéarité classique. Mais le cinéma a depuis longtemps habitué les spectateurs, qui sont parfois aussi des lecteurs, à cette gymnastique de l’esprit.En 2010, la couverture du magazine Time présentant Jonathan Franzen comme le « grand romancier américain » a frappé les esprits. D’autant que pas un écrivain n’avait occupé cette place depuis Stephen King, en 2000. Il s’agissait pourtant d’une reconnaissance ambiguë : Franzen lui-même estime que la place de plus en plus réduite accordée à la littérature en couverture de l’hebdomadaire témoigne du déclin culturel des Etats-Unis. D’autant que les choix semblent effectués davantage en fonction du succès public que de la qualité. Avant Stephen King, Scott Turow et Michael Crichton avaient eu les honneurs du Time dans les années nonante. En compagnie, il est vrai, de Toni Morrison et Tom Wolfe. Populaires et exigeants, comme Jonathan Franzen.C’est presque une manie aux Etats-Unis : comme les écrivains rêvent d’écrire « le grand roman américain » qui engloberait toutes les facettes d’un pays complexe, les commentateurs rêvent de désigner, en temps réel, « le grand écrivain américain ». La palme, toute théorique, se disputerait aujourd’hui entre Philip Roth, Don DeLillo, Corman McCarthy, Bret Easton Ellis ou Jonathan Franzen. Le temps réel n’étant pas le meilleur moment pour faire le tri, l’avenir s’en chargera. Comme il a placé dans le Panthéon littéraire de leur époque William Faulkner, Ernest Hemingway, John Dos Passos ou John Updike. Entre autres.Pour en finir avec la manière dont Jonathan Franzen fait face au succès, il est intéressant de relever comment il a réagi devant sa double sélection au club du livre d’Oprah Winfrey. La première fois, en 2001, elle avait retenu Les corrections et invité l’auteur à son émission de télévision, formidable accélérateur des ventes. Mais Jonathan Franzen, se confiant à un journaliste, se demandait si la présence de son roman dans les choix de ce club ne risquait pas de le couper du public masculin. Devant ses réticences, Oprah Winfrey l’enleva de sa liste. Peu rancunière (ou désireuse de faire un joli coup), elle l’a réinvité en 2010 pour Freedom. L’auteur, reçu entretemps par Barack Obama, n’avait cette fois aucun argument à opposer à sa présence sur le plateau. Et, à l’animatrice qui lui disait : « C’est un honneur de vous avoir parmi nous », il répondit simplement : « C’est un honneur d’être ici. »Pour avoir fait une partie de ses études en Allemagne, cet Américain né en 1949 a pu traduire, entre ses deux principaux romans, une pièce de Frank Wedekind, en même temps qu’il écrivait un essai et des mémoires. Auparavant, il avait publié en 1988 La vingt-septième ville et, quatre ans plus tard, Strong motion (non traduit en français), des romans influencés par les recherches formelles de l’époque. Il s’en est en partie détaché ensuite. Et, s’il cite volontiers des écrivains contemporains, au premier rang desquels David Foster Wallace qui était son ami, les noms de Balzac ou de Tolstoï reviennent souvent dans ses propos de la dernière décennie.De la littérature européenne du dix-neuvième siècle, il a gardé l’ampleur et le goût d’approfondir le caractère de ses personnages. La modernité du siècle suivant lui permet en même temps d’écarter toute naïveté de ses livres, et de leur donner la force qu’on connaît.Jonathan Franzen embrasse large dans Freedom. Le titre, déjà, l’autorise à envisager les différentes manières dont chacun use (ou abuse) de sa liberté, comment on l’acquiert ou on la perd, quels chemins elle conduit à prendre selon l’idée que l’on s’en fait. Nous sommes après le 11 septembre 2001, l’administration Bush a embarqué les Etats-Unis dans la lutte contre l’axe du mal, à l’aide de quelques mensonges assénés comme des vérités. Sous les applaudissements d’une partie de la population. Et les ricanements d’une autre.Freedom, bien que son auteur se défende d’y délivrer un message, est un livre politique, au meilleur sens du mot. Dans le contexte d’une union nationale sollicitée pour la défense de la patrie, il introduit d’autres combats, menés par Walter Berglund et par Lalitha, son assistante. Le premier, convaincu depuis ses études universitaires de la nécessité de limiter les naissances pour lutter contre les grandes crises, embrasse la cause écologique et cherche à préserver la paruline, une espèce d’oiseau menacée. Il gagne le soutien d’un grand industriel qui investit dans le projet, non sans quelques arrière-pensées que Walter préfère ne pas voir. Tandis que, dans le même temps, il reproche à son fils de profiter de la guerre d’Irak pour faire fortune précocement. Les ambiguïtés et les contradictions se multiplient à tous les étages.Et aussi dans la vie privée des personnages, car Freedomn’est pas seulement politique. Une partie importante du volume est occupée par l’autobiographie de Patty Berglund, l’épouse de Walter. Elle l’intitule « Des erreurs furent commises ». En effet. Par elle-même, d’abord. Elle ne s’est rapprochée de Walter qu’en raison de son amitié avec Richard, un rocker dont elle était tombée amoureuse. Et avec lequel elle n’en aura, d’une certaine manière, jamais fini. En porte-à-faux par rapport à sa vie, elle a, elle aussi, embarqué sa famille dans des mensonges et dans une forme de guerre. Qui, peut-être, prendra fin un jour.
Depuis Les corrections, son troisième roman paru en 2001, Jonathan Franzen a pris place parmi les écrivains américains les plus en vue. Lauréat du National Book Award et nommé pour de nombreux autres prix littéraires, encensé par la critique et plébiscité par les lecteurs, il recueillait ainsi les fruits de sa réflexion sur l’écriture. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à être lisible », aime-t-il à dire maintenant. En effet, comme Freedom, Les corrections est un livre qui ne présente, au moins en apparence, aucune difficulté de lecture. Le style est limpide, les personnages développent leurs singularités au fil du temps qu’il est nécessaire d’y mettre. Seule la structure du récit présente quelques caractéristiques plus complexes, rompant avec la linéarité classique. Mais le cinéma a depuis longtemps habitué les spectateurs, qui sont parfois aussi des lecteurs, à cette gymnastique de l’esprit.En 2010, la couverture du magazine Time présentant Jonathan Franzen comme le « grand romancier américain » a frappé les esprits. D’autant que pas un écrivain n’avait occupé cette place depuis Stephen King, en 2000. Il s’agissait pourtant d’une reconnaissance ambiguë : Franzen lui-même estime que la place de plus en plus réduite accordée à la littérature en couverture de l’hebdomadaire témoigne du déclin culturel des Etats-Unis. D’autant que les choix semblent effectués davantage en fonction du succès public que de la qualité. Avant Stephen King, Scott Turow et Michael Crichton avaient eu les honneurs du Time dans les années nonante. En compagnie, il est vrai, de Toni Morrison et Tom Wolfe. Populaires et exigeants, comme Jonathan Franzen.C’est presque une manie aux Etats-Unis : comme les écrivains rêvent d’écrire « le grand roman américain » qui engloberait toutes les facettes d’un pays complexe, les commentateurs rêvent de désigner, en temps réel, « le grand écrivain américain ». La palme, toute théorique, se disputerait aujourd’hui entre Philip Roth, Don DeLillo, Corman McCarthy, Bret Easton Ellis ou Jonathan Franzen. Le temps réel n’étant pas le meilleur moment pour faire le tri, l’avenir s’en chargera. Comme il a placé dans le Panthéon littéraire de leur époque William Faulkner, Ernest Hemingway, John Dos Passos ou John Updike. Entre autres.Pour en finir avec la manière dont Jonathan Franzen fait face au succès, il est intéressant de relever comment il a réagi devant sa double sélection au club du livre d’Oprah Winfrey. La première fois, en 2001, elle avait retenu Les corrections et invité l’auteur à son émission de télévision, formidable accélérateur des ventes. Mais Jonathan Franzen, se confiant à un journaliste, se demandait si la présence de son roman dans les choix de ce club ne risquait pas de le couper du public masculin. Devant ses réticences, Oprah Winfrey l’enleva de sa liste. Peu rancunière (ou désireuse de faire un joli coup), elle l’a réinvité en 2010 pour Freedom. L’auteur, reçu entretemps par Barack Obama, n’avait cette fois aucun argument à opposer à sa présence sur le plateau. Et, à l’animatrice qui lui disait : « C’est un honneur de vous avoir parmi nous », il répondit simplement : « C’est un honneur d’être ici. »Pour avoir fait une partie de ses études en Allemagne, cet Américain né en 1949 a pu traduire, entre ses deux principaux romans, une pièce de Frank Wedekind, en même temps qu’il écrivait un essai et des mémoires. Auparavant, il avait publié en 1988 La vingt-septième ville et, quatre ans plus tard, Strong motion (non traduit en français), des romans influencés par les recherches formelles de l’époque. Il s’en est en partie détaché ensuite. Et, s’il cite volontiers des écrivains contemporains, au premier rang desquels David Foster Wallace qui était son ami, les noms de Balzac ou de Tolstoï reviennent souvent dans ses propos de la dernière décennie.De la littérature européenne du dix-neuvième siècle, il a gardé l’ampleur et le goût d’approfondir le caractère de ses personnages. La modernité du siècle suivant lui permet en même temps d’écarter toute naïveté de ses livres, et de leur donner la force qu’on connaît.Jonathan Franzen embrasse large dans Freedom. Le titre, déjà, l’autorise à envisager les différentes manières dont chacun use (ou abuse) de sa liberté, comment on l’acquiert ou on la perd, quels chemins elle conduit à prendre selon l’idée que l’on s’en fait. Nous sommes après le 11 septembre 2001, l’administration Bush a embarqué les Etats-Unis dans la lutte contre l’axe du mal, à l’aide de quelques mensonges assénés comme des vérités. Sous les applaudissements d’une partie de la population. Et les ricanements d’une autre.Freedom, bien que son auteur se défende d’y délivrer un message, est un livre politique, au meilleur sens du mot. Dans le contexte d’une union nationale sollicitée pour la défense de la patrie, il introduit d’autres combats, menés par Walter Berglund et par Lalitha, son assistante. Le premier, convaincu depuis ses études universitaires de la nécessité de limiter les naissances pour lutter contre les grandes crises, embrasse la cause écologique et cherche à préserver la paruline, une espèce d’oiseau menacée. Il gagne le soutien d’un grand industriel qui investit dans le projet, non sans quelques arrière-pensées que Walter préfère ne pas voir. Tandis que, dans le même temps, il reproche à son fils de profiter de la guerre d’Irak pour faire fortune précocement. Les ambiguïtés et les contradictions se multiplient à tous les étages.Et aussi dans la vie privée des personnages, car Freedomn’est pas seulement politique. Une partie importante du volume est occupée par l’autobiographie de Patty Berglund, l’épouse de Walter. Elle l’intitule « Des erreurs furent commises ». En effet. Par elle-même, d’abord. Elle ne s’est rapprochée de Walter qu’en raison de son amitié avec Richard, un rocker dont elle était tombée amoureuse. Et avec lequel elle n’en aura, d’une certaine manière, jamais fini. En porte-à-faux par rapport à sa vie, elle a, elle aussi, embarqué sa famille dans des mensonges et dans une forme de guerre. Qui, peut-être, prendra fin un jour.
Magazine Culture
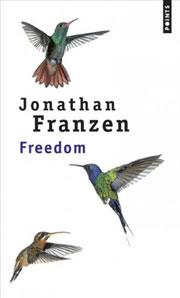 Depuis Les corrections, son troisième roman paru en 2001, Jonathan Franzen a pris place parmi les écrivains américains les plus en vue. Lauréat du National Book Award et nommé pour de nombreux autres prix littéraires, encensé par la critique et plébiscité par les lecteurs, il recueillait ainsi les fruits de sa réflexion sur l’écriture. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à être lisible », aime-t-il à dire maintenant. En effet, comme Freedom, Les corrections est un livre qui ne présente, au moins en apparence, aucune difficulté de lecture. Le style est limpide, les personnages développent leurs singularités au fil du temps qu’il est nécessaire d’y mettre. Seule la structure du récit présente quelques caractéristiques plus complexes, rompant avec la linéarité classique. Mais le cinéma a depuis longtemps habitué les spectateurs, qui sont parfois aussi des lecteurs, à cette gymnastique de l’esprit.En 2010, la couverture du magazine Time présentant Jonathan Franzen comme le « grand romancier américain » a frappé les esprits. D’autant que pas un écrivain n’avait occupé cette place depuis Stephen King, en 2000. Il s’agissait pourtant d’une reconnaissance ambiguë : Franzen lui-même estime que la place de plus en plus réduite accordée à la littérature en couverture de l’hebdomadaire témoigne du déclin culturel des Etats-Unis. D’autant que les choix semblent effectués davantage en fonction du succès public que de la qualité. Avant Stephen King, Scott Turow et Michael Crichton avaient eu les honneurs du Time dans les années nonante. En compagnie, il est vrai, de Toni Morrison et Tom Wolfe. Populaires et exigeants, comme Jonathan Franzen.C’est presque une manie aux Etats-Unis : comme les écrivains rêvent d’écrire « le grand roman américain » qui engloberait toutes les facettes d’un pays complexe, les commentateurs rêvent de désigner, en temps réel, « le grand écrivain américain ». La palme, toute théorique, se disputerait aujourd’hui entre Philip Roth, Don DeLillo, Corman McCarthy, Bret Easton Ellis ou Jonathan Franzen. Le temps réel n’étant pas le meilleur moment pour faire le tri, l’avenir s’en chargera. Comme il a placé dans le Panthéon littéraire de leur époque William Faulkner, Ernest Hemingway, John Dos Passos ou John Updike. Entre autres.Pour en finir avec la manière dont Jonathan Franzen fait face au succès, il est intéressant de relever comment il a réagi devant sa double sélection au club du livre d’Oprah Winfrey. La première fois, en 2001, elle avait retenu Les corrections et invité l’auteur à son émission de télévision, formidable accélérateur des ventes. Mais Jonathan Franzen, se confiant à un journaliste, se demandait si la présence de son roman dans les choix de ce club ne risquait pas de le couper du public masculin. Devant ses réticences, Oprah Winfrey l’enleva de sa liste. Peu rancunière (ou désireuse de faire un joli coup), elle l’a réinvité en 2010 pour Freedom. L’auteur, reçu entretemps par Barack Obama, n’avait cette fois aucun argument à opposer à sa présence sur le plateau. Et, à l’animatrice qui lui disait : « C’est un honneur de vous avoir parmi nous », il répondit simplement : « C’est un honneur d’être ici. »Pour avoir fait une partie de ses études en Allemagne, cet Américain né en 1949 a pu traduire, entre ses deux principaux romans, une pièce de Frank Wedekind, en même temps qu’il écrivait un essai et des mémoires. Auparavant, il avait publié en 1988 La vingt-septième ville et, quatre ans plus tard, Strong motion (non traduit en français), des romans influencés par les recherches formelles de l’époque. Il s’en est en partie détaché ensuite. Et, s’il cite volontiers des écrivains contemporains, au premier rang desquels David Foster Wallace qui était son ami, les noms de Balzac ou de Tolstoï reviennent souvent dans ses propos de la dernière décennie.De la littérature européenne du dix-neuvième siècle, il a gardé l’ampleur et le goût d’approfondir le caractère de ses personnages. La modernité du siècle suivant lui permet en même temps d’écarter toute naïveté de ses livres, et de leur donner la force qu’on connaît.Jonathan Franzen embrasse large dans Freedom. Le titre, déjà, l’autorise à envisager les différentes manières dont chacun use (ou abuse) de sa liberté, comment on l’acquiert ou on la perd, quels chemins elle conduit à prendre selon l’idée que l’on s’en fait. Nous sommes après le 11 septembre 2001, l’administration Bush a embarqué les Etats-Unis dans la lutte contre l’axe du mal, à l’aide de quelques mensonges assénés comme des vérités. Sous les applaudissements d’une partie de la population. Et les ricanements d’une autre.Freedom, bien que son auteur se défende d’y délivrer un message, est un livre politique, au meilleur sens du mot. Dans le contexte d’une union nationale sollicitée pour la défense de la patrie, il introduit d’autres combats, menés par Walter Berglund et par Lalitha, son assistante. Le premier, convaincu depuis ses études universitaires de la nécessité de limiter les naissances pour lutter contre les grandes crises, embrasse la cause écologique et cherche à préserver la paruline, une espèce d’oiseau menacée. Il gagne le soutien d’un grand industriel qui investit dans le projet, non sans quelques arrière-pensées que Walter préfère ne pas voir. Tandis que, dans le même temps, il reproche à son fils de profiter de la guerre d’Irak pour faire fortune précocement. Les ambiguïtés et les contradictions se multiplient à tous les étages.Et aussi dans la vie privée des personnages, car Freedomn’est pas seulement politique. Une partie importante du volume est occupée par l’autobiographie de Patty Berglund, l’épouse de Walter. Elle l’intitule « Des erreurs furent commises ». En effet. Par elle-même, d’abord. Elle ne s’est rapprochée de Walter qu’en raison de son amitié avec Richard, un rocker dont elle était tombée amoureuse. Et avec lequel elle n’en aura, d’une certaine manière, jamais fini. En porte-à-faux par rapport à sa vie, elle a, elle aussi, embarqué sa famille dans des mensonges et dans une forme de guerre. Qui, peut-être, prendra fin un jour.
Depuis Les corrections, son troisième roman paru en 2001, Jonathan Franzen a pris place parmi les écrivains américains les plus en vue. Lauréat du National Book Award et nommé pour de nombreux autres prix littéraires, encensé par la critique et plébiscité par les lecteurs, il recueillait ainsi les fruits de sa réflexion sur l’écriture. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à être lisible », aime-t-il à dire maintenant. En effet, comme Freedom, Les corrections est un livre qui ne présente, au moins en apparence, aucune difficulté de lecture. Le style est limpide, les personnages développent leurs singularités au fil du temps qu’il est nécessaire d’y mettre. Seule la structure du récit présente quelques caractéristiques plus complexes, rompant avec la linéarité classique. Mais le cinéma a depuis longtemps habitué les spectateurs, qui sont parfois aussi des lecteurs, à cette gymnastique de l’esprit.En 2010, la couverture du magazine Time présentant Jonathan Franzen comme le « grand romancier américain » a frappé les esprits. D’autant que pas un écrivain n’avait occupé cette place depuis Stephen King, en 2000. Il s’agissait pourtant d’une reconnaissance ambiguë : Franzen lui-même estime que la place de plus en plus réduite accordée à la littérature en couverture de l’hebdomadaire témoigne du déclin culturel des Etats-Unis. D’autant que les choix semblent effectués davantage en fonction du succès public que de la qualité. Avant Stephen King, Scott Turow et Michael Crichton avaient eu les honneurs du Time dans les années nonante. En compagnie, il est vrai, de Toni Morrison et Tom Wolfe. Populaires et exigeants, comme Jonathan Franzen.C’est presque une manie aux Etats-Unis : comme les écrivains rêvent d’écrire « le grand roman américain » qui engloberait toutes les facettes d’un pays complexe, les commentateurs rêvent de désigner, en temps réel, « le grand écrivain américain ». La palme, toute théorique, se disputerait aujourd’hui entre Philip Roth, Don DeLillo, Corman McCarthy, Bret Easton Ellis ou Jonathan Franzen. Le temps réel n’étant pas le meilleur moment pour faire le tri, l’avenir s’en chargera. Comme il a placé dans le Panthéon littéraire de leur époque William Faulkner, Ernest Hemingway, John Dos Passos ou John Updike. Entre autres.Pour en finir avec la manière dont Jonathan Franzen fait face au succès, il est intéressant de relever comment il a réagi devant sa double sélection au club du livre d’Oprah Winfrey. La première fois, en 2001, elle avait retenu Les corrections et invité l’auteur à son émission de télévision, formidable accélérateur des ventes. Mais Jonathan Franzen, se confiant à un journaliste, se demandait si la présence de son roman dans les choix de ce club ne risquait pas de le couper du public masculin. Devant ses réticences, Oprah Winfrey l’enleva de sa liste. Peu rancunière (ou désireuse de faire un joli coup), elle l’a réinvité en 2010 pour Freedom. L’auteur, reçu entretemps par Barack Obama, n’avait cette fois aucun argument à opposer à sa présence sur le plateau. Et, à l’animatrice qui lui disait : « C’est un honneur de vous avoir parmi nous », il répondit simplement : « C’est un honneur d’être ici. »Pour avoir fait une partie de ses études en Allemagne, cet Américain né en 1949 a pu traduire, entre ses deux principaux romans, une pièce de Frank Wedekind, en même temps qu’il écrivait un essai et des mémoires. Auparavant, il avait publié en 1988 La vingt-septième ville et, quatre ans plus tard, Strong motion (non traduit en français), des romans influencés par les recherches formelles de l’époque. Il s’en est en partie détaché ensuite. Et, s’il cite volontiers des écrivains contemporains, au premier rang desquels David Foster Wallace qui était son ami, les noms de Balzac ou de Tolstoï reviennent souvent dans ses propos de la dernière décennie.De la littérature européenne du dix-neuvième siècle, il a gardé l’ampleur et le goût d’approfondir le caractère de ses personnages. La modernité du siècle suivant lui permet en même temps d’écarter toute naïveté de ses livres, et de leur donner la force qu’on connaît.Jonathan Franzen embrasse large dans Freedom. Le titre, déjà, l’autorise à envisager les différentes manières dont chacun use (ou abuse) de sa liberté, comment on l’acquiert ou on la perd, quels chemins elle conduit à prendre selon l’idée que l’on s’en fait. Nous sommes après le 11 septembre 2001, l’administration Bush a embarqué les Etats-Unis dans la lutte contre l’axe du mal, à l’aide de quelques mensonges assénés comme des vérités. Sous les applaudissements d’une partie de la population. Et les ricanements d’une autre.Freedom, bien que son auteur se défende d’y délivrer un message, est un livre politique, au meilleur sens du mot. Dans le contexte d’une union nationale sollicitée pour la défense de la patrie, il introduit d’autres combats, menés par Walter Berglund et par Lalitha, son assistante. Le premier, convaincu depuis ses études universitaires de la nécessité de limiter les naissances pour lutter contre les grandes crises, embrasse la cause écologique et cherche à préserver la paruline, une espèce d’oiseau menacée. Il gagne le soutien d’un grand industriel qui investit dans le projet, non sans quelques arrière-pensées que Walter préfère ne pas voir. Tandis que, dans le même temps, il reproche à son fils de profiter de la guerre d’Irak pour faire fortune précocement. Les ambiguïtés et les contradictions se multiplient à tous les étages.Et aussi dans la vie privée des personnages, car Freedomn’est pas seulement politique. Une partie importante du volume est occupée par l’autobiographie de Patty Berglund, l’épouse de Walter. Elle l’intitule « Des erreurs furent commises ». En effet. Par elle-même, d’abord. Elle ne s’est rapprochée de Walter qu’en raison de son amitié avec Richard, un rocker dont elle était tombée amoureuse. Et avec lequel elle n’en aura, d’une certaine manière, jamais fini. En porte-à-faux par rapport à sa vie, elle a, elle aussi, embarqué sa famille dans des mensonges et dans une forme de guerre. Qui, peut-être, prendra fin un jour.
