Dans les grandes mythologiques politiques de nos temps, Adam Smith occupe une place centrale sur l’Olympe. Pour le meilleur ou pour le pire, il est, tant pour les rouges que les milieux d’affaires, l’avocat déterminé du laissez-faire et du capitalisme. Les uns comme les autres ont semblablement caricaturé sa pensée.
Par Acrithène.
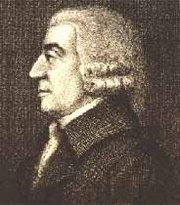 Dans les grandes mythologiques politiques de nos temps, Adam Smith occupe une place centrale sur l’Olympe. Pour le meilleur ou pour le pire, il est, tant pour les rouges que les milieux d’affaires, l’avocat déterminé du laissez-faire et du capitalisme. Les uns comme les autres ont semblablement caricaturé sa pensée. Certains pour appuyer leurs intérêts marchands de la caution morale d’un penseur sacralisé, d’autres pour décrédibiliser un libéralisme loufoque auprès des modestes et de ceux d’entre nous dont la naïve générosité porte le cœur vers le socialisme.
Dans les grandes mythologiques politiques de nos temps, Adam Smith occupe une place centrale sur l’Olympe. Pour le meilleur ou pour le pire, il est, tant pour les rouges que les milieux d’affaires, l’avocat déterminé du laissez-faire et du capitalisme. Les uns comme les autres ont semblablement caricaturé sa pensée. Certains pour appuyer leurs intérêts marchands de la caution morale d’un penseur sacralisé, d’autres pour décrédibiliser un libéralisme loufoque auprès des modestes et de ceux d’entre nous dont la naïve générosité porte le cœur vers le socialisme.
Mais si l’on lit réellement la Richesse des Nations (1776) sans se cantonner aux quelques lignes ayant reçu des manuels une dimension canonique, la mythologie de la « main-invisible » s’écroule. Elle laisse place à un penseur nuancé et progressiste, à un mépris immense pour les rentiers, à un encouragement méfiant aux milieux d’affaires, et au souci du sort des plus modestes.
L’égoïsme n’est pas le mécanisme fondamental de la société
Mais l’homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c’est en vain qu’il l’attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir, s’il s’adresse à leur intérêt personnel et s’il les persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu’il souhaite d’eux. […] Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme; et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage.
RdN, L. I., ch. 11
Voici un premier extrait de la Richesse des Nations auquel syndicalistes et capitalistes ont donné le statut de canon libéral. Les caricaturistes y ont trouvé leurs lignes favorites pour synthétiser la pensée d’Adam Smith : l’égoïsme est le mécanisme fondamental de fonctionnement de la société.
Cette thèse précède Adam Smith vu qu’elle fût développée un siècle plus tôt par le penseur de l’absolutisme Thomas Hobbes, promoteur de la célèbre maxime : l’ « homme est un loup pour l’homme », et selon laquelle l’égoïsme est à la société des hommes ce que l’atome est au monde physique.
Or on ne pourrait attendre d’un libéral qu’il soit disciple de l’absolutisme. Aussi Adam Smith avait-il pris soin de contester la place centrale de l’égoïsme dans le cœur des hommes. Sa première œuvre majeure, La Théorie des Sentiments Moraux (1759), commence ainsi :
Aussi égoïste que l’homme puisse être supposé, il y a évidemment certains principes dans sa nature qui le conduisent à s’intéresser à la fortune des autres et qui lui rendent nécessaire leur bonheur, quoiqu’il n’en retire rien d’autre que le plaisir de les voir heureux.
TSM, P.I, s.1, ch.1
Puis, elle expose explicitement la doctrine de l’égoïsme de Thomas Hobbes et de ses héritiers :
Selon M. Hobbes, et nombre de ses partisans, l’homme est conduit à chercher refuge dans la société, non par l’amour naturel qu’il éprouverait pour ses semblables, mais parce que sans l’assistance des autres, il serait incapable de subsister dans le bien-être et la sûreté. La société, selon cette explication, lui devient nécessaire, et tout ce qui tend à l’intérêt et à la prospérité de la société, il le considère comme tendant indirectement à son propre intérêt. […] La vertu est le grand soutien de la société humaine, et le vice son grand ennemi. La première est donc agréable à chaque homme, le second désagréable ; dans la première il entrevoit la prospérité, et dans le second, la ruine et le désordre de ce qui est si nécessaire au confort et à la sécurité de SON existence.
TSM, P.VII, s.3, ch.1
Mais Adam Smith rejette cette perspective dans laquelle les vertus dériveraient elles-mêmes de l’égoïsme. Il refuse par exemple que la sympathie soit réduite à une projection nombriliste des malheurs des autres sur notre propre égocentrisme.
Quand je vous exprime mes condoléances pour la perte de votre fils unique, pour faire mienne votre peine, je ne considère pas ce que moi, une personne de tel caractère ayant telle profession, pourrait souffrir si j’avais un fils et qu’il ait, par infortune, disparu. Mais je considère ce que je souffrirais si j’étais réellement vous, et je ne change pas seulement de circonstances mais aussi de personne et de caractère. Ma peine se réfère donc entièrement à votre point de vue et pas du tout au mien. Elle n’est donc pas égoïste. […] Un homme peut sympathiser avec une femme qui est en travail d’enfant bien qu’il soit impossible qu’il puisse se concevoir lui-même comme souffrant de ses douleurs dans sa propre personne et son caractère. Pourtant, cette explication globale de la nature humaine qui déduit tous les sentiments et toutes les affections à partir de l’amour de soi et qui a tant fait de bruit dans le monde, mais qui, pour autant que je sache, n’a jamais été complètement et clairement justifiée, cette explication, dis-je, me paraît naître d’une incompréhension du système de la sympathie.
TSM, P.VII, s.3, ch.1
La Théorie des Sentiments Moraux atteste donc que loin d’être le penseur égoïste qu’on décrit trop souvent, Adam Smith était au contraire parmi les intellectuels de son temps qui s’opposèrent à la toute-puissance explicative de ce penchant humain.

Des marchands conspirateurs, et des propriétaires fonciers imbéciles
Une autre manipulation de l’histoire a fait d’Adam Smith le défenseur aveuglé du « Grand Capital ». Pourtant, en bon libéral, Smith avait compris que les pouvoirs de l’Etat étaient généralement détournés de l’intérêt général au profit de quelques intérêts particuliers. Un accaparement d’autant plus grand selon lui que la misère matérielle et intellectuelle des modestes provoquait l’indifférence des gouvernants. Ces derniers préférant soutenir leur pouvoir de l’influence de deux autres classes sociales : les marchands et les propriétaires terriens.
Estimant les débouchés agricoles intrinsèquement liés au bien-être général, Adam Smith craignait moins les intérêts égoïstes des propriétaires que la bêtise attendue de ces héritiers gagnant leur vie à ne rien faire.
Quand la nation délibère sur quelque règlement de commerce ou d’administration, les propriétaires des terres ne la pourront jamais égarer, même en n’écoutant que la voix de l’intérêt particulier de leur classe, au moins si on leur suppose les plus simples connaissances sur ce qui constitue cet intérêt. A la vérité, il n’est que trop ordinaire qu’ils manquent même de ces simples connaissances. Des trois classes, c’est la seule à laquelle son revenu ne coûte ni travail ni souci, mais à laquelle il vient, pour ainsi dire, de lui-même, et sans qu’elle y apporte aucun dessein ni plan quelconque. Cette insouciance, qui est l’effet naturel d’une situation ‘aussi tranquille et aussi commode, ne laisse que trop souvent les gens de cette classe, non-seulement dans l’ignorance des conséquences que peut avoir un règlement général, mais, les rend même incapables de cette application d’esprit qui est nécessaire pour comprendre et pour prévoir ses conséquences.
RdN, L.I, Ch.11
Bien qu’il respecte davantage les entrepreneurs, dont le métier requiert talent, dynamisme et réflexion, Smith craint cependant que leur influence ne favorise des industries particulières au détriment de l’intérêt général. Une influence d’autant plus dangereuse que les marchands peuvent berner les propriétaires benêts.
Comme dans tout le cours de leur vie ils [les marchands] sont occupés de projets et de spéculations, ils ont en général plus de subtilité dans l’entendement que la majeure partie des propriétaires de la campagne. Cependant, comme leur intelligence s’exerce ordinairement plutôt sur ce qui concerne l’intérêt de la branche particulière d’affaires dont ils se mêlent, que sur ce qui touche le bien général de la société, leur avis, en le supposant donné de la meilleure foi du monde (ce qui n’est pas toujours arrivé), sera beaucoup plus sujet à l’influence du premier de ces deux intérêts, qu’à celle de l’autre. Leur supériorité sur le propriétaire de la campagne ne consiste pas tant dans une plus parfaite connaissance de l’intérêt général que dans une connaissance de leurs propres intérêts, plus exacte que celui-ci n’en a des siens. C’est avec cette connaissance supérieure de leurs propres intérêts qu’ils ont souvent surpris sa générosité, et qu’ils l’ont induit à abandonner à la fois la défense de son propre intérêt et celle de l’intérêt public, en persuadant à sa trop crédule honnêteté que c’était leur intérêt, et non le sien, qui était le bien général.
RdN, L.I, Ch.11
Les capitalistes coalisés pour faire baisser les salaires
Au-delà de leur ingérence dans les affaires publiques, Adam Smith s’inquiète de la propension des marchands à chercher à contourner les règles du marché et du jeu de la concurrence. Il n’est donc en rien le penseur naïf qui croit à l’harmonie spontanée et miraculeuse. En particulier, il accuse les employeurs de se coaliser pour manipuler les salaires des travailleurs. Le libéralisme de Smith ne consiste donc pas dans le laisser-fairisme sans nuance, mais de la défense d’une concurrence non faussée.
Non seulement Smith se préoccupe-t-il du déséquilibre naturel entre travailleurs et employeurs, mais en plus reproche-t-il à l’Etat d’intervenir hypocritement en faveur des seconds en interdisant les syndicats tout en feignant d’ignorer les ententes entre employeurs. Nous sommes un siècle avant la légalisation des syndicats…
Je vous ai laissé le passage suivant in extenso tant il est surprenant et décalé au regard des idées couramment attribuées à Adam Smith.
Partout on entend, par salaires du travail, ce qu’ils sont communément quand l’ouvrier et le propriétaire du capital qui lui donne de l’emploi sont deux personnes distinctes.
C’est par la convention qui se fait habituellement entre ces deux personnes, dont l’intérêt n’est nullement le même, que se détermine le taux commun des salaires. Les ouvriers désirent gagner le plus possible; les maîtres, donner le moins qu’ils peuvent; les premiers sont disposés à se concerter pour élever les salaires, les seconds pour les abaisser.
Il n’est pas difficile de prévoir lequel des deux partis, dans toutes les circonstances ordinaires, doit avoir l’avantage dans le débat, et imposer forcément à l’autre toutes ses conditions. Les maîtres étant en moindre nombre, peuvent se concerter plus aisément; et de plus, la loi les autorise à se concerter entre eux, ou au moins ne le leur interdit pas, tandis qu’elle l’interdit aux ouvriers. Nous n’avons point d’actes du parlement contre les ligues qui tendent à abaisser le prix du travail; mais nous en avons beaucoup contre celles qui tendent à le faire hausser. Dans toutes ces luttes, les maîtres sont en état de tenir ferme plus longtemps. Un propriétaire, un fermier, un maître fabricant ou marchand, pourraient en général, sans occuper un seul ouvrier, vivre un an ou deux sur les fonds qu’ils ont déjà amassés. Beaucoup d’ouvriers ne pourraient pas subsister sans travail une semaine, très-peu un mois, et à peine un seul une année entière. A la longue, il se peut que le maître ait autant besoin de l’ouvrier, que celui-ci a besoin du maître; mais le besoin du premier n’est pas si pressant.
On n’entend guère parler, dit-on, de Coalitions entre les maîtres, et tous les jours on parle de celles des ouvriers. Mais il faudrait ne connaître ni le monde, ni la matière dont il s’agit, pour s’imaginer que les maîtres se liguent rarement entre eux. Les maîtres sont en tout temps et partout dans une sorte de ligue tacite, mais constante et uniforme, pour ne pas élever les salaires au-dessus du taux actuel. Violer cette règle est partout une action de faux frère, et un sujet de reproche pour un maître parmi ses voisins et ses pareils. A la vérité, nous n’entendons jamais parler de cette ligue, parce qu’elle est l’état habituel, et on peut dire l’état naturel de la chose, et que personne n’y fait attention. Quelquefois les maîtres font entre eux des complots particuliers pour faire baisser au-dessous du taux habituel les salaires du travail. Ces complots sont toujours conduits dans le plus grand silence et dans le plus grand secret jusqu’au moment de l’exécution; et quand les ouvriers cèdent comme ils font quelquefois, sans résistance, quoiqu’ils sentent bien le coup et le sentent fort durement, personne n’en entend parler. Souvent cependant les ouvriers opposent à ces coalitions particulières une ligue défensive; quelquefois aussi, sans aucune provocation de cette espèce, ils se coalisent de leur propre mouvement, pour élever le prix de leur travail. Leurs prétextes ordinaires sont tantôt le haut prix des denrées, tantôt le gros profit que font les maîtres sur leur travail. Mais que leurs ligues soient offensives ou défensives, elles sont toujours accompagnées d’une grande rumeur. Dans le dessein d’amener l’affaire à une prompte décision, ils ont toujours recours aux clameurs les plus emportées, et quelquefois ils se portent à la violence et aux derniers excès. Ils sont désespérés, et agissent avec l’extravagance et la fureur de gens au désespoir, réduits à l’alternative de mourir de faim ou d’arracher à leurs maîtres, par la terreur, la plus prompte condescendance à leurs demandes. Dans ces occasions, les maîtres ne crient pas moins haut de leur côté; ils ne cessent de réclamer de toutes leurs forces l’autorité des magistrats civils, et l’exécution la plus rigoureuse de ces lois si sévères portées contre les ligues des ouvriers, domestiques et journaliers. En conséquence, il est rare que les ouvriers ne tirent aucun fruit de ces tentatives violentes et tumultueuses, qui, tant par l’intervention du magistrat civil que par la constance mieux soutenue des maîtres et la nécessité où sont la plupart des ouvriers de céder pour avoir leur subsistance du moment, n’aboutissent en général à rien autre chose qu’au châtiment ou à la ruine des chefs de l’émeute.
RdN, L.I, Ch.8
L’Etat doit se préoccuper de l’éducation des enfants pauvres
Dans tous les manuels que j’ai pu avoir sous les mains, l’Etat d’Adam Smith se limite aux fonctions régaliennes de l’Etat (police, justice, défense) et à l’édifice des ponts, routes et autres grandes infrastructures.
Or Smith est beaucoup plus large que cela et reste relativement vague en indiquant que les fonctions de l’Etat et leur étendue dépendent entre autre du degré de développement.
Le troisième et dernier des devoirs du souverain ou de la république est celui d’élever et d’entretenir ces ouvrages et ces établissements publics dont une grande société retire d’immenses avantages, mais qui sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris ou entretenus par un ou par quelques particuliers, attendu que, pour ceux-ci, le profit ne saurait jamais leur en rembourser la dépense. Ce devoir exige aussi, pour le remplir, des dépenses dont l’étendue varie selon, les divers degrés d’avancement de la société.
RdN, L.V, Ch.1
En particulier, Adam Smith préconise un siècle avant Jules Ferry la mise en place d’un système éducatif pour tous soutenu par la puissance publique. Notons qu’à cette occasion il a la clairvoyance d’entrevoir que le paiement des enseignants par l’Etat peut aussi avoir ces côtés pervers.
L’État peut faciliter l’acquisition de ces connaissances, en établissant dans chaque paroisse ou district une petite école où les enfants soient instruits pour un salaire si modique, que même un simple ouvrier puisse le donner; le maître étant en partie, mais non en totalité, payé par l’État, parce que, s’il l’était en totalité ou même pour la plus grande partie, il pourrait bientôt prendre l’habitude de négliger son métier. En Écosse, l’établissement de pareilles écoles de paroisse a fait apprendre à lire à presque tout le commun du peuple, et même, à une très-grande partie, à écrire et à compter. En Angleterre, l’établissement des écoles de charité a produit un effet du même genre, mais non pas aussi généralement, parce que l’établissement n’est pas aussi universellement répandu. Si, dans ces petites écoles, les livres dans lesquels on enseigne à lire aux enfants étaient un peu plus instructifs qu’ils ne le sont pour l’ordinaire; et si, au lieu de montrer aux enfants du peuple à balbutier quelques mots de latin, comme on fait quelquefois dans ces écoles, ce qui ne peut jamais leur être bon à rien, on leur enseignait les premiers éléments de la géométrie et de la mécanique, l’éducation littéraire de cette classe du peuple serait peut-être aussi complète qu’elle est susceptible de l’être. Il n’y a presque pas de métier ordinaire qui ne fournisse quelque occasion d’y faire l’application des principes de la géométrie et de la mécanique, et qui par conséquent ne donnât lieu aux gens du peuple de s’exercer petit à petit, et de se perfectionner dans ces principes qui sont l’introduction nécessaire aux sciences les plus sublimes, ainsi que les plus utiles.
L’État peut encourager l’acquisition de ces parties les plus essentielles de l’éducation, en donnant de petits prix ou quelques petites marques de distinction aux enfants du peuple qui y excelleraient.
RdN, L.V, Ch.1
Adam Smith était-il socialiste ?
Il y a évidemment des penseurs bien plus libéraux qu’Adam Smith, et je ne vous ai présenté ici quelques extraits choisis d’une œuvre monumentale et qui comprend des passages au cœur du libéralisme classique. La Richesse des Nations compte un petit millier de pages et traverse l’histoire des villages de chasseurs, à la République Romaine, et jusque dans les prédictions d’un avenir formidable pour la jeune République américaine qui déclare son indépendance l’année de parution de l’œuvre.
Cependant si vous doutez du libéralisme de d’Adam Smith, je vous suggère deux explications. Soit vous êtes bien plus libéral que lui, soit la société française vous a donné une image totalement déformée de ce qu’est le libéralisme. En tout cas j’espère vous avoir offert une nouvelle perspective sur Adam Smith, qui n’est ni l’auteur parfois décrit à la télévision ni celui présenté par les manuels de l’Education Nationale.
Lien : Adam Smith, Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations, 1776
---
Sur le web

