
Thoreau, Journal
Un projet dont la réalisation prendra quinze ans : où serons-nous ? En verrons-nous la fin ? Mais il est pharaonique : la publication de l’intégralité du Journal de Thoreau (1817-1862), l’auteur de Walden, considéré aux États-Unis comme une figure tutélaire, à la fois fondateur des notions d’écologie et de retour à la nature, et personnage dont l’influence, à travers ses campagnes prônant la désobéissance civile, a eu une grande importance souterraine sur une philosophie de l’individu qui a mené aux beatniks des années cinquante, aux hippies des années soixante, à Kerouac et à Miller.
Jusqu’alors, on ne connaissait en France que des extraits (environ 200 pages sur 7 000, chez Denoël) de cette œuvre immense qui est un classique de l’Amérique. Grâces soient rendues à la petite maison Finitude, et au traducteur, Thierry Gillybœuf, de s’être lancés dans cette tâche immense.
Le premier volume, entamé alors que Thoreau, fraîchement diplômé de Harvard, vient de démissionner d’une école de sa ville natale de Concord, Massachusetts, parce qu’il refuse d’appliquer des châtiments corporels aux élèves, mène jusqu’à l’époque où il fonde avec son frère sa propre école dans la maison familiale, puis commence à publier dans des revues des poèmes et des essais. Le Journal des années 1837-1840, en partie perdu, et dont on ne possède qu’une retranscription partielle effectuée ultérieurement par l’auteur, consiste essentiellement en considérations morales et politiques, en réflexions sur des livres aimés. Poète lui-même, le jeune Thoreau parle admirablement de la poésie : « Toute l’intelligence d’une université est incapable de produire un vers harmonieux. Cela n’arrive jamais. Un vers doit sonner, et ce son doit être comme une véritable secousse – une secousse régu- lièrement renouvelée. » On voit poindre le nez de celui qui se fera le chantre de la « désobéissance civile » : « Ne permettez jamais à la société d’être l’élément dans lequel vous nagez ou dans lequel vous êtes ballotté à la merci des vagues. » L’étang de Walden, où il se retirera pendant un an, loin des hommes, seul dans une cabane, en parfaite communion avec la nature, et qui donnera son nom à son livre le plus célèbre, est cité pour la première fois en mars 1840. Et, ici et là, au milieu des réflexions abstraites, l’admirable description d’un cristal de glace, du cours d’un fleuve « qui ressemble à une goutte de rosée limpide où les cieux et le paysage se seraient réfléchis », d’un paysage de neige (« Cette feuille blanche de neige qui recouvre la glace de l’étang n’est pas vierge parce qu’elle n’est pas écrite, mais parce qu’elle n’est pas lue. Toutes les couleurs sont en blanc »), annoncent le peintre de la nature dont l’art trouvera son plein épanouissement dans Walden. On attend donc avec impatience le deuxième volume, l’année prochaine.
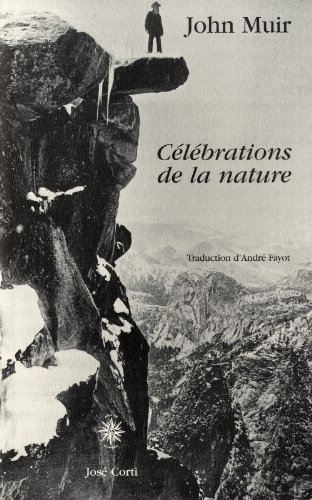
John Muir, célébration de la nature
Profitons de cette parution du Journal de Thoreau pour saluer son cadet, John Muir, né en Écosse en 1838, mais dont les parents ont émigré aux États-Unis en 1849. Muir – dont un glacier qu’il a découvert en Alaska porte aujourd’hui le nom – est comme un fils spirituel de Thoreau (il rendra visite à sa tombe, en 1893), inlassable explorateur, alpiniste intrépide, dont le souvenir est associé à la Yosemite Valley, à l’est de la Sierra Nevada, en Californie, qu’il a maintes fois parcourue, et dont il a donné des descriptions qui font de lui, avec Thoreau, le plus grand prosateur de nature de la littérature américaine.
Le plus récent volume publié par les éditions Corti, qui ont largement contribué à faire connaître son œuvre en France, est une anthologie de textes dans lesquels l’art de John Muir est à son zénith, qu’il décrive le nid dans la neige dans lequel il passe plusieurs jours, au sommet du mont Shasta, admirant les formes et les couleurs des nuages suscités par une tempête de neige et de vent, ou qu’il raconte la souffrance physique éprouvée, lors d’une autre expédition au sommet du même mont Shasta, alors qu’il était à la fois brûlé par le froid du vent et du givre, et par la chaleur émanant d’une source chaude, au sommet du volcan.
John Muir a été à l’origine de la création des parcs naturels, et les textes qu’il consacre à l’exploitation et à la destruction éhontées de la forêt américaine témoignent d’un talent de polémiste hors pair. On est content de pouvoir réunir dans un même hommage ces deux chantres de la nature, ces deux prophètes de l’écologie, ces deux poètes de la description en prose.
Christophe Mercier
Journal 1837-1840, d’Henry David Thoreau, traduit de l’Américain par Thierry Gillybœuf. Éditions Finitude, 250 pages, 22 euros. Célébrations de la nature, de John Muir, traduit de l’américain par André Fayot. Éditions José Corti, 350 pages, 22 euros.N°93 – Les Lettres Françaises mai 2012
