Sandor Marai : Souvenirs de l’autre rive
***
Le titre même du livre est un insaisissable fil d’Ariane, qui nous égare dans le labyrinthe des interprétations. Qui est la Sœur ? Sans cesse nous pensons avoir trouvé la réponse, sans cesse elle se dérobe à nous. Les pages étrangement solitaires de ce livre sont hantées par ses incarnations passagères ou obsédantes. Le masque sans fin glisse d’un visage à l’autre.
L’atmosphère du roman est une page blanche ; le livre s’ouvre sur un paysage de brouillard et de neige, où des personnages désincarnés se croisent sans se comprendre.
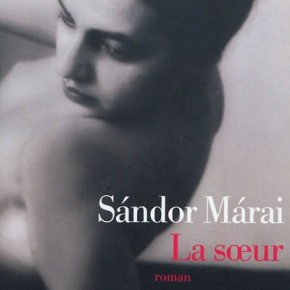
Sandor Marai, La Soeur
La deuxième partie est une paroi mentale où se dessinent les hallucinations d’un homme sous l’empire de la douleur et des drogues. De la ville qui sert de cadre, le narrateur ne voit qu’un mur vide. L’écriture même du livre, par sa limpidité, évoque la nudité de cet univers, l’impassibilité accablante du monde. Que transperce parfois la voix d’un « chamane », ou l’évocation de souvenirs recréant la chaleur d’une vie abolie. Si les deux narrateurs successifs assurent ne pas entendre la rumeur du monde, l’immense vacarme de la guerre se déchaînant aux confins de leur exil intérieur, ils se font pourtant l’écho de vies qui peu à peu se décolorent et s’anéantissent en harmonie avec les murs des villes détruites. Si ces destins sont brisés par la guerre, c’est seulement en ce que l’horrible qui frappe l’humanité renvoie chaque être au naufrage qu’est sa destinée singulière.
Comme dans les Braises, écrites à la même époque, ou dans Divorce à Buda, toute vie est indissociable du mensonge. Nous ne pourrions vivre sans mentir à nous-mêmes et aux autres, et de ce long empoisonnement, seules la maladie ou la mort nous délivrent. La guérison ne peut être qu’un retour au mensonge, dans la clarté solaire, l’amour absolu, le bonheur dérisoire et enivrant. La page blanche, c’est lorsque tombent les paravents et que le néant nous trouve isolés et vains.
Le lecteur suit des pistes qui toutes se confondent dans la rigueur et la densité de l’intrigue, mais déploient en marge interrogations et tentatives de penser l’homme dans la société, l’homme dans sa solitude. La première voix parle depuis la rive des vivants ; elle s’étonne, condamne, évoque la morale et l’absence de Dieu. La deuxième voix nous parvient de la rive des égarés. Elle parle de foi, de l’abandon de Dieu, du sacrifice dans lequel nous devons nous consumer avec une joie amère et ardente : sacrifier le mensonge de notre vie, et par là laisser s’épuiser nos forces vitales, afin d’atteindre la rédemption. Cette voix, nous dit Sandor Marai, « nous raconte quelque chose qu’on ne peut raconter avec des mots ». La transparence est impossible, la communion est sans conscience, le sacrifice est une défaite. Et si vous tentez de réduire ce livre à une seule interprétation, n’oubliez pas que « la mélodie est plus importante que les paroles (…) et la mélodie n’a jamais de sens ».
Manon Birster
La Sœur, de Sandor Marai, traduction de Catherine Fay. Éditions Albin Michel, 2011 (Budapest, 1946). 299 pages, 20 euros.