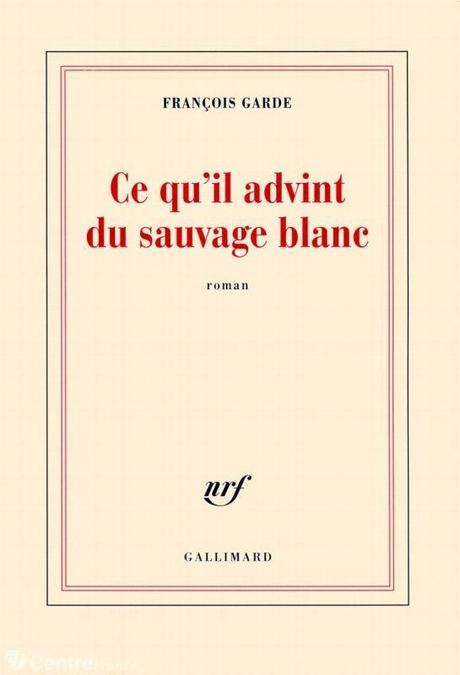
EXTRAIT :
« Alors, il découvrit qu’il était seul. Il poussa un hurlement, qu’aucun navire ne pouvait entendre. Incapable de penser, fébrile, il fut comme pris de folie : il descendit la falaise à toute vitesse, dérapant, griffé, manquant deux fois se rompre le cou, sauta sur le sable, dévala l’estran, entra dans l’eau jusqu’à la potine pour se rapprocher autant qu’il était possible du bateau enfui et hurla de nouveau, cri de rage et appel au secours. Son appel était inaudible depuis la mer que depuis la falaise. Lorsqu’une vague vint lui mouiller le cou, il recula, les yeux fixés vers le large. »
AVIS :
Rares sont les romans qui vous interrogent réellement sur le sens de nos vies, sur le pourquoi de nos actions et le sens de notre société. « Ce qu’il advint du sauvage blanc » est de ces romans qui vous transportent et vous questionnent. Le roman raconte l’histoire vraie de Narcisse Pelletier, jeune matelot français, abandonné sur une plage australienne au 19eme siècle. Considéré comme disparu en mer, il est retrouvé 18 ans plus tard par un navire anglais, au milieu d’une tribu d’aborigènes dont il semble faire partie, tatoué, bronzé et ayant oublié toute forme de socialisation occidentale. Ramené en France, il finira sa vie comme magasinier au Phare des Baleines, dans l’Île de Ré.
François Garde prend le parti de narrer cette histoire en alternant le récit des premières semaines de désespoir du jeune Narcisse, abandonné dans cette terre inconnue et les lettres envoyés par un certain Octave de Vallombrun, gentilhomme (fictif) au Président la prestigieuse Société de géographie française dont il fait parti en tant qu’explorateur et grand voyageur. Octave de Vallombrun débute l’envoi de ses lettres en 1861, alors qu’il se trouve à Sydney. Il vient alors de découvrir un homme blanc, tatoué et nu, ramené au gouverneur et qui, pour sûr, est européen mais ne semble ne parlait qu’un « charabia de sauvage ». On comprends alors qu’il s’agit de Narcisse Pelletier, et qu’entre temps plus de 15 ans se sont écoulés.
À la différence des aventures de « Robinson Crusoé », François Garde ne présente jamais la vie quotidienne de Narcisse, arrêtant délibérément son récit avant que le matelot choisisse d’abandonner son « humanité » pour devenir un membre à part entière de la tribu qui l’a recueilli.
Les seules informations réelles sur ses conditions de vies sont relatés dans les lettres envoyées par Octave de Vallombrun et elles sont si peu nombreuses qu’elles ne constituent pas un élément essentiel à l’avancée de l’histoire.
Car, en réalité, ce dont il est question ici c’est de la socialisation d’un être humain en elle-même, le re-apprentissage d’une langue qui s’accompagne de tout un système de valeurs, de rapport entre les choses et les mots. Ce roman est également l’occasion de nous remémorer des théories du 19ème siècle sur le plan de l’anthropologie qui nous paraissent aujourd’hui irréalistes et scandaleuses.
Mais c’est là toute la magie de « Ce qu’il advint du sauvage blanc ». François Garde nous propose un livre qui est loin de moraliser le lecteur comme le fait un livre du calibre de « La controverse de Valladolid ». L’écrivain cherche au contraire à éveiller la réflexion du lecteur par des réflexions d’Octave de Vallombrun mais également par des réactions de Narcisse Pelletier.
On se prends à avoir pitié de ce pauvre matelot, à se dire qu’au final il n’a connu le vrai bonheur que dans ces forêts méconnues d’Australie et que notre société ne fait que le détruire. On est triste pour lui, et on déteste ces gentilshommes qui n’ont pas idée de la stupidité dont ils font preuve dans leurs réflexions. Bref, on est chamboulés.
Tout cela serrait bien évidemment impossible sans le style de François Garde. Sa plume, que nous admettons très classique, porte l’histoire et lui donne toute cette dimension sociale. Sa prose élégante et magnifique donne l’illusion qu’on a affaire à un auteur des plus expérimentés.
Et pourtant, « Ce qu’il advint du sauvage blanc » est le premier roman de François Garde. À ce titre, il vient d’ailleurs de recevoir, mardi dernier, le Prix Goncourt du premier roman, et c’est le moins que l’on pouvait lui souhaiter.
À la fin du livre, on se rappelle un autre « premier roman » d’un illustre inconnu, qui lui aussi nous avait enchanté au delà du possible. C’était Alexis Jenni, et « L’art français de la guerre ». On se dit que décidément Gallimard a le chic pour dénicher des chefs d’oeuvre.


