M. Jenni a "la carte" : ce laissez-passer qui vous permet d'être bien considéré par les médias et l'intelligentsia: vous savez, cet esprit ambiant et convenable, qu'on appelle parfois du politiquement correct. De plus, il raconte une belle histoire : je ne parle pas de celle de son livre (pas tout de suite), mais de l'histoire du "prof-de-biologie-de-province-qui-écrit-dans-un-café-qui -n'est-pas-le-Flore-et-qui-fait-un-premier-roman-qui-d'emblée-devient-le-prix-Goncourt". Simone est d'emblée séduite.
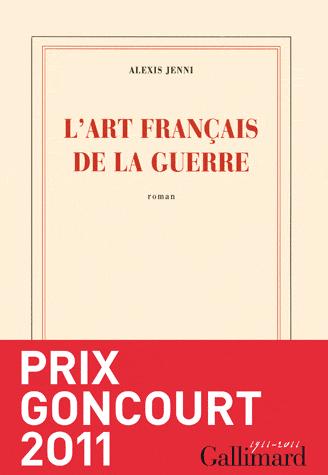
Bref, d'emblée, j'ai regardé avec circonspection ce roman. Et je ne suis pas déçu : de ma circonspection, veux-je dire. Car après l'avoir lu, je demeure circonspect. Au fond, Alexandre Jenni est le Paul Bourget de notre début de siècle.
1/ M. Jenni a du style, convenons en immédiatement : la langue est plaisante, classique, lisible. Bravo. Le sujet est nouveau (dans le monde de la grande littérature): la question de la guerre contemporaine. Avec un traitement qui est régulièrement intéressant.
2/ Du style et un sujet "pas à la mode" : comment peut-on avoir le Goncourt avec ces présupposés ? là est au fond le grand talent, mais donc la grande déception, de M. Jenni. Là où le bât blesse, et où il déçoit.
- avec cette manie d'insérer entre chaque chapitre historique un chapitre "contemporain"
- avec tous les défauts du style "contemporain" : le cru, dans tous les sens du terme. La fascination pour la "chair" : cette incroyable scène de "boucherie" et cette trop convenue scène pornographique : puisque désormais, la Littérature française, avec un grand L et des publications dans les maisons de Saint Germain, n'imagine pas un "roman" sans pornographie, puisque c'est désormais la convention qui montre que vous connaissez votre sujet.
- avec cette description d'une France contemporaine clivée uniquement par la seule question du racisme
- avec cette façon de voir que la guerre, c'est toujours la boucherie et, pour tout dire, la torture. Qu'elle soit un fait évident dans l'épisode algérien (d'ailleurs bien traité), vouloir à toute force la trouver pendant la deuxième guerre mondiale ou l'Indochine, c'est tiré par les cheveux. Privilège de romancier ? peut-être, mais le problème vient de ce qu'il s'agit de "l'art français la guerre" qui donne son titre à l'ouvrage. Et c'est au fond ce qu'il y a de plus déplaisant.
3/ Tout est-il pourtant à jeter ? Non, ce serait trop simple. Et puis un grand produit commercial comme le Goncourt n'est pas un film d'art et d'essai, il faut que ce soit lisible si on veut le vendre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. On a donc quelques bons moments :
- d'une façon générale, lisez tous les chapitres historiques, avec l'itinéraire de Salagnon qui est passionnant, d'autant que ce personnage a une vraie profondeur, une pâte humaine, et des paradoxes si humains qu'on le suit tout au long.
- sur les chapitres contemporains : sautez allègrement les passages lourdingues. Picorez et surtout : dans les deux premiers chapitres, les passages sur le dessin (la visite du marché au puces, la première leçon chez Salagnon, ...); dans le dernier chapitre, la critique jubilatoire du faux reconstitué, je veux parler de la bataille d'Alger, film de propagande.
Et puis voilà. Au fond, faut-il lire des prix Goncourt ? Car voici un roman qui tient plus du "story telling" que de la littérature, qui tient plus de l'opération commerciale que de la sélection du "meilleur talent". Un bouquin "convenable", dans l'air du temps, commercial. Pas inintéressant. Ce n'est pas du Lartéguy, pas non plus du Tom Clancy. Entre les deux ?
Références:
- cette critique par François Chauvancy
- le billet du 29 août où j'annonçais le Goncourt, avec deux mois d'avance
- le billet du 2 novembre, où je pressentais déjà que ce livre n'était que l'expression del'air du temps.
O. Kempf

