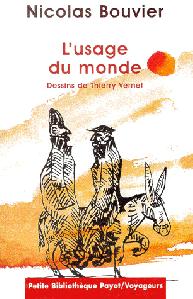 Il n’est pas évident d’écrire une critique sur un livre culte qui a déjà inspiré des dizaines d’articles. Mais L’usage du monde m’a suffisamment séduite pour me donner envie de tenter l’exercice.
Il n’est pas évident d’écrire une critique sur un livre culte qui a déjà inspiré des dizaines d’articles. Mais L’usage du monde m’a suffisamment séduite pour me donner envie de tenter l’exercice.
Bien qu’il n’y ait pas réellement d’histoire dans un récit de voyage, on peut tout de même résumer le parcours :
En juin 1953, le jeune écrivain Nicolas Bouvier entame avec son ami le peintre Thierry Vernet un voyage qui, partant de Genève, doit les mener au Khyber Pass (frontière du Pakistan) en passant par la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, l’Iran, l’Afghanistan. Ils partent avec très peu d’argent et comptent sur des travaux en cours de route pour payer leur voyage (écriture d’articles pour des journaux, conférences, cours de français – ventes de peintures du côté de Thierry Vernet). La voiture qu’ils prennent – une petite Fiat – s’avère être un véritable boulet : passant plus de temps à être poussée ou réparée que conduite.
En tout le périple dure un an et demi.
Des régions, des villes qu’il traverse, Nicolas Bouvier cherche à nous donner une évocation complète, il ne néglige aucun détail du paysage : à un moment il décrit même la route entre deux villages, ce qui semble n’avoir aucun intérêt à priori, mais dans un style si poétique que c’est finalement un des passages qui m’a le plus marquée.
Il s’attarde sur une nuance de couleur, sur un parfum, jusqu’à nous les faire presque ressentir. Chaque musique qu’il est amené à entendre lui inspire une page d’analyse et d’émerveillement. Lui et son ami ont d’ailleurs apporté avec eux un enregistreur pour garder une trace de ces chants et de ces musiques.
Nicolas Bouvier n’est pas non plus avare d’indications historiques ou politiques mais il les délivre par petites touches : on sent qu’il cherche surtout à transmettre la réalité sensible, la vie présente.
Mais ce qui semble l’intéresser au plus haut point pendant ce voyage ce sont les gens : le livre forme une galerie de portraits assez saisissants, très divers, et souvent teintés d’humour. Les façons de penser, les cultures, les manières de vivre, semblent être pour lui une source continuelle de curiosité et de réflexion.
Mais je crois que la chose la plus remarquable dans ce livre c’est son écriture : le style est magique. A la fois précis, poétique, plein d’inattendus. Tel docteur en train de jouer du violon “se gonfle de musique comme un champignon sous l’averse”. Tel veilleur de nuit “dort sous sa moustache comme sous un parapluie fermé”.
Alors bien sûr L’usage du monde a quelques défauts : peut-être des longueurs à certains moments. J’avoue par exemple que les innombrables pannes de voiture ont fini par me taper sur les nerfs – mais elles devaient être encore plus exaspérantes à vivre.
J’avoue aussi que j’ai regretté leur départ d’Iran car ce pays m’a enchantée et la suite m’a semblé plus morose – mais là encore ça doit être un reflet de ce qu’ils ont réellement éprouvé.
Pour conclure voici quelques extraits, peu diffusés ailleurs, et qui m’ont plu :
” Le voyage fournit des occasions de s’ébrouer mais pas – comme on le croyait – la liberté. Il fait plutôt éprouver une sorte de réduction : privé de son cadre habituel, dépouillé de ses habitudes comme d’un volumineux emballage, le voyageur se trouve ramené à de plus humbles proportions. Plus ouvert aussi à la curiosité, à l’intuition, au coup de foudre.”
“A l’hypocrisie dont l’Occident a su faire un si vaillant usage, ils (les habitants de Tabriz) préfèrent de beaucoup le cynisme. Ici, comme partout dans le monde, on trompe son prochain lorsqu’il faut vraiment le tromper, mais sans trop s’abuser sur ses propres mobiles, ni sur les fins qu’on poursuit. Ainsi peut-on, lorsqu’elles sont atteintes, s’en réjouir librement avec quelques amis.” (page 224)
“ Et surtout il y a le bleu. Il faut venir jusqu’ici pour découvrir le bleu. Dans les Balkans déjà, l’œil s’y prépare ; en Grèce il domine mais il fait l’important : un bleu agressif, remuant comme la mer, qui laisse encore percer l’affirmation, les projets, une sorte d’intransigeance. Tandis qu’ici ! Les portes des boutiques, les licous des chevaux, les bijoux de quatre sous : partout cet inimitable bleu persan qui allège le cœur, qui tient l’Iran à bout de bras, qui s’est éclairé et patiné avec le temps comme s’éclaire la palette d’un grand peintre.” (page 241)
