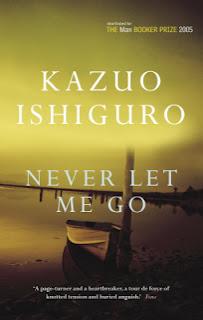
Rares sont mes incursions dans la littérature dépassant la deuxième moitié du XXème siècle, et sur le nombre de deux cent cinquante-neuf œuvres lues, je ne pense point me fourvoyer en affirmant qu’une maigre vingtaine s’inscrit au-delà de l’année à mon sens charnière de 1950. Never Let Me Go fut publié au cours de l’an 2005, en premier lieu au Royaume-Unis, terre de cœur de l’auteur Kazuo Ishiguro, puis le livre s’est vu essaimé au travers du reste du globe, selon les aléas capricieux des éditions. Tel un fil de laine écarlate au creux de mes paumes m’ayant guidé vers un but précis et connu de lui seul, un autre roman m’amena à prendre le temps de parcourir cet opus : The Remains of the Day ; narrant du bout d’une plume pudique les doutes d’un majordome guindé, amené par les affres de l’âge à se questionner sur ses actes manqués. Dans le cas de l’œuvre qui nous occupe, malgré un style somme toute simple mais dont la grande maîtrise de ses trop rares élans lyriques à mon goût transparaît indubitablement, l’auteur propose une réflexion sobre et toute en retenue au sujet de thématiques tendant à glaner une importance considérable, au vue de notre actualité décadente ; ce tout en inscrivant son récit dans un cadre uchronique, ou la réécriture des avancées scientifiques permet le placement d’un sujet bioéthique on ne peux plus polémique, mais s’effaçant pourtant face à des préoccupations profondément morales. Demeure ainsi l’importance exigible de la mémoire permettant de se construire en tant qu’humain (trop humain ?) à part entière, les ravages d’une enfance volée, placée sous les auspices d’une éducation mensongère, la résignation face à un atavisme que l’on se voit irrémédiablement imposé.
Cires molles
Remonté à la manière d’une imposante pendule d’argent, un nom de lieu apparaît régulièrement dans le récit d’Ishiguro : le pensionnant de Hailsham, reliquaire des souvenirs de trois personnages que le lecteur se voit proposé de suivre sur une durée de trente ans, et dont les réminiscences nous seront transmises par le regard de l’une d’entre eux : la jeune Kathy H. Aussi étrange que cela puisse paraître, je fus en tant que lectrice saisie d’un malaise insondable à chaque évocation, ne serait-ce que succincte de cet internat, où le façonnement mécanique atteint une perfection effarante, abrogeant de facto l’humanité en devenir de ses petits élèves. C’est là que grandissent Tommy, Ruth et Kathy, principaux protagonistes de l’œuvre du romancier britannique. Amoncelant ses souvenirs diffus et en demi-teinte, Kath nous raconte, de sa parole à la richesse élégiaque bien trop peu exploitée, l’atmosphère de clair-obscur de son cadre de vie, la componction austère de ses différents enseignants, les murs aseptisés sur lesquels ses mains enfantines coururent pendant dix-huit longues années. Exempts d’une quelconque connaissance d’un probable monde extérieur, les enfants évoluent en sus en une parfaite autarcie, recevant une éducation stricte, tout en se voyant inculqué au cours de leur apprentissage qu’ils s’avèrent des créatures à part, spéciaux, les laissant accroire qu’ils se rapprochent de l’état de diamant brut n’attendant qu’à être polis pour pouvoir atteindre une perfectibilité dans leur existence jusqu’ici sommaire, et qu’on leur promet dès leur sortie de Hailsham. Cependant, la déconvenue face au vaste reste du monde se fait génitrice de doléance et d’exclusion, car cette éducation rigoriste martelée au fil d’une jeunesse démesurément protégée prohiba aux jeunes élèves un élément clé de leur développement : être, là où un enseignement reclus et abstrus leur fit entendre le parfait contraire, les plongeant dans une pure abnégation face à la notion d’identité même ; leur laissant pour seule éventualité celle de donner créance à seulement ce qu’on pouvait chercher à leur enseignerLes personnages centraux ne font nullement exception à cette règle bien huilée, et les enfants furent pétris de valeurs dont la sécularité n’a d’égale que sa déficience désuète ; thème dont on constate l’importance lors d’une scène empreinte d’intimité violée par une voyeuse de prime abord involontaire, puis assumé, où Kathy enfant berce une poupée de chiffon dans ses bras innocents. Assistant à cette scène agneline, l’institutrice bégueule ayant fait involontairement irruption dans la sphère de l’enfance candide, fond en larme : sa seule possibilité d’exprimer à la petite créature se dressant non loin de sa personne qu’elle ne pourra jamais être mère, son chagrin prenant source dans son incroyance à ce qu’une femme ne peut nullement s’épanouir en la totale absence de maternité. L’héroïne et ses deux seuls amis se retrouvent ainsi, béjaunes et nus, lâchés au sein d’une société à laquelle ils vont se révéler inaptes à entendre un traite-mot, piégés dans une rigidité coudoyant la frustration d’une jeunesse volée dont ils n’ont pat tant que peu conscience, même si le traumatisme gît au fond de leur être. Aussi demeure en suspens cette question : comment apprendre à vivre à ses créatures labiles une existence habitée d’un quelconque sens lorsqu’on est un simple clone dont la seule utilité est de faire don de ses organes, un à un, jusqu’à ce que mort s’en suive ? Impossible, semble sous-entendre Kazuo Ishiguro dans un ton suintant la contrition la plus profonde, aussi dote-t-il ses personnages de quelques élans existentiels une fois ceux-ci en dehors du pensionnat de Hailsham. Face à un nihilisme ambiant qui les enveloppe sans qu’ils en aient réellement conscience, les trois anciens étudiants y répondent chacun à leur manière. Tommy et Ruth par le couple, l’amour. Kathy, par la solitude contemplative, l’introspection et l’empathie. Des questionnements qui ne lui permettent cependant pas de se révolter contre la brièveté programmée de leur existence, et le désabusement semble de ce fait faire corps avec Kathy, biffant ses maigres rêves, se laissant aller à marcher inlassablement vers une fin prématurée que son conditionnement subit lors de ses premières années d’existence lui apprirent à accepter d’une résignation sans borne. Une attitude édifiante dévoilant avec pudeur une connivence malsaine avec l’idée de mort qui n’est, dans l’œuvre d’Ishiguro, nullement appréhendée comme avilissante, mais comme un objectif vers lequel Kathy chemine sans volonté d’y déroger, sans force pour fuir bien que d’autres sentes s’échappent à intervalles réguliers du chemin qu’elle emprunte dès le début du roman, censément, obstinément. Cette froideur face à un déterminisme effrayant sert le récit, marchant de concert avec une rigidité descriptive et une fixité narrative habitant chaque personnage évoluant entre les murs de l’internat anglais où l’ambiance terne permet au lecteur de s’imprégner d’une lenteur contemplative savamment calculée. Une lenteur qui peut justement nous amener à nous questionner sur la résignation des personnages principaux face à leur sort.
Absence d’être
Lapalissade ridicule que d’affirmer ici que tout un chacun est condamné à mourir ; ce qui pousserait l’humain lambda à vivre étant l’espoir illusoire que son existence, avec un peu de chance, connaîtra une longévité sereine- tout du moins davantage que celle d’autrui- si l’on parvient à échapper à la maladie, à l’accident, et à la pulsion suicidaire. Dénués de la moindre once de commisération, Tommy, Ruth et Kath briment leurs envies, marchent vers un néant proche, conscients comme ils le sont que leur espérance d’existence ne dépassera que rarement les trente-cinq ans. Réduits à ne servir nullement autre chose que d’une dérisoire forme humaine de soupape de sûreté des êtres sur lesquels ils ont été modelés, nos trois héros cheminent au cours de la dernière partie du roman vers une prise de conscience de l’absurdité de vie, et de l’égoïsme atterrant dont on fait preuve leur créateur au moment de leur « conception ». Aussi, comme l’expliquait le philosophe Albert Camus, il n’existe que deux issues à cette prise de conscience : le rétablissement ou le suicide. Or, il n’est aucun des élèves de Hailsham qui semblent habités d’une possible once de rébellion- même un tant soit peu fugitive- et nul grief n’est géniteur de bile noire courant dans leurs veines, qu’ils auraient pu à loisir retourner contre l’impavide sort. Règne ainsi cette notion d’acceptation pourtant inique, face au vide vertigineux figurant leurs perspectives. Nul avenir social, d’aucune procréation pouvant entériner leur mémoire (pour quelques dizaines d’années tout du moins, demeurons en cet instant pragmatiques), une espérance de vie par çà trop réduite de sorte à leur laisser l’illusion d’un accomplissement qui leur offrirait l’occasion d’une pérennité. Nille possibilité, si ce n’est l’indolence et l’apathie comme maigres réponses à un sort regrettable. Sont-ce là les ravages d’un embrigadement parfait menant à une observance pusillanime des personnages d’Ishiguro ? Ou n’existe-t-il après tout aucune remontrance à jeter à la face de l’hideur de l’existence ? Je ne saurais avancer qu’il existe une seule explication valable à ces nombreux questionnements face à la résignation des protagonistes, cependant l’aspect hautement fallacieux de toute cette force de l’écriture de la destinée semble un thème de prédilection pour l’auteur ; ou bien n’est-ce qu’un miroir poli, tendu au lecteur l’invitant au questionnement profond sur l’ambiante passivité de nos mondes actuels, où une forme pernicieuse de déterminisme moral et social semble avoir dévoré les notions mêmes d’espoir et de devenir. À aucun moment au long du roman, Kathy ne questionne le sens même de leur vie, l’utilité de leurs créations, le refus de la réalité est prégnant dans Never Let Me Go ; et de récusions, l’on n’en trouve aucune concernant leur droit à ne jamais faire don des composants de leur corps pour glaner la possibilité d’une vie « normale ». Seule récrimination pointant au travers des lignes de l’œuvre, est la scène où Tommy et Kath cherchent, hélas inutilement, à obtenir un sursis auprès de leur ancienne directrice de sorte à retarder de trois ou quatre années le début de leurs dons, prétextant un amour fort les unissant.De vacillation, aucune. On ne s’interroge pas sur le sacrifice de soi pour un « possible » dont ils ne connaissent strictement rien. Rêve de beaucoup de rhéteurs et autres dirigeants, l’obéissance de ce que j’oserais appeler ces cobayes est parfaite. Glaner le cours de l’horloge, mais nullement l’existence. Attendre, au lieu de perpétuer. Ne demeure-t-il, en cette situation, que la déréliction, un abandon moral en lequel faire libation de ses déboires et désabusements dans l’attente d’une mort méthodique, progressive, avec pour unique dringuelle s’imaginer que l’on a probablement rendu la vie à une personne que les héros de peuvent nullement envisager, car ils ne le connaissent point, demeurant dans l’ordre fuligineux de l’hypothèse ? Là où l’empathie du lecteur est aiguillonnée, Kathy, Ruth et Tommy semblent incapable de la moindre révolte. Modelés ils furent par la soumission, asservis ils demeureront, dédaignant la réflexion sur une existence qui, de toute évidence, les dépasse et ne revêt aucun attrait pouvant dulcifier leur destin froid comme l’acier, comme le fer du scalpel appelé à plonger précautionneusement en leurs chairs vivaces. Ainsi, les survivances de leur passé à Hailsham reste toute ce à quoi ils peuvent se rattacher, en un ultime réconfort avant la mort établie ; cette pitié extrême restant, fébrile et froide comme un débris : les gérants du pensionnat les dotèrent d’au moins un « précédent » vers lequel se lover en mémoire, à ces êtres ne jouissant point du moindre avenir.
Pour les curieux, une adaptation cinématographique de ce livre est sortie sur les écrans en 2010. Réalisé par Mark Romanek, le film met en scène Carrey Mulligan (Kathy), Keira Knightley (Ruth) et Andrew Garfield (Tommy).

