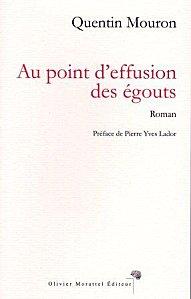 Le titre du premier roman de Quentin Mouron, Au point d'effusion des égouts, édité par Olivier Morattel
ici, n'est guère engageant. Il provient d'une citation d'Antonin Artaud que l'auteur a mis en épigraphe au second et dernier chapitre
de son livre, et qui est tirée de L'Art et la Mort :
Le titre du premier roman de Quentin Mouron, Au point d'effusion des égouts, édité par Olivier Morattel
ici, n'est guère engageant. Il provient d'une citation d'Antonin Artaud que l'auteur a mis en épigraphe au second et dernier chapitre
de son livre, et qui est tirée de L'Art et la Mort :
"L'avancée de la nuit fourmillante avec son cortège d'égouts. Voilà à quel endroit cette peinture se place, au point d'effusion des égouts."
En physique le point de fusion est la température à laquelle un solide devient liquide à une pression donnée. Mais le point d'effusion ? Qui plus est, des égouts ? Est-ce le point où les fanges finissent par s'épancher ?
Le narrateur lors d'un périple aux Etats-Unis fait étape à Los Angeles, où habite sa cousine Clara, la cinquantaine, qui fait un véritable rejet de la gent masculine, après avoir subi les assauts répétés, plusieurs fois par jour, de son ex-mari à la queue insatiable.
Depuis, pour Clara, tous les hommes sont de dangereux érotomanes. Elle dégoise sur eux avec quelques folles de son acabit. Tandis que toute une batterie de thérapeutes, de gourous et de derviches, tourne autour d'elle pour lui ponctionner tout l'argent qui lui reste...
Clara sort un moment avec ce cousin venu de Suisse. Elle cultive en rougissant l'ambiguité improbable d'une cougar qui se paie un gigolo de trente ans son cadet. C'est donc bien elle qui paie et ce ne sont que beuveries et vacarmes partagés avec elle, habituée des abîmes, et du malheur, devenu pour elle incontournable.
Un jour le narrateur a l'oeil attiré depuis son lit de malade - il est alité pendant trois semaines - par la belle Laura qui rend visite à sa marraine, de l'autre côté de la rue. Certes elle est trop maigre pour être chaleureuse. Certes elle n'a rien de bien remarquable au fond et rien non plus d'inoubliable. Encore aurait-il fallu ne pas commencer à parler ensemble, pour ne pas s'enticher d'elle.
En tout cas Clara prend mal cette aventure avec cette girl next door. Son propre cousin ne pense décidément qu'à baiser, comme les autres hommes, au lieu de calmer sa libido - Quentin Mouron est plus cru - en pratiquant le yoga, par exemple, qui est la version orientale et tendance du bromure...
En rentrant au logis le cousin narrateur trouve toutes ses affaires sur le trottoir. Il repart donc retrouver sa Laura, avec laquelle il file l'imparfait amour, en se déboutonnant imprudemment, sans doute un peu trop, au sens propre comme au figuré, au point qu'il suffit, un mauvais jour, de trois mots échangés, pour que Laura et lui soient subitement déliés.
Que faire quand un vieux chagrin d'amour vous taraude, sinon prendre le large. Le narrateur quitte donc Los Angeles pour échapper à sa mauvaise histoire de mauvais coeur et prouver quelque chose à quelqu'un. Il prend la route en direction de Las Vegas. Il reprend sa vie de nomade qui ne rêve plus de s'arrêter et s'arrête cependant à Trona, au milieu du désert, lieu inouï qui bat tous les records de concentration de fous.
Qui n'a pas vu Trona ne sait pas ce que signifie la pauvreté. Ce n'est pas seulement la pauvreté en tant que telle, qui vous saisit là-bas. Elle existe en bien d'autres endroits du monde désertique. Mais, à Trona, il n'y a vraiment aucun espoir. Trona n'est pas faite pour le narrateur qui a un penchant pour l'esbroufe. Car Trona est un monde qui ne sait pas mentir et dont on ne ressort jamais, ou alors pas indemne :
"Quand on peint la misère, on fait la part belle aux victimes, on les boulonne au fond du ciel.
Ils deviennent les idoles sous lesquelles on sanglote pour bercer sa conscience. Pour être exact, il faudrait dire les vices...La violence. La haine. Les bouteilles qui se brisent. Les saloperies
aux encoignures. L'odeur de merde. Les hématomes...À Trona on ne meurt pas en odeur de sainteté..."
Las Vegas se situe au bout de l'autoroute, sur laquelle on ne rencontre aucun obstacle. Tout d'un coup celle-ci se termine en bouchon. On est arrivé dans la cité du pain et des jeux. Après le désert et le silence, il y a soudain la multitude bruyante des véhicules, dont les conducteurs et les passagers sont pressés de s'aller divertir de façon affreuse, immonde, pas toujours très ragoûtante, mais tout de même amusante, il faut être juste.
Le narrateur aurait bien voulu ne jamais rentrer en Suisse et s'envoler de là pour toujours. Ce n'est pas qu'il ne soit pas à
l'aise dans son époque. C'est avec l'espace qu'il a des déconvenues. Il a en effet retrouvé le lieu, tranquille et propre en ordre, qu'il avait quitté, comme à son départ.
Parce qu'il se garde religieusement de produire quoi que ce soit et qu'il refuse d'être utile, qu'il ne se veut ni citoyen, ni contribuable, qu'il est réformé de l'armée suisse, qu'il ne veut pas s'insérer, ni se mouler dans le monde, il est seulement venu y faire une pause avant de repartir :
"On ne se débarasse pas du monde en invoquant les moeurs. On ne se débarasse pas de soi en invoquant le monde."
Il ne veut pas de la vie de travail qui l'attendait ici et qui serait la vraie vie, concrète, immobile, lisse, alors qu'elle se situe pour lui "dans un contournement de la vie même". Il repartira donc, c'est certain, après une année passée, et ce constat final, désabusé:
"Nous n'avançons qu'en tressautant. D'un cahot l'autre. En cadence. Mince haras. C'est à n'y rien comprendre."
Le narrateur écrit par vanité. Il a envie de flatterie. Il le reconnaît. Il se regarde de temps en temps dans la glace en se disant qu'il est comme un grand génie, parce qu'il a un réel besoin d'exister. Il voudrait surtout que le lecteur ne se contente pas de caresser les pages de son livre mais s'y plonge, comme un bon lecteur doit le faire.
Pourquoi ne pas qualifier ce portrait d'un jeune homme comme celui d'un artiste, remuant et attachant ? Comment ne pas être
touché, sans partager cette conviction, que ce jeune homme ne voit de liberté minuscule, et unique, que "de se tromper soi-même, et d'abuser les autres"
?
Francis Richard

