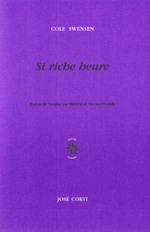 Cole Swensen, auteure américaine traductrice de poètes
français contemporains, a construit un ensemble extrêmement complexe à partir
d’un livre d’heures – un livre de piété, donc – les Très Riches Heures du duc de Berry. Elle explique ce qu’est sa
source dans une introduction :
Cole Swensen, auteure américaine traductrice de poètes
français contemporains, a construit un ensemble extrêmement complexe à partir
d’un livre d’heures – un livre de piété, donc – les Très Riches Heures du duc de Berry. Elle explique ce qu’est sa
source dans une introduction :
Les livres d’heures étaient répandus au Moyen Âge en tant que textes à usage
dévotionnel conçus pour permettre à chacun d’observer le rituel religieux en
dehors des formes strictement populaires. Les
Très Riches Heures est l’un des plus élaborés, de plus il incarne le style
Gothique International, un mélange d’influences de l’Europe tout entière.
Suivent des détails sur la destination de ce livre particulier, son auteur et
son destinataire, également sur son utilisation pour l’écriture. Il ne
s’agissait pas de décrire les illustrations : quand un détail est livré,
il apparaît étrange au lecteur qui n’a pas les images devant lui quand la
narratrice devient un personnage d’une scène ; ainsi en mai, « (…) un
château à peine visible derrière les arbres / il le montra, sourit, mais je
n’ai pu entendre ce qu’il disait ». S’il y a bien volonté d’entretenir une
relation avec les enluminures, les poèmes n’en sont pas esclaves et prennent
pour prétexte divers événements du XVe siècle, parce qu’ils sont,
avant tout « un assemblage de mots dont chacun naît et meurt sur la page
même. »
L’introduction elle-même, en prose classique, explicative, est précédée d’un
Prologue et d’une Préface, suivie d’un Avant-propos et d’un Envoi, tous
éléments où la distinction vers/prose est sans objet et qui constituent un
véritable « mode d’emploi » des variations autour du livre d’heures.
On y lit des fragments de citations en français et en latin, des allusions aux
maux du XVe siècle (la peste, la guerre) ; on y mêle les
époques : le siècle du livre d’heures et le temps du narrateur :
c’est la grande crue de 1408 et « elle observa une tasse et sa soucoupe tournoyer
un moment à la surface » et les lieux : Paris de la fin du Moyen Âge
et New York (Green Park), on y évoque la théologie de saint Augustin, on y
introduit un possible lecteur qui pourrait décider du mode de lecture de
certains passages :
il est dit
« c’est écrit » bien qu’il n’y ait nulle
raison, particulièrement,
que cela dût arriver / arrivera (cochez) comme ça.
De plus, la manière dont chaque poème est ensuite présenté
apparaît, à peu près, dans ces pages
préliminaires : organisation de la page (décrochages, mots isolés), usage
de la ponctuation (blancs, parenthèses qui peuvent ne pas être ouvertes, ou
fermées) et jeu avec la syntaxe (phrases
inachevées, juxtaposition de fragments). Ces choix rompent avec le caractère
narratif visible des titres : ils suivent (pas toujours) l’ordre du
calendrier (Le 1er janvier : Festin du Nouvel An ; le 3
janvier, Fête de la Sainte Geneviève, etc.) ou explicitent une action évoquée
(Le Peintre Peint Un Calendrier). Ils contribuent à restituer quelque chose
d’un univers bien éloigné du nôtre. Plus précisément, brisant l’idée même
d’ordre, celui du calendrier, celui des travaux et activités saisonniers que
livrent les enluminures (la moisson, la chasse), ces choix aident à construire
les images d’un monde qui se défait, en débris : la peste de 1416 emporte
une partie de la population européenne, la guerre de Cent ans détruit villes et
campagnes. Images d’un autre monde encore : se succèdent ou se chevauchent
les événements et les personnages qu’ont retenus l’imaginaire national et les
livres scolaires (la bataille d’Azincourt, Jeanne d’Arc), les catastrophes (la
grande crue de la Seine, les gels répétés des rivières, l’apparition de la
coqueluche), quelques noms d’écrivains (Christine de Pisan, François Villon),
les traces des grandes peurs liées à la guerre et à la peste (la Maisnie
Hellequin, la première Danse Macabre), la date de création d’un grand armorial
(la Cour amoureuse de Charles VI) et celle de la remise du manuscrit des Très riches heures, en 1485…
Mais dans ce siècle de destruction quelques événements annoncent un monde
nouveau : le compte mécanique des heures, l’impression des livres,
l’invention de la perspective par Alberti, la peinture de Vinci et celle de
Paolo Uccello, la pensée de Marcile Ficin et celle de Nicolas de Cuse. Le
présent, celui de la narratrice, s’impose régulièrement dans les poèmes, ne
serait-ce que par le nom d’un historien auquel le lecteur est renvoyé
(Huizinga) ou d’un autre, notre contemporain, cité (Alain Roger). Autrement :
tel texte donné comme recopié n’est pas assuré, l’original étant peu
lisible :
tout un après-midi d’étoiles
Luit (ou « lui » — je n’arrive pas à
lire la note, l’encre pâlie, la coupe vive
Tourbillon des temps, bruits du Moyen Âge finissant, aube d’une Renaissance longue à venir…, et la distance d’une narratrice souveraine qui brasse tout ce que charrie un siècle tourmenté, qui fait alterner le détail minuscule — mais comment autrement faire imaginer la vie de ceux qui n’ont pas de voix ? — et la date qui demeure signe. Si riche heure, livre foisonnant, demande au lecteur d’"oser savoir"…
Le 15 Octobre 1415 : Initiation à la Guilde : Paolo Uccello Observe le Ciel
Vasari jure
les oiseaux y furent, y sont
encore
attention ils sont
la mainpassée devant le visage pour
effacer ce qui était là qui était
difficile, était
encore à moitié inachevéune trêve déclenchée par l’envol
Un homme quitte un tableau et entre en guerre
et tout ce qui doit être là
est là
et ce qui ne devrait pas
jamais, est maintenant partout
c’est que les animaux volent
c’est que maintenant
les proies planent un moment
Cole Swensen, Si riche heure, éditions José Corti, 2007, p. 100.
contribution de Tristan Hordé
Cole Swensen, Si riche heure, traduit de l’anglais par Maïtreyi et Nicolas Pesquès, José Corti, 2007, 16€.
Cole Swensen dans Poezibao :
Bio-bibliographie,
conférence à Créteil,
extrait 1 (avec Gianni d’Elia), extrait 2,
Si riche heure (parution)

