 Il est assez inhabituel, pour un anglophone pure souche, de faire carrière dans la langue de Molière. Et a fortiori, de devenir l’un des plus grands chantres de la francophonie québécoise. C’est la prouesse qu’a pourtant réalisée Jim Corcoran. Né à Sherbrooke, au Québec, en 1949, cet auteur-compositeur-interprète, réputé depuis le célèbre duo qu’il formait, dans les années 1970, avec Bertrand Gosselin, fait aujourd’hui partie des quelques monstres sacrés de la chanson québécoise et célèbre, cette année, ses 40 ans de carrière. Un hommage s’imposait ! Lorsque nous l’avons rencontré, en 1995, il venait de publier son album « Zola à vélo ». Depuis, Jim Corcoran n’a jamais cessé d’écrire et d’éblouir. Parmi ses plus récentes réalisations, des collaborations avec le Cirque du Soleil ou Matthieu Chedid (avec lequel il a fait l’Olympia). Son plus récent album, « Pages blanches », a été publié en 2005.
Il est assez inhabituel, pour un anglophone pure souche, de faire carrière dans la langue de Molière. Et a fortiori, de devenir l’un des plus grands chantres de la francophonie québécoise. C’est la prouesse qu’a pourtant réalisée Jim Corcoran. Né à Sherbrooke, au Québec, en 1949, cet auteur-compositeur-interprète, réputé depuis le célèbre duo qu’il formait, dans les années 1970, avec Bertrand Gosselin, fait aujourd’hui partie des quelques monstres sacrés de la chanson québécoise et célèbre, cette année, ses 40 ans de carrière. Un hommage s’imposait ! Lorsque nous l’avons rencontré, en 1995, il venait de publier son album « Zola à vélo ». Depuis, Jim Corcoran n’a jamais cessé d’écrire et d’éblouir. Parmi ses plus récentes réalisations, des collaborations avec le Cirque du Soleil ou Matthieu Chedid (avec lequel il a fait l’Olympia). Son plus récent album, « Pages blanches », a été publié en 2005.
Le clip du single “Ton amour est trop lourd”, extrait de l'album "Corcoran" (1990) :
Titus - Jim Corcoran, j'aimerais que cette interview soit l'occasion de faire le tour de votre carrière qui, comme on le sait, est très vaste. Vous êtes en effet ce qu'on pourrait appeler un multi-disciplinaire car outre la chanson, vous produisez des clips vidéo, vous êtes acteur à l'occasion et puis, vous êtes aussi, depuis des années, l'animateur d'une émission radio. On dirait que vous aimez régulièrement relever de nouveaux défis... Est-ce que c'est une manière de se pousser toujours plus loin ?
Jim Corcoran - Oui, en effet, et de demeurer heureux en ayant l'impression d'être utile. Quand on me propose quelque chose qui n'est pas évident, ça me plaît, parce que j'ai toujours l'impression que j'évite ainsi la routine.
Titus - Je faisais allusion à l'instant à votre émission de radio. Vous animez depuis des années en effet une émission sur le réseau anglophone de Radio Canada où vous présentez la chanson francophone à des auditeurs anglophones. D'où est partie cette démarche qui pouvait apparaître comme un grand défi ?
Oui, c'était un grand défi et, au début, je dois avouer que j'y croyais plus ou moins. C'est un producteur à Radio Canada, à la CBC, qui m'a proposé de faire quelques émissions et voir quelle allait être la réaction. J'étais intéressé et je trouvais que c'était une bonne idée, mais je ne savais pas si oui ou non il y avait un auditoire. Et l'émission existe maintenant depuis déjà sept ans et il y a une très bonne réponse. Il y a des Québécois expatriés qui l’écoutent, mais il y a aussi des anglophones qui sont très curieux de savoir ce qui se passe dans le monde francophone de la chanson et, les francophones de chaque province, qui sont très heureux d'en apprendre plus sur la chanson francophone. Je suis très heureux de pouvoir le faire...
Est-ce que ça partait aussi d'un désir de partager votre passion pour la langue française et la chanson francophone avec un public qui, traditionnellement, n'écoute pas ou peu la chanson francophone ?
Ça me plaît de pouvoir le faire et d'être entièrement libre. Je fais les choix, la recherche, le script et c'est moi qui anime l'émission. De cette façon, et je crois que c’est perceptible, ça se voit que j’affectionne beaucoup les artistes que je présente, leur musique et leur personnalité, leur contenu et leur poésie. Et je présente cette musique-là sans chauvinisme, sans dire aux anglophones que c’est la plus belle musique au monde. Je dis simplement que ça figure parmi ce qui mérite d’être écouté sur notre planète dans le domaine de la chanson populaire. C’est sans façon et c’est pour ça que l’auditoire demeure au rendez-vous, et attentif et curieux.
J’ai lu quelque part que vous vouliez prouver que cette musique est comestible.
Je suis anglophone d’origine et j’ai passé toute mon adolescence anglophone unilingue. Quand j’ai découvert la chanson francophone mondiale, j’ai trouvé ça extraordinaire. C’était tout à fait différent de ce que je connaissais. Je me suis ouvert à d’autres inspirations. J’étais fasciné et je crois que cette fascination perdure. Dans mon émission, j’essaye de la rendre contagieuse.

Je ne me positionne pas comme arbitre entre les deux solitudes et encore moins comme mascotte d’un côté ou de l’autre. Je suis souvent sollicité, par contre, pour participer à des débats et j’évite tout ça. Ce n’est pas mon rôle, pas ma passion, pas ma vocation.
Mais vous ouvrez des portes pour la musique francophone, non ?
Oui, on reçoit beaucoup de lettres. Les gens veulent avoir des précisions, des informations sur les artistes dont on parle. Ils veulent savoir où se procurer leurs disques… A ce niveau-là, je vois que je parviens à piquer la curiosité des auditeurs…
Et est-ce que cette émission vous a aussi permis de vous faire connaître en tant qu’auteur-compositeur francophone ou est-ce que vous ne parlez jamais de vous ?
Je parle très peu souvent de moi, et je me souviens, voilà deux ans et demi, d’être allé faire un spectacle à Vancouver. Dans la salle, il y avait trois ou quatre anglophones. Ils sont venus me voir à la fin en me disant qu’ils étaient là parce qu’ils voulaient réellement voir si c’était vrai que j’étais chanteur. Ils me connaissaient comme animateur à la radio, mais j’avais annoncé tout bonnement que j’allais être chez eux pour faire une scène. J’ai trouvé ça très drôle.
La chanson « Djeddhy Duvah (En chair et en os) » tiré de l'album Miss Kalabash (1986) :
Vous-même, qu’est-ce-qui vous a amené à apprécier autant la langue française ?
Je suis originaire de Sherbrooke, d’une famille anglophone d’origine irlandaise. J’ai quitté le Québec à l’âge de 13 ans et je suis allé terminer mes études secondaires à Boston. Ensuite, je me suis inscrit à l’université dans le New-Jersey. J’ai donc passé toutes ces années-là dans un milieu fermé, exclusivement anglophone. Quand je suis revenu au Québec, je n’avais pas d’attaches ; je n’avais plus vraiment de cercle d’amis, et j’étais libre de recommencer là où je voulais. On parle de 1970 et je dois avouer que j’étais un peu déçu des Etats-Unis. J’avais vécu la guerre du Viêt-Nam et plein de situations plus ou moins agréables dans l’évolution de la société américaine, qui me poussaient à m’en éloigner. Et j’ai découvert que, tout en restant en Amérique, mais en apprivoisant le fait français, je m’éloignais sans avoir à prendre l’avion. Cette fascination m’est venue de rencontres. J’ai rencontré des gens qui sont devenus des amis et qui demeurent des amis. Et c’est par fidélité à ces amitiés que j’ai aiguisé ma plume et que je n’ai jamais lâché mon apprentissage de la langue…
C’est quand même merveilleux d’arriver à apprivoiser la langue comme vous l’avez fait en quelques années. A quel moment avez-vous véritablement commencé à écrire en français ?
Je devais avoir 23 ou 24 ans. J’ai commencé mon apprentissage vers 19-20 ans. J’écrivais beaucoup, mais uniquement en anglais, et je me souviens de mes premiers textes en français. J’avais la trouille, j’avais vraiment peur parce que les personnes que j’admirais dans la chanson francophone étaient des poètes. Je me suis dit qu’avant de m’aventurer sur ce terrain-là, il fallait que je travaille beaucoup. Je suis arrivé de façon un peu subversive, en faisant des textes qui n’étaient pas réellement des textes, mais plutôt des collages d’images. Mais les gens m’encourageaient bien et insistaient pour que je sois un peu plus précis dans mon discours. Et j’ai ainsi osé écrire de véritables chansons, mais c’était à l’insistance des gens autour de moi. Moi, j’étais très heureux de voir que ce que je faisais ne choquait pas et pouvait être apprécié. Je n’en demandais pas moins car c’est ce que je voulais faire.

Absolument. Quand on était en tournée, je me retrouvais dans un milieu exclusivement francophone. C’était un véritable apprentissage, une école. Dans ces années-là, j’ai appris la scène, le rapport avec un public, l’écriture d’une chanson. Et de jour en jour, mon vocabulaire et ma compréhension de la culture francophone s’améliorait.
Est-ce à partir de cette expérience de duo que vous avez décidé de chanter en français pour la vie, ou était-ce encore un peu flou ?
J’ai commencé ma carrière dans la chanson un peu à reculons. Je n’ai jamais eu l’ambition de devenir celui que je suis devenu. J’étais aux études et je rêvais d’un doctorat en philosophie et c’est au moment où je préparais ma licence en philo et en français qu’un producteur m’a découvert, un peu comme dans les films… Il m’a proposé de faire un disque mais je ne pensais pour ma part qu’à étudier. J’aimais la musique mais je ne souhaitais pas faire carrière dans le monde de la chanson populaire, qui me semblait un milieu vide et superficiel. Il ne m’a pas harcelé, mais il est revenu plusieurs fois à la charge, pour voir si je n’avais pas changé d’idée. Et ce sont des copains qui m’ont convaincu, en me disant que je n’avais pas grand-chose à perdre puisque le producteur était prêt à financer le projet. Ils m’ont suggéré de faire le disque tout en continuant mes études. Je trouvais ça très curieux et n’y voyais pas grand intérêt. Je m’amusais mais je ne voyais pas la bonne raison pour réellement dépenser de l’argent pour documenter ce que j’avais écrit, mais j’ai fini par acquiescer. Et soudain, on m’invitait un peu partout au Québec : au Saguenay Lac Saint-Jean, en Abitibi, et même au festival Boréal à Sudbury, dans le Nord de l’Ontario. J’ai commencé à y prendre goût et il a fallu que je me rende à l’évidence : j’étais devenu un chanteur populaire. Et je ne détestais pas ça, en fin de compte.
Et qu’est-ce qui a provoqué le début de votre carrière solo, après les quelques années au côté de Bertrand Gosselin ? Etait-ce parce que vous aviez envie d’explorer d’autres genres musicaux ?
Absolument. Bertrand et moi, on a fait carrière ensemble pendant à peu près neuf ans. On a fait quatre microsillons ensemble, et on avait le sentiment, autant lui que moi, que ce qu’on avait à faire était fait. Et que l’honnêteté nous obligeait à voir ce que chacun pouvait faire sans l’autre. J’avais le goût d’autres associations, car c’est par les associations qu’on évolue. J’aime bien m’entourer de personnes que je considère supérieures à moi pour qu’ils me tirent vers le haut. C’est ce que j’ai fait. Je me suis associé avec des musiciens, des arrangeurs. J’allais dans des studios qui m’intimidaient un peu. Je me suis entouré de personnes qui m’obligeaient à évoluer plus rapidement. Je suis très heureux de cette décision-là.
« Welcome Soleil », en duo avec Bertrand Gosselin, en 1977
Vous avez déjà publié cinq albums en solo depuis 1981, le dernier étant « Zola à Vélo », sorti en 1994. Un album qui sera le point de départ d’une grande tournée au printemps.
La tournée est presque entamée. Hier, j’ai joué dans le métro à Montréal (rires). C’est une initiative assez particulière de l’Adisq et de la Commission des transports de Montréal. On veut amener plus de gens dans le métro et dire aux gens qui prennent le métro qu’il est important de fréquenter des salles de spectacle. Alors, j’étais là, entre les trains et les guichets, à chanter sur une belle scène bien éclairée et bien amplifiée. C’était très sympathique et, en quelque sorte, cela m’a permis de lancer une nouvelle tournée. On est trois musiciens, avec une dizaine d’instruments.
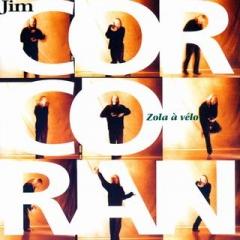
Je sais que ça a piqué la curiosité de plein de gens. Quand j’ai découvert qu’Emile Zola aimait beaucoup la bicyclette, j’ai trouvé ça très sympathique parce que j’avais l’image d’un type plutôt sérieux. J’avais du mal à l’imaginer sur un vélo. J’ai écrit la chanson « Zola à vélo » et je trouvais ça phonétiquement intéressant. Quand j’ai terminé le disque qui porte son nom, je me suis dit qu’il y avait des choses tout à fait récréatives, simples et sans façon, et d’autres choses qui ont plus de mordant, qui ont plus une résonance sociale. Un peu de Zola et un peu de vélo, en quelque sorte…
C’est un disque qui s’écoute d’un trait, un peu comme un film, et certains instrumentaux ponctuent aussi d’habile façon le déroulement de l’album. Je crois que cette démarche est nouvelle, chez vous…
Oui, c’était le concept, un mot un peu dangereux et un peu galvaudé depuis des années. Mais je voulais tisser les chansons sur cet album d’une autre façon. Je voulais les rapprocher et faire en sorte qu’il y ait un semblant de logique, un semblant de suite dans les thèmes, dans les textes. Cela peut être assez frustrant pour les radiodiffuseurs car il n’y a presque pas d’espace entre les chansons.
J’aimerais que l’on parle du morceau « Sen Nedgem », à la couleur si orientale…
J’étais fort inspiré par la musique égyptienne, arabe, quand j’étais en Egypte. J’y ai passé quelques semaines, voilà deux ans (en 1993, ndr), dans le cadre d’une émission de télévision pour Radio Canada, et j’ai passé plusieurs semaines au Caire, à Louxor, sur le Nil avec des Nubiens. J’ai chanté et j’ai même fait traduire une de mes chansons en arabe, en égyptien, et c’était pour moi réellement bouleversant de découvrir une culture, d’entendre une autre langue, une autre musique. J’ai été profondément inspiré par ces gens-là que j’ai trouvés merveilleux. En même temps, je suis inquiet par ce qui arrive et l’impossibilité d’une communication plus simple et humaine. J’ai voulu inclure un regard sonore sur l’album parce que ça m’habitait au moment où je l’ai composé.
Vous avez d’ailleurs fait appel à des musiciens arabes pour ce morceau…
Oui, ce qui fait que je pourrai difficilement la reproduire en spectacle. Le hasard a fait que ces musiciens étaient là et on a pu enregistrer le morceau ensemble.
Cet album est un peu « world beat » parce qu’on y trouve aussi un excellent musicien irlandais, Sean O’Rourke, qui joue de la flûte sur ce même morceau, et de la cornemuse sur la chanson « Souffle encore le rêve ». Cette chanson n’est-elle pas un clin d’œil à votre culture irlandaise à laquelle vous faisiez allusion un peu plus tôt ?
Tout à fait. D’ailleurs la musique a une nette saveur irlandaise. Le texte dit ceci : « Embrasse-moi sur la bouche et disloque l’anglo en moi ». Ça ne peut pas être plus clair ! (rires)
Est-ce que ces racines celtes ont de l’importance pour vous ?
De plus en plus, en fait. C’est curieux parce que, l’été passé, pour la première fois, j’ai rencontré Paddy Moloney, des Chieftains. Nous sommes allés à Grosse-Ile et on a passé beaucoup de temps ensemble à parler. J’ai vu leur spectacle et j’ai rencontré le groupe. Et je compte d’ailleurs faire des choses avec eux. Et il a allumé quelque chose en moi qui dormait. Je ne suis pas une personne nostalgique et je suis plus ou moins préoccupé par mes origines et mes racines. L’avenir m’intéresse plus. Par contre, je vois qu’il y a quelque chose qui était enfoui en moi. J’ai apprécié la musique et une sorte de vision des choses. Un sens de l’humour, un sens de la vie, un sens de la bière et de la bouffe (rires), qui est très irlandais.
J’ai noté que vous étiez passé aussi par Saint-Malo, en Bretagne, un autre pays celtique. Vous y avez aussi trouvé des affinités ?
J’ai participé à des festoù-noz, où l’on danse toute la nuit avec les binious et les cornemuses, même si on n’est pas un expert et si on ne connaît pas les pas de danse folklorique. On nous intègre rapidement et on insiste pour qu’on fasse partie du groupe. C’est fort « défoulatoire » et agréable et oui, je me suis retrouvé tout à fait à l’aise en tant qu’Irlandais chez les Bretons.
Certaines critiques ont souligné que votre dernier album était le plus accompli de votre carrière. Vous semblez y avoir mis beaucoup de vous-même.
Il faut pouvoir dire, de disque en disque, que le dernier est le meilleur. Quand les autres le disent, c’est encore plus satisfaisant (rires). Mais oui, j’ai osé m’affirmer davantage pour ce projet. Je me suis dit qu’après tant d’années d’apprentissage et d’efforts, il fallait oser plus. Arriver à plus de précision dans les textes et dans la musique. La musique a été enregistrée d’une autre façon, très humaine, très rapidement. Je n’ai pas voulu m’éterniser sur les détails ; je voulais que les sentiments soient clairs et sans détour. L’exercice de ce disque-là était pour moi une révélation.

Je suis très fidèle en amitié et j’ai rencontré Carl en 1982. On a fait ensemble mon premier disque, qui s’appelait « Plaisirs ». En ce temps-là, il habitait Memphis et c’est donc là que nous l’avions enregistré. Depuis, il a déménagé à Nashville, et le disque le plus récent, par contre, je l’ai entamé à Nashville et je l’ai complété à Montréal et à Morin Heights. J’aime bien Nashville, même si c’est une ville un peu terne. C’est une ville farcie d’excellents musiciens et techniciens. Il y a beaucoup trop de studios et on n’a que l’embarras du choix. J’aime bien m’y retrouver comme point de départ mais je ne tiens pas forcément à y aller. Je tiens davantage à être bien entouré et je pense que je n’ai pas dit mon dernier mot avec Carl Marsh. On s’entend très bien et on a encore plein de projets devant nous !
Beaucoup de critiques relèvent chez vous ce don de manier la langue française avec un certain bonheur. Et puisque le français n’est pas votre langue maternelle, est-ce que vous vous sentez plus libre, justement, pour expérimenter ?
On me dit que je joue avec les mots, par contre, j’écris parfois des choses sans savoir que ça ne se dit pas tout à fait comme ça. J’essaie d’éviter de jouer pour jouer, parce que ça finit par agacer. J’aime bien Prévert ; je trouve ça savoureux. Mais en même temps, je tiens à dire, avec franchise, ce que j’ai à dire. Et aussi, de laisser respirer la langue. Une langue vivante doit bouger, doit changer, doit pouvoir recevoir de nouvelles choses, et la langue française n’est pas une langue morte ! J’aime bien me surprendre et surprendre les autres avec l’emploi de la langue.
Est-ce que vous mettez beaucoup de temps à fignoler vos tournures de phrase ? La poésie est un travail d’orfèvre…
Je mets beaucoup de temps à peaufiner la plupart de mes textes et à m’assurer que c’est vraiment ce que je veux chanter. Par contre, je m’impose aussi une spontanéité. Il y a des choses qui doivent demeurer simples, sans quoi un disque deviendrait trop laborieux. J’essaie de trouver un équilibre entre la recherche et la spontanéité.
On sent que tout est musique aussi chez vous : le choix des mots, le rythme. Il y a toujours une sonorité qui est très musicale…
Et c’est même très strict. Les mots n’ont qu’une place dans la chanson ; je parle de la rythmique et de la mélodie. A ce niveau-là aussi, je m’impose de la rigueur parce que la langue française est un rythme à l’intérieur d’elle-même, qu’on doit respecter. L’accent des mots tombe à une certaine place, tandis qu’en anglais, c’est moins strict. J’essaie de respecter la rythmique de la langue sans avoir à modifier mes mélodies. C’est un jeu de compromis et d’entente entre le bagage musical que j’ai, qui est anglo-saxon et la réalité de la langue française.
De quoi part, le plus souvent, la création de vos chansons ?
Ce sont souvent des rencontres, ou un événement, qui sont le catalyseur, ma source d’inspiration. Quelque chose d’agréable ou de désagréable, de positif ou de négatif. Peu importe, du moment qu’il s’agisse de quelque chose de tangible et fort. Et ce sont le plus souvent des personnes. Il m’arrive aussi de me livrer à une introspection, où j’essaie de me rencontrer moi-même (rires). Ça m’est assez peu arrivé d’inventer une histoire et d’en faire une chanson. Je préfère me révéler, ou donner accès à moi-même dans ce que je dis en chanson. C’est pour moi le geste le plus honnête.

Non. J’écris quand même en anglais, tout bonnement. Je laisse aller l’inspiration et, si à un moment donné, je me vois écrire en anglais, je ne m’impose pas de censure et vice versa. J’ai vécu aux Etats-Unis, j’ai beaucoup voyagé, mais je trouve ça tellement satisfaisant quand on m’annonce que ma tournée va me conduire à Rimouski, Gaspé, Bruxelles, Genève ou Paris. Je me demande aussitôt quelle bouffe je vais pouvoir manger… C’est extraordinaire ! Si on m’annonçait des concerts à Cincinnati, Kansas ou Duluth, ça ne serait pas la même chose… C’est très personnel : ça n’est pas un jugement de valeur pour ceux qui veulent y aller, mais pour moi, ça ne représente absolument rien de romantique.
La chanson “Prête-moi ton regard”, extraite de l’album “Corcoran” (1990) :
Comment avez-vous été accueilli à l’étranger jusqu’ici ? On parlait tout à l’heure de la France, de la Belgique…
La Belgique, la Suisse et la France m’invitent, me reçoivent, et aussitôt qu’on m’invite, j’arrive. J’y vais très régulièrement en fait, mais je disparais trop vite. J’y vais surtout pour des festivals ; j’aime beaucoup ça. On me perçoit comme faisant une musique pas tout à fait alternative, mais pas « main stream » non plus. Et moi, ça me plaît beaucoup. On me connaît un peu, mais je n’y suis pas identifié comme faisant de la chanson populaire.
Propos recueillis par Titus au début de l’année 1995.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Le site officiel de l’artiste, chez Audiogram
Le site MySpace de Jim Corcoran
Le site de son fan club
La page Wikipédia dédiée à Jim Corcoran.

