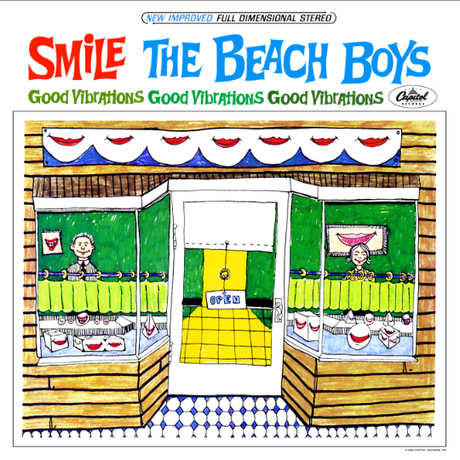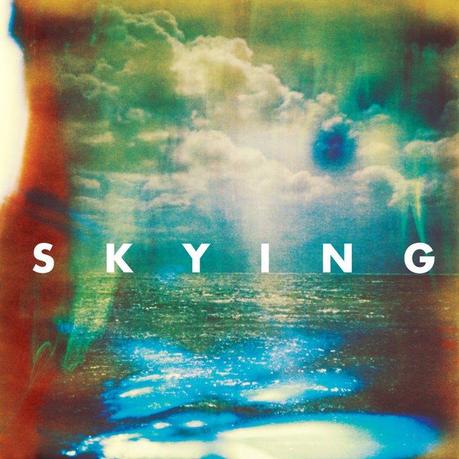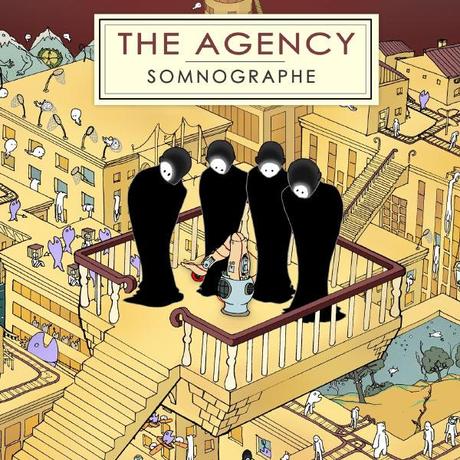Riche année 2011 ! Je songeais surtout à la musique et plus précisément au domaine du rock qui demeure ma seule compétence à ce jour et dont le triple A ne paraît aucunement menacé. Tout avait commencé mollement, puis l’actualité connut une accélération sans précédent.
Peu de révolutions sur le plan musical, certes, mais
quelque printemps arabe dans la relecture de l’idiome pop avec cette élégante riviera anglaise qui s’invita en France en longs ressacs synthétiques. Onnota également des phénomènes métérockologiques incontrôlés, des
tsunamis psychédéliques où les guitares se muaient en centrales électriques explosives ; merci aux Horrors pour leur troisième album en forme de bombe atomique. Certains groupes ou artiste se refugièrent dans un
classicisme quelque peu primaire mais au combien passionnant. Les conservatismes ont en général la vie dure mais ils demeurent souvent un aiguillon, un marqueur indélébile du Temps. Fleet Foxes et Jonathan Wilson se rappelèrent à cette vérité.
Le rock vécut aussi des coups de boutoir salvateurs, de grandes giclées soniques sans mobiliser ni peignoir, ni femme de chambre. Malgré leur nom relativement trompeur, les Girls appartiennent à cette catégorie tout comme le trublion solitaire du rock anglais, Miles Kane. Un album raide,
tendu comme une bite de Dominique au sortir de la douche. Puis le monde sombra dans le chaos monétaire. L’Europe subissait un effet « double détente » du nom de ce joyau pop signé par le très classieux français Alister. Alors que la crise frappait l’occident tout entier, le domaine de la santé publique n’était pas non plus épargné : la résurrection du chef-d’œuvre SMiLE, fruit du cerveau malade du gentil flanby Brian Wilson,
aussi efficace que 50 prises consécutives de Médiator, constitua à n’en point douter le moment le plus fort de l’année. D’autres albums émaillèrent ces derniers mois qui figurent aujourd’hui dans ce classement au cordeau. Oh, comme vous le constaterez rapidement, celui-ci ne respecte en aucun cas la chronologie des événements évoqués plus haut. Enfin, contrairement à d’autres rédactions cédant aux sirènes de la facilité avec des Top à rallonge, ce palmarès s’est efforcé d’extraire du magma rock
les 10 albums les plus réussis, des confirmations aux débuts prometteurs, des classiques hors du temps aux déclinaisons électroniques. Inutile de tergiverser, suspense oblige, il est temps de faire place au numéro 1…
Qui n’est autre que SMiLE des Beach Boys : vous trouverez peut-être étonnant de découvrir en tête du classement une réédition. La raison en est simple. SMiLE reste l’un des disques inachevés les plus légendaires de toute l’histoire de la pop music. Et il a fallu attendre quarante ans pour l’écouter dans sa forme originelle la plus aboutie. Malgré quelques passages aux paroles cryptées comme sur Vega-Tables, la suite de Pet Sounds fascine encore aujourd’hui par sa fraîcheur, sa sidérante acuité musicale qui en fait un classique éternel. Avec SMiLE, nous avons là un concurrent sérieux au sergent poivre des quatre de Liverpool. Certains jugeront le résultat imparfait ou le mixage mono peu en « accord » avec la complexité des arrangements, mais une chose est sûre : qui peut se targuer de produire, aujourd’hui, une telle œuvre dont les prises de risque permanentes apparaissent, avec le temps, aussi dingo que géniales. Ici se résume la dernière phrase/phase de la vie de Brian.
Juste derrière, le deuxième opus d’Alister : s’envoyer double détente, c’est un peu comme s’enfiler une double vodka. Premier effet, c’est classe, c’est frais. Deuxième effet, ça frappe, c’est fort. On se balance, on titube, on louvoie. Double détente, on est très loin du métrage avec Schwarzi et James Belushi. Nan, rien à voir. Le verbe, lui, semble sous l’emprise d’un double effet kiss pas cool. Synthèse admirable entre le Gainsbourg période Vu de l’extérieur et la pop contemporaine de Château Marmont qui produit l’album, cette deuxième livraison demeure un chef-d’œuvre dont la France de Bénabar ne peut que s’enorgueillir. De quoi réenchanter le rêve français.
The English Riviera de Metronomy aura été l’événement pop du printemps : personne de normalement constitué n’a pu passer à côté du phénomène, même la publicité s’est laissée séduire par le romantisme synthétique de The Look. Ce deuxième opus, plus écrit, a renvoyé Nights Out dans les oubliettes de l’électronique bon marché. Pour autant, les vieux réflexes ont la vie dure : Joseph Mount l’avait confessé qui commença la musique par l’apprentissage de la batterie. Il était donc logique d’inaugurer la pop par un rythme. Tout l’art du nouveau son de Metronomy est là. Une pop moderne équilibriste qui fait la jonction entre beats dansants (The Bay, Love Underlined) et mélodies sucrées (Everything Goes My Way). Metronomy ou l’élégance dancefloorée.
En quatrième position, Skyng de The Horrors : un rock organique au son massif ! Autant, ces mecs-là pouvaient agacer par leur maniérisme stylisé et leurs coupes de cheveux impossibles. Autant sur ce troisième album, ils atteignent un niveau de compréhension de l’histoire de la musique stupéfiant. Tous les genres se fondent dans un maelström sonore incroyablement dense, profond, lumineux au point qu’il devient difficile de distinguer nettement les influences malgré tout nombreuses. Les mélodies aussi languides que l’artwork impriment sur les IRM de la mémoire collective des visions solaires, des phosphènes harmoniques. Quant à l’objet, si l’on prend soin de se le procurer en version vinyle, sa beauté cartonnée vous prend aux tripes. Comme le reste d’ailleurs.
Dans la foulée, les Girls s’imposent avec Father, Son, Holy Ghost : sur ce deuxième disque ils prouvent qu’ils ne sont pas vraiment du genre fillettes. Ok, certaines chansons se dégustent comme des bonbons acidulés façon surf pop californienne (Honey Bunny, Magic, Saying I Love You). D’autres explorent de nouveaux univers : Die et son hard rock sauvage, Vomit et son gospel abrasif, Forgiveness et son romantisme électrique, Just A Song et son psychédélisme astral. Cet ensemble hétéroclite façon « catalogue du Rock, des premiers âges à nos jours » aurait pu déboussoler. Il n’en est rien. Au contraire. Le charme opère et transforme Father, Son, Holy Ghost et la famille au grand complet en classique immédiat. Cool en même temps qu’indispensable.
Face 2 du classement, le troubadour Jonathan Wilson : esprit gentil, oui, mais pas que. La folk n’est pas qu’une affaire de solitaire. Pour rompre la tradition monacale du folk singer alone avec sa guitare, Wilson convoque les meilleurs musiciens de studio de Laurel Canyon et couche treize titres virtuoses où l’électricité suavement domptée est reine. Le parti pris paraissait risqué, menaçant les chansons de tomber dans le travers un peu honteux de la jam poussive (pléonasme). Rien de cela ici. On plane dans un éther où les percussions sont des bruissements d’ailes, les riffs des cris d’aigle dans le désert. Loin de la relecture académique ou bêtement scolaire, Jonathan Wilson donne chair à cette musique dont rêvait Gram Parsons : un country rock spatial quasi acculturé tant il brasse les styles. Comme quoi, il est bon d’être enhardi par l’esprit de Laurel.
Comment ça, Helplessness Blues de Fleet Foxes en septième position ? J’en conviens, il s’agit d’une piquante provocation. Mais prenez les choses sous un angle différent. Le chiffre sept par exemple. Ne dit-on pas la septième merveille du monde ? En l’occurrence, cette deuxième livraison du quintet néo bab de Seattle émerveille son petit monde par la clarté de ses mélodies, la beauté de ses thèmes et ses audaces qui lui permettent de repousser les frontières d’un genre trop souvent balisé ; laissez-vous emporter par le final free du sublime The Shrine/An Argument. Ainsi, maîtrise, authenticité, vérité mais aussi générosité sont les maîtres mots de Helplessness Blues qui subjugue par sa limpidité presque irréelle, comme si le Moyen-Age le plus lointain était soudain propulsé dans le 21ème siècle. Magique.
Enchaînons sur le cas passionnant de Miles Kane et de Colour Of The Trap : la face cachée de Miles Kane pourrait être Alex Turner des Arctic Monkeys auquel il est souvent associé, autant dans l’image que dans les projets. Et pourtant. Avec son tout premier album solo, Miles Kane prouve qu’il est bien plus qu’un faire-valoir geek, un faux rejeton des Sixties anglaises. Entre tradition et modernité, la couleur de son piège attire l’auditeur pour ne plus le laisser s’échapper : ce que l’on appelle en langage drogué l’addiction. Et pour créer cette accoutumance, rien ne vaut le sacro saint format du single pop : deux minutes et trente secondes passées au prisme de la trinité Couplet/Refrain/Pont. Dans cet exercice simplement délicat (beaucoup s’y sont frottés et ont échoué), Kane fait montre d’un indéniable talent : Come Closer, Rearrange, Quicksand, Inhaler et le morceau titre sont là pour le prouver. Dans le pipe ? Non, dans les tubes !
Avant dernière place méritée pour le Somnographe de The agency : on aurait pu traiter le disque sous la forme la plus conventionnelle de la chronique, chose déjà faite d’où cette petite digression que me pardonneront certainement les trois musiciens de The agency. Pour goûter à leur musique frapadingue, il faut non pas les écouter sur disque (enfin si, car ils s’y montrent talentueux et audacieux) ni sur scène (attendez, en live, ils déchirent grave) mais les découvrir en interview. Pour les plus curieux, je vous invite à explorer les tréfonds de l’Internet. En farfouillant par-ci par-là, vous tomberez sur un entretien mené par le magazine Electro Choc. On y apprend que le clavier se surnomme Pataglu, qu’il porte un masque peu banal, source d’une inquiétude rampante pour la chroniqueuse. S’il fallait définir malgré tout leur musique, nous pourrions la résumer par ce slogan (normal, on parle de The agency) : « Go in Kiwiland, you will see » ou quelque chose comme ça.
Gardons le meilleur pour la fin, Audio Video Disco de Justice : pour la première fois, un album électro vient se glisser dans votre top ten mais là encore, pas de place au hasard. Les deux têtes pensantes de Justice ont imaginé Audio Video Disco comme un album concept. Pas tant dans les quelques textes disséminés puisqu’il s’agit d’un disque quasiment instrumental mais bien le traitement sonore et les enchaînements, sans hiatus. Ici, les machineries ont accouché d’une texture musicalement incarnée. On croit entendre de vraies guitares, de vraies batteries et certains titres font explicitement référence au Rock des années 70. Prog, glam, hard, toutes les familles ont été convoquées à ce banquet plantureux. On retrouve même dans Ohio un clin d’œil évident au Orléans de David Crosby, repris sur son premier album If I Could Only Remember My Name. Une fois n’est pas coutume, les tubes sont au rendez-vous : on jurerez entendre du Supertramp sur New Lands. Magistral.
Rappel et écoute…
Alors, pour les adeptes de la lecture en diagonale qui se priveront automatiquement des délices de ma prose, voici mon Top Ten en 2011 :
1/The Beach Boys, Smile
2/Alister, Double Détente
3/Metronomy, The English Riviera
4/The Horrors, Skying
5/Girls, Father, Son, Holy Ghost
6/Jonathan Wilson, Gentle Spirit
7/Fleet Foxes, Helplessness Blues
8/Miles Kane, Colour Of The Trap
9/The Agency, Somnographe
10/Justice, Audio Vidéo Disco
http://www.deezer.com/fr/music/playlist/66934562
10-01-2012 |
Envoyer |
Déposer un commentaire
| Lu
545 fois
|
Public
Ajoutez votre commentaire