Laure Bidal Dossier Anorexie
 Je me souviens très bien de la semaine où le retour en arrière n’a plus été possible. J’avais 17 ans. Brillante élève, j’étais en filière scientifique au secondaire «parce que ça ouvre toutes les portes.» Tu parles… Je détestais ça, moi qui, dans mon enfance, avais toujours un bouquin à la main et la tête dans les nuages.
Je me souviens très bien de la semaine où le retour en arrière n’a plus été possible. J’avais 17 ans. Brillante élève, j’étais en filière scientifique au secondaire «parce que ça ouvre toutes les portes.» Tu parles… Je détestais ça, moi qui, dans mon enfance, avais toujours un bouquin à la main et la tête dans les nuages.
C’était la fin des grandes vacances. Mes parents et mon frère étaient partis en vacance. J’avais déjà un peu maigri, je veillais à mon poids, je ne sais pas vraiment pourquoi.
Malgré la présence de mon chum et de mes copines, je me sentais seule, dans cette maison. J’aurais pu m’amuser, mais une grande vague de culpabilité est venue surveiller chacun de mes pas. La maladie a pris le contrôle de mon être et j’ai pris le contrôle de tout… surtout de ce que je mangeais. Tout ce qui m’échappait m’angoissait.
Descente vertigineuse
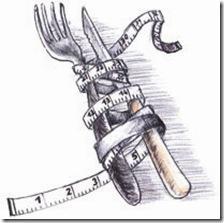
À l’heure où l’on devient adulte, je redevenais enfant. Je quittais mon corps. Pour rien au monde, je n’aurais échangé cette silhouette de fantôme. Je ne mangeais rien. Juste de quoi tenir debout.
Mes amies étaient désemparées. Ma mère hurlait, pleurait à me voir dépérir. Je gardais un sourire triste. «Tout allait bien.» Je refusais de mettre le mot «malade». Je refusais d’admettre qu’il y avait un problème. Je me nourrissais de l’ivresse des chiffres qui s’envolent sur la balance. J’exultais à sentir mon ventre vide.
Premier séjour en clinique
À y réfléchir, ces quelques mois n’ont pas existé. Un rêve, une chimère. Jusqu’à ce que j’obtienne ce que je cherchais tout en le fuyant: l’hospitalisation. J’avais perdu plus de 35 livres en trois mois. J’ai atterri dans une unité psychiatrique réservée aux adolescents, toutes pathologies confondues. Le choc a été rude. Certains hurlaient, d’autres se scarifiaient. Ce monde, je ne le connaissais pas, moi qui venais d’un milieu plutôt favorisé, moi qui avais toujours été «l’enfant épanouie».
J’ai passé quatre mois là-bas, à me plier aux activités, au rythme hospitalier, pendant que les autres personnes de mon âge allaient à l’école et faisaient la fête, le week-end. Le principe était simple: je devais atteindre 106 livres pour avoir le droit de sortir. Alors je les ai repris. Je clamais à qui voulait l’entendre que j’avais compris la leçon, que la vie valait la peine, que je me sentais guérie. C’est ce qu’on attendait de moi. Au fond, je gardais cette fascination pour la maigreur, et ce dégoût pour la chair.
Je suis sortie au printemps. La veille de ma majorité. Tout de suite, ç’a été la crise. Je suis retournée en cours. Je m’y suis sentie si mal que j’ai arrêté. C’était l’année du bac. J’allais le louper. Moi, la bonne élève. Je suis allée à certaines soirées arrosées, je ne pouvais rien boire à cause des calories. Mon cerveau était une calculette à calories. Ma vie n’avait plus aucun intérêt, si ce n’était de calculer.
Parents délateurs
Je passais mes journées à pleurer. Maigrir davantage. Me déchirer avec mes parents. Me taper la tête contre les murs. Vouloir mourir et en avoir peur en même temps. Je prenais pension chez mes grands-parents, ou chez des amis de la famille. Je m’étais mis en tête que tout était de la faute de ma mère. Je la détestais. Et je l’aimais si fort… trop fort. Je lui disais que j’allais mourir, pour tout le poids qu’elle avait posé sur mes épaules depuis ma naissance.
L’été est arrivé, j’avais un job dans une banque. Un jour, un psychiatre m’a appelé. Il travaillait à 300 kilomètres de chez moi. Il m’a simplement demandé «Ne pensez-vous pas que le temps est venu d’arrêter tout ça?» J’ai pesté contre mes parents, les délateurs. Je lui ai dit que je n’avais aucune envie de lui parler, j’ai raccroché. C’est lui qui allait m’aider à me sauver.
Un jour de la fin juin, j’ai dû me rendre chez mon médecin traitant, obligée par ma mère. Le médecin a poussé un cri d’horreur. Je pesais 77 livres, ma tension artérielle et mon pouls étaient si bas qu’elle m’a envoyée aux urgences. J’y ai passé une nuit, on m’a injectée toutes sortes de substances pour guérir mon coeur. Je me suis sentie tellement humiliée. J’avais l’impression de n’être rien, tellement rien…
«Mais pourquoi un tel entêtement?», me demanderez-vous. Voilà le cœur du problème. Je n’avais pas choisi. Cela me surpassait. C’est un cercle vicieux. Combien de fois ai-je décidé que tout était fini, que ça n’était pas sorcier de manger? Mais la maladie fait culpabiliser à chaque bouchée, elle associe toute nourriture à du poison. La volonté ne peut pas grand-chose face à elle. En face des personnes, filles ou garçons d’ailleurs, c’est l’incompréhension.
Par exemple, pour mes grands-parents, tous anciens paysans, et ayant connu la guerre, il était inconcevable, peut-être immoral, que je refuse cette nourriture dont ils ont parfois manquée. Ou encore, la douleur qu’a ressentie ma mère, qui ne parvenait pas à nourrir son propre enfant.
Et c’est reparti…
L’été de mes 18 ans, malgré mes «efforts», je me retrouvais à l’hôpital. Celui des adultes cette fois, dans le service de ce médecin qui m’avait appelée, à des centaines de kilomètres de chez moi. J’étais tellement faible… Je me suis résignée. J’ai été enfermée dans cette chambre lugubre, sans visites, sans courrier. Les plateaux repas partaient aussi pleins qu’ils entraient. Le médecin ne me forçait pas. Moi, j’étais désespérée, j’avais du mal à respirer, comme abrutie, incapable de tenir une conversation. Je voulais m’enfuir, mais je savais que ça ne me mènerait nulle part.
Mon amour propre? Envolé. Je n’étais personne. Je voulais ma mère. Avoir du courrier, ç’a été ma seule motivation au début, c’était la «carotte» pour reprendre du poids. J’y suis arrivée. Puis, j’ai franchi les étapes, une par une. Le droit de téléphoner, une visite, une sortie… Je devais réapprendre à vivre petit à petit.
Mon médecin m’a parlé de retourner en cours, quelques mois après mon entrée à l’hôpital. Je refusais. Je crevais de peur. Au début de l’hiver, j’ai puisé dans mes réserves de courage, et j’ai repris les cours dans un lycée que je ne connaissais pas, dans une ville que je ne connaissais pas. J’avais des activités à l’hôpital de jour. J’y ai fait des rencontres formidables, des personnes qui avaient eu une histoire similaire à la mienne. On pratiquait l’autodérision entre nous. Certaines sont restées mes amies bien après.
À ma sortie, je suis restée proche de l’hôpital. J’ai pris une chambre, j’étais indépendante. Tout n’a pas été parfait, mais j’ai fait mon petit bonhomme de chemin, loin de chez moi, j’ai affronté toutes mes peurs. J’ai eu mon bac, et je suis entrée dans la vie d’adulte. Pourtant, les crises d’angoisse qui sont apparues au début de ma maladie, ne m’ont jamais quittée.
Le maladie du siècle
Je pense que l’anorexie est un de ces «maux du siècle», comme on les appelle, de ces maladies propices à se développer dans nos sociétés actuelles. Sous l’abondance, le refus. Sous la pression de la réussite, le déni le plus total de son corps, de son être, le retour vers une enfance depuis longtemps finie.
Il est inutile de juger, comme les gens ont souvent tendance à le faire. Il s’agit d’une maladie qui n’a rien de «glamour». On perd ses cheveux, sa libido et son goût pour la vie. Des poils poussent, et l’on a froid lorsque tout le monde a chaud. Certaines femmes traversent leur vie entière dans ce néant. Étrangement, les anorexiques ne voient pas leur maigreur, même lorsqu’elle est effrayante. Cela s’appelle le dysmorphophobie.
L’anorexie, un mal pervers
On m’a dit un jour «c’est la maladie amie ennemie.» Malgré tout ce qu’elle fait souffrir, il est difficile de la laisser s’échapper, d’en faire son deuil. J’imagine que c’est le cas pour n’importe quelle dépendance. L’alcool, la drogue… le jeûne.
Aujourd’hui, j’ai 21 ans et ça va mieux. Ouais… Je n’ai toujours pas un rapport serein avec la nourriture, avec le plaisir, et j’ai toujours régulièrement ces bonnes vieilles crises d’angoisses incontrôlables. Mais, je sais à présent tenir la maladie à distance, et appeler à l’aide. Je me demande encore si je risque à nouveau quelque chose. J’ai retrouvé une vie, je fais des études dans le journalisme. Ça me va mieux que les sciences.
J’ai mis à distance ma mère, et j’ai un amoureux. Il supporte mes côtés sombres, il m’a fait comprendre qu’un talon d’Achille, on en a tous un. J’ai apprivoisé le mien, en attendant que le chevalier noir s’en aille pour de bon.

