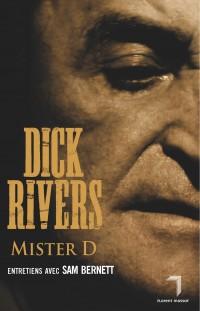 Exercice toujours périlleux que la biographie, entre en dire trop ou pas assez. La voie de l’entretien est un demi-mal parce qu’elle évite les interprétations et permet de se concentrer davantage sur des faits. Par contre c’est au lecteur de se livrer au travail de synthèse.
Exercice toujours périlleux que la biographie, entre en dire trop ou pas assez. La voie de l’entretien est un demi-mal parce qu’elle évite les interprétations et permet de se concentrer davantage sur des faits. Par contre c’est au lecteur de se livrer au travail de synthèse.Ce qui peut alors manquer c’est le recul de l’auteur, la mise en perspective avec des faits historiques ou sociaux susceptibles d’éclairer la carrière et la personnalité de l’interviewé. Sam Bernett contourne très habilement cet écueil en posant des questions qui vont au-delà de l’interrogation et qui amènent son interlocuteur à réfléchir et à se livrer sans occulter une réalité qui n’est pas toujours en sa faveur. De plus cela se lit facilement, sans qu’on soit abreuvé de détails qu’on ne saurait interpréter.
D’emblée Dick Rivers se positionne comparativement à Johnny et à Eddy pour la France (Elvis Presley restant plus un exemple qu’un rival) dont il ne juge même pas utile de donner les noms de famille. Tour à tour compétiteurs ou collègues, parfois presque amis, mais toujours challengers. Ce n’est pas en décryptant leur succès qu’il comprendra sa trajectoire.
En janvier 61 Dick quitte Nice dans une vieille Alfa Roméo avec ses potes pour monter à paris, presque un an après le premier disque de Johnny. Eddy Mitchell l’a également précédé de peu. De fait le chanteur va toujours se positionner comme le numéro 3, ce qu’il est d’un point de vue chronologique.
Sa vie bascule quand il entend Heartbeak Hotel comme l’apparition de la vierge pour Bernadette Soubirou (p.10). Il dit être aussitôt devenu « elvisien » de religion. Il lâche l’école pour le rock, mais il le fait avec sérieux. C’est à Elvis Presley qu’il doit sa vocation et d’avoir appris l’anglais.
Autodidacte talentueux, c’est un battant que la scène guérit -pour un temps- d’une timidité que l’on peine à admettre. Il éprouve un besoin maladif de reconnaissance (quel artiste y échappe ?) qui le pousse à l’hyperactivité. Chanteur, doubleur (il est la voix de Shere kan dans le Livre de la jungle II, le passeur d’Arthur et les minimoys), acteur (dans des films de Jean-Pierre Mocky), comédien (dans les paravents de Jean Genet, mis en scène par J.B. Sastre), il n’est jamais apaisé. Parce que la reconnaissance du public ne lui suffit pas et qu’il souffre de ne pas connaitre celle de ses pairs et des professionnels.
Pourquoi n’a-t-il pas compris que la multiplicité des dons provoque la jalousie et que son bonheur ne fera jamais pitié ? Que chacun, à son niveau, subit ce qu’il appelle des coups tordus ? Et que son complexe d’infériorité, bien réel au demeurant, ne le fait pas avancer, si ce n’est pour lui éviter la grosse tête, ce qui n’est déjà pas si mal.
Dick Rivers parle cash, sans langue de bois, balançant parfois, et se livre sans se cacher derrière les faux-semblants, au risque de lâcher quelques confidences qui ne sont pas glorieuses. Il s’avoue frileux dans ses entreprises et incapable de déléguer, sauf aux deux femmes de sa vie, Mouche et Babette, auxquelles il rend un sincère hommage. Mais c’est sans doute la dualité avec sa propre personnalité qui est la moins facile à gérer. Il parle de lui à la troisième personne, et en se heurtant à un quatrième larron, Hervé Fornéri, qui est le nom qu’il porte à l’état-civil.
Il aime apprendre, se dit curieux de toutes ces choses intellectuelles, ou spirituelles qui peuvent lui révéler des choses passionnantes et se définit comme un vampire du savoir (p.51).
On peut penser qu’être interprète de textes et de musique écrits par d’autres rend forcément dépendant, à l’inverse de chanteurs comme Bashung et Cabrel qui sont pour lui des amis et des modèles. Même si le chanteur s'en défend en estimant que le changement de parolier lui permet de se renouveler.
Ce livre est aussi un voyage dans les cinq dernières décennies. On mesure l’ampleur de la révolution que le marché du disque a subi, s’effondrant au profit du CD puis d’Internet. Mais aussi celle de la société toute entière et des rapports sociaux et humains : Avant, pour rappeler quelqu’un au téléphone, il fallait être soit au bureau, dans une cabine téléphonique, au restaurant, dans un café ou à la maison et les gars te rappelaient. Aujourd’hui ils ont leurs Smartphones jusqu’au fond de leur piscine et ils ne t’appellent pas ! (p.154)
Dick en est affecté ; il fait un bilan assez noir des gens qu’il ne voit plus (p.157) en exprimant combien il souffre de la solitude, … sans imaginer un instant le nombre de victimes de mode de vie marqué par la soit-disant communication. Et sans comprendre que son isolement (relatif) est peut-être la rançon d’une carrière qu’il a su et pu mener en solitaire. Peut-être les choses auraient-elles été différentes s’il s’était installé durablement au Texas pour y devenir le cow-boy d’Austin ou s’il avait élu domicile au Québec.
La sortie de la biographie est conjointe à celle d'un nouvel album, dont la pochette est strictement identique, Mister D(prononcer Di, cela lui fera plaisir), il y a quelques jours, le 31 octobre dernier, avec de magnifiques textes écrits par Jean Fauque (le parolier de Bashung) et Joseph d’Anvers. J’ai entendu Eric Naulleau le qualifier de phénoménal. Comme quoi Dick a tort en croyant que le microcosme ne songe pas à dire du bien de lui …
Après avoir lu cette biographie son public sera heureux de retrouver les accents alternativement rock, blues et country sur le CD puis en concert le 21 novembre 2011 au Casino de Paris et le 31 mars 2012 à l’Olympia.
Dick Rivers, Mister D, entretiens avec Sam Bernett, chez Florent Massot, 2011

