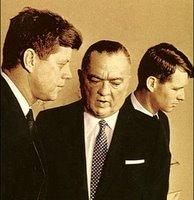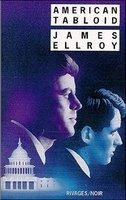
« L’Amérique n’a jamais été innocente. C’est au prix de notre pucelage que nous avons payé notre passage, sans un regret sur ce que nous laissons derrière nous. Nous avons perdu la grâce et il est impossible d’imputer notre chute à un seul évènement, une seule série de circonstances. Il est impossible de perdre ce qui manque à la conception.
La nostalgie de masse fait chavirer les têtes et les cœurs par son apologie d’un passé existant qui n’a jamais existé. Les hagiographes sanctifient les politiciens fourbes et trompeurs, ils réinventent leur geste opportuniste en autant de moments d’une grande portée morale. Notre ligne narrative ininterrompue se dissout dans le flou, laissant de côté toute vérité, toute sagesse rétrospective. Seule une vraisemblance impitoyable, sans souci des conséquences, peut redonner la vision nette de cette ligne dans toute sa rectitude.
La véritable trinité de Camelot était : de la Gueule, de la Poigne et de la Fesse. Jack Kennedy a été l’homme de paille mythologique d’une tranche de notre histoire particulièrement juteuse. Il avait du bagout, et arborait une coupe de cheveux classe internationale. C’était le Bill Clinton de con époque, moins l’œil espion des médias envahissants et quelques poignées de lard.
Jack s’est fait dessouder au moment propice pour lui assurer sa sainteté. Les mensonges continuent à tourbillonner autour de sa flamme éternelle. L’heure est venue de déloger son urne funéraire de son piédestal et de jeter la lumière sur quelques hommes qui ont accompagné son ascension et facilité sa chute.
Il y avait parmi eux des flics pourris, des artistes de l’extorsion et du chantage ; des rois du mouchard téléphonique, des soldats de fortune, des amuseurs publics pédés. Une seule de leurs existences eût-elle déviée de son cours, l’Histoire de l’Amérique n’existerait pas telle que nous la connaissons aujourd’hui.
L’heure est venue de démythifier toute une époque et de bâtir un nouveau mythe depuis le ruisseau jusqu’aux étoiles. L’heure est venue d’ouvrir grand les bras à des hommes mauvais et au prix qu’ils ont payé pour définir leur époque en secret.
A eux. »
(James Ellroy, American Tabloid)
L’Histoire de l’Amérique vue du caniveau, éclatée en bordure du trottoir. La fin d’une époque bénie.
Ellroy reprend là où il s’était arrêté avec le quatuor de Los Angeles, là où la conclusion apocalyptique de White Jazz nous avait menés, c'est-à-dire en 1958. Ce faisant, il élargit son spectre géographique, prenant pour terrain d’expérimentation le territoire américain entier ainsi que Cuba, pour s’élargir à l’Asie du Sud-est dans American Death Trip, sa suite directe, mais cela est une histoire qu’il conviendra de raconter plus tard.
Tout commence un 22 novembre 1958 pour se terminer le 22 novembre 1963 à Dallas, vous savez, avec « cet énorme putain de hurlement ».
American Tabloid est le récit de ces cinq années. Un millier de pages pour reconstituer, réinventer, démythifier pour trouver la « vérité » sur l’assassinat le plus célèbre de l’histoire américaine, le plus mystérieux. Point de téléologie s’il vous plait. Point de simplisme. Kennedy tel qu’en lui-même. Un baiseur, un charmeur, une ordure qui creusa sa propre tombe parce qu’il ne sut pas maintenir les alliances occultes qui l’avaient porté au pouvoir. Mafia, exilés cubains en partance pour la baie des cochons.
Il s’agit là d’une vraie manœuvre contre l’Histoire, dans ce qu’elle a de plus officiel et solennel, dans ce qu’elle a de plus mémoriel, à revers des représentations traditionnelles de cette époque, de celle d’une Amérique encore innocente, qui tente de construire une société plus juste et qui aurait trouvé en John Kennedy son héraut.
C’est là toute l’essence du projet Underworld USA entrepris par Ellroy.
La réalité qu’il nous donne à voir est tout autre. Entendons-nous bien pourtant, American Tabloid est une œuvre de fiction, mais toute coïncidence avec des faits réels impliquant des personnages existants est purement intentionnelle. On y croise aussi bien Hoover, les frères Kennedy, Jimmy Hoffa, Santos Trafficante, Sam Giancana , Jack Ruby, Oswald et tous ceux dont l’Histoire n’a pas retenu le nom, et qui ont fait cette Histoire, l’ont tachée de sang et repeinte de la couleur du Dieu Dollar.
Résumer l’intrigue tiendrait d’une épreuve que je serais bien en mal de résumer avec succès. Posons quelques jalons.
En 1958, la mafia cherche à faire grandir son emprise à l’intérieur du territoire américain du fait de son évincement de Cuba à la suite de la révolution castriste qui nationalise tous les casinos. Tous les américains sont alors expulsés de l’île. Mais ce n’est pas seulement un revers pour la maffia, mais aussi un revers stratégique de grande ampleur pour le FBI et la CIA. Les Etats-Unis voient le communisme s’installer à quelques kilomètres de leurs côtes.
Au même moment, Robert Kennedy, est à la tête du comité McClellan, dépendant du département de la justice,chargé de la lutte contre la corruption, contre le crime organisé et son représentant le plus emblématique, Jimmy Hoffa, président du syndicat des camionneurs, plus puissant syndicat américain, et aussi gigantesque machine à blanchiment d’argent pour la même maffia.
John Kennedy commence à représenter les espoirs du camp démocrate face à un Eisenhower vieillissant. Il incarne cette « nouvelle Amérique » jeune, dynamique, tournée vers l’avenir, qui veut en finir avec la politique à papa. Kennedy est brillant, il a du charisme, du bagout, de l’entrain, c’est un coureur de première, un menteur hors pair, un très grand orateur. Il a tout ce qu’il faut pour faire un bon président. Et en plus, il à l’air de vouloir de bouter les communistes et Castro hors de Cuba.
En espérant museler Robert en aidant Jack la Mafia finance une partie de la campagne Kennedy, fournissant de forts appuis, qui ne seront pas sans contrepartie.
Voilà le décor en 1958.
Au commencement, trois personnages :
Pete Bondurant, déjà rencontré dans White Jazz, maître de l’extorsion, deux mètres de brutalité, nervis d’un Howard Hugues en pleine capilotade.
Kemper Boyd, agent spécial du FBI, nervis de John Edgar Hoover, chargé d’infiltrer le clan Kennedy, et qui se prend au jeu. Occasionnellement barbouze pour la CIA.
Ward J. Littel, avocat, agent du FBI chargé d’enquêter sur les agissements communistes sur le territoire américain.
Ces trois hommes vont faire l’Histoire, allant de trahison en trahison, sans aucuns scrupules, nouant des alliances obscures, et représentent la part sombre de l’Amérique, celle qui fait la politique cachée sous le masque souriant de John Kennedy. Le destin de ses trois hommes se fond avec l’Histoire en mouvement, faite de sang et de stupre.
Car l’Histoire est affaire d’hommes, l’Histoire c’est le linge sale qu’on étend à sa fenêtre, et c’est cette dimension proprement humaine, aux grandes résonances shakespeariennes qu’Ellroy fait revivre avec intensité sous nos yeux.
Dans un récit extrêmement riche, détaillé, recherché jusqu’à la maniaquerie, Ellroy reconstitue tout un pan de l’Histoire Américaine mythifié, vitrifié par l’assassinat de John, puis par celui de Robert. Histoire de deux frères. Tout concorde, toute action effectuée en sous main a des répercussions pour l’œil du public, notre œil en somme. C’est la petite mécanique de l’Histoire américaine qu’Ellroy passe à la moulinette pour nous la servir en hors d’œuvre, sans artifice aucun. Avec le maximum de réalisme, en faisant entrer autant des représentations que nous avons de l’Histoire de ces années pour les faire chavirer. Ellroy ne pratique pas l’uchronie, ne fait pas œuvre d’historien, mais en faisant œuvre de romancier, il essaie de comprendre les hommes qui ont fait cette histoire.
Ellroy n’essaie pas d’avoir raison contre tous. Ellroy n’essaie pas d’avoir raison. Il déroule le fil de l’histoire par la fiction, comme d’autres avant lui ont pu le faire, questionnant la réalité, les motivations des hommes qui ont fait et font l’histoire. Les ombres en sont le moteur, et l’exergue du début de roman, reproduit au début de cette note, est là pour le rappeler.
La fiction n’est pas « plus vraie » que la réalité, elle ne s’y substitue pas, elle vient simplement la renforcer. Elle est là pour nous en donner une autre facette, pour en briser le miroir, et c’est au travers du prisme de ces éclats de verres que la réalité, fragmentée, peut nous apparaître. Sous une forme détournée, mais qui n’en est peut être pas moins « vraie ». Ellroy fait le trait entre des points isolés, le recours à la fiction n’invalide pas pour autant son raisonnement, et depuis un moment déjà la réalité vient corroborer ses intuitions de romancier.
Là où dans le Quatuor de Los Angeles Ellroy s’attachait à faire revivre sa ville, l’éclairant sous un jour nouveau, en dehors de représentations archétypales d’un âge d’or hollywoodien qui n’a jamais existé, où quelques uns étaient les rois, et où la criminalité moderne commençait à se développer, laboratoire gigantesque d’une Amérique en devenir, il fait vivre l’Amérique telle qu’en elle-même, à nu, sans illusion aucune sur elle-même. Une nation qui s’est fondé sur la violence ne peut que reproduire les mêmes schémas. Car c’est ainsi que le monde tourne. La politique n’a rien à y voir nous dit Ellroy, les idées ne sont que des idées. Ce qui importe, c’est le présent, et la manière dont on le transforme pour son propre intérêt. La réalité de ces cinq années, c’est un gros gâteau dont tout le monde voulait sa part, et tout le monde a sorti son colt pour en récolter les miettes….