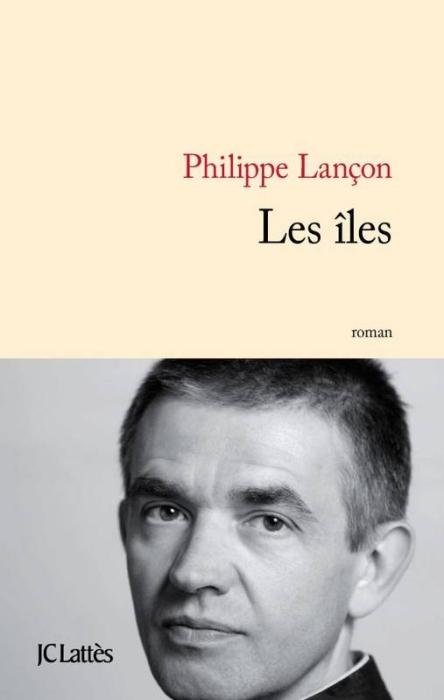
La grande tragédie de la vie n'est pas que l'homme périsse mais qu'il cesse d'aimer, écrit dans The Summing Up Sommerset Maugham dont l'ombre plane sur le dernier roman de Philippe Lançon (voir interview ci-dessous), écrivain que les lecteurs de Libération connaissent pour ses critiques littéraires érudites et franches.
Il est bon d'avoir en tête ces mots de l'homme de lettres britannique quand on entre dans Les îles, celles de Hong-Kong et de Cuba que le narrateur, un certain Philippe, connait bien. Dans ces deux morceaux de terre que tout semble séparer, il a conservé de solides amitiés.
Voici Marilyn, Alison, Jun et surtout Jad qui souffre d'un désordre dissociatif, une maladie dont on peine à comprendre toutes les manifestations. Mais qu'importe puisqu'il est bien question d'amour ici.
Je voudrais raconter ici son aventure telle que j'ai cru la vivre, ou plutôt telle que je l'ai vécue comme étant la mienne, la nôtre, celle de n'importe qui d'ignorant, de volontairement ignorant sur ceux qu'il aime – d'amitié ou d'amour.
La maladie de Jad permet, paradoxalement, de ne pas trop exposer au lecteur la jeune Hong-kongaise en voyage chez Fidel. C'est en fait lui-même que Philippe livre à notre regard.
La folie des autres est un égotisme : elle me renvoie au passé, à l'incompréhension, à l'imagination de moi-même.
Vient le temps des questions sur soi, sur la relation à l'autre. L'homme est une île pour l'homme semble nous dire Philippe dans une confession jamais impudique. Le narrateur est à l'image de cette Cuba qui n'a pas tourné la page Castro ou de cette Hong-Kong qui, à l'image de la Chine, cherche une place dans le monde. Philippe subit lui aussi la transition, comme ceux qui l'entourent.
Nous avions une famille, mais n'en avions fondé aucune. Quelque chose – mais quoi ? - nous avait rendus l'insularité native.
J'ai lu ce livre comme une tentative littéraire de dire l'entre-deux, sorte de no-man's land existentiel borné par la folie de Jad d'un côté et par une normalité confondante de l'autre. Entre ces deux pôles, il y a un groupe dans lequel gravite le narrateur.
La plupart des gens que nous fréquentions, et nous avec eux, se débattaient dans leur choix comme des enfants, à l'aveuglette, la mâchoire serrée en guise de jambe de bois. Se prendre au sérieux était la seule manière d'avancer sur cette route-là, mais je n'y arrivais pas.
Plus loin :
Dans un monde où le mensonge, la vanité et la vulgarité d'âme étaient la règle, la distance et la logique étaient les seules manières d'aborder les autres, soi-même devant les autres. Courtoisie et cohérence étaient les seules vertus possibles.
On retrouve ce goût pour la zone grise un peu plus loin, quand le narrateur évoque Proust.
pourquoi faisait-il du droit ? Par esprit de négation. Il voulait devenir avocat pour ne pas plaider, juge pour ne pas condamner, banquier pour ne pas manipuler d'argent, mais en sachant précisément comment faire tout ce qu'il ne ferait pas. Il voulait être compétent pour rien, « par goût de la vérité, car, même si cette vérité ne m'intéresse pas directement, toute vérité me concerne », c'était ce qu'il disait. Il n'avait pas de chauffeur, mais il ne conduisait pas. Assez vite, il avait découvert qu'il était pédé, mais il continuait à séduire des filles pour pouvoir les regarder dormir et souffrir de leur disparition, « comme Albertine ».
Si l'homme est une île, où est sa place : à l'intérieur ou en périphérie ?
Dans une île, presque tout est intérieur : il y a la mer, l'au-delà, et tout ce qui est ici et dont on ne sort pas.
Quelle attitude adopter pour continuer son chemin ? Philippe va chercher du côté de Longfellow, poète américain et son serendipity, alliance du hasard et de l'intuition, qui semble parfaitement s'adapter à la situation cubaine.
L'attente est l'état premier, à Cuba, un dissolvant de première qualité. Tous les détails se fondent dans les heures qui passent, qui pèsent, c'est comme si la mémoire ne devait jamais renaître de l'accablement qui suit.
Le personnage de Philippe m'a fait penser au Jeremy Irons de Chinese Box. Sauf que dans ce film, l'acteur principal s'éteint parce qu'il ne peut plus lutter et que la maladie se rappelle sans cesse à son mauvais souvenir. Philippe, lui, efface les traces, se libère progressivement d'un poids :
je rends à l'oubli la plupart de mes prises .(...) J'entre dans les souvenirs de Jad dans la mesure où les miens ont disparu.
Et quand il parle de la mort, c'est lorsqu'il évoque le beau, ici Sommerset Maugham :
On pourrait mourir en lisant cela.
La littérature empêche-t-elle le naufrage ? Assurément non à voir Jad dont l'état devient tellement préoccupant que le narrateur se met à chercher de l'aide dans les milieux diplomatiques, eux aussi empreints de vulgarité :
En général, ces gens n'avaient rien lu, ou ils avaient oublié. Le temps des diplomates cultivés semblait fini. L'économie et les grâces du pouvoir, seules, leur importeraient. Etais-ce regrettable ? Observons quelques écrivains-diplomates, me disais-je pour me consoler, en les regardant sous les palmiers blanchis par l'éclairage nocturne : Paul Claudel, Sina-John Perse, Paul Morand. Cela ne consolait de rien : trois admirables crapules endimanchées, eux aussi, trois as de la mesquinerie mensongère. On en voulait bien en livre, mais en photo... La littérature n'excusait rien, ne concluait rien. Un monde sans écrivains rendait fou, un monde sans diplomates n'existait pas. C'était la seule conclusion possible.
Pour Jad, l'heure de la conclusion n'a pas encore sonné. Mais la chute se poursuit à l'hôpital, moment où l'on patiente dans une île où l'attente est l'état premier pour reprendre les mots de Philippe. La pause, c'est le temps où les choses se remettent en place, avant de repartir comme avant. A moins que le cours de l'histoire ne se mette à changer. Rien ne permet de trancher. Car le livre s'achève sur cet état transitoire, nouvel entre-deux.
Avions-nous voyagé pour apprendre à être heureux chez nous ? Ou parce que nous n'étions pas heureux chez nous ? Ou parce que « chez nous » n'existait plus ? Ou encore parce que nous sentions, le bonheur étant ce gibier introuvable, ce dahu, qu'il fallait voyager d'un même mouvement pour le chasser et pour le fuir ? Que pouvait-on apprendre en voyage si l'on n'était pas heureux chez soi ? Jad, elle, voyageait pour se détendre d'un travail épuisant, pour se divertir. A Cuba, peut-être avait-elle brusquement retrouvé cette virginité des yeux dont parlait Alain. Peut-être avait-elle vu, non pas une bête, mais la bête, celle qui dormait au cœur du cœur de son enfance. C'était trop dire, pourtant. Le mot « bête » était trop bête pour décrire ce qu'elle avait pu voir, et qui n'était qu'une petit chose mate, misérable, étouffante, un animal mesquin, aux mouvements répétitifs, qui s'ébattait au ralenti dans une chambre de deux mètres sur trois, entre des draps sales, au fond d'une île tropicale.
En scriptant ces phrases me vient en mémoire la scène finale de Johnny got his gun de Dalton Trumbo. Le monde continue sa course folle pendant que dans la pénombre d'une chambre un être seul attend.
Voici donc l'interview que m'a accordée Philippe Lançon au mois d'août. Bonne écoute.

