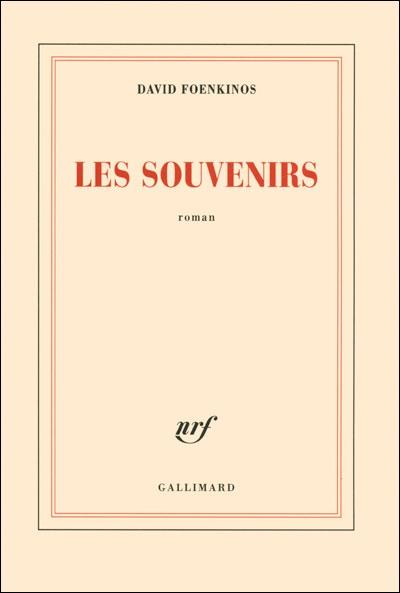
Dans Marino Faliero, Lord Byron fait dire à un de ses personnages que le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur ; le souvenir de la douleur est de la douleur encore. Il me semble que cette phrase pourrait servir de fil rouge au dernier roman de David Foenkinos.
La douleur donc : elle est présente dès les premières pages du livre : le narrateur vient de perdre son père. Ce personnage à la fois joyeux et facétieux vient de succomber à une chute dans sa salle de bain : maudite savonnette.
Et moi, j'aimais être son petit-fils. Mon enfance est une boîte pleine de souvenirs. Je pourrais en raconter tellement, mais ça n'est pas le sujet du livre. Disons que le livre peut commencer ainsi, en tout cas. Par une scène du jardin du Luxembourg où nous allions régulièrement voir Guignol.
Dans l'interview qu'il m'a accordée (voir ci-dessous), David Foenkinos revient sur cette troisième phrase pour le moins curieuse. Car comment comprendre que Les souvenirs ne soient pas un livre sur les souvenirs ? Sans doute faut-il y voir une volonté de l'auteur de ne pas emprisonner son roman dans un genre. C'est du moins comme cela que je l'ai compris.
L'écrivain ne souhaite pas plus enfermer ses personnages dans une catégorie. Ainsi, on sent bien que le défunt grand-père était un personnage haut en couleurs, un pater familias au grand cœur qui semblait prendre un malin plaisir à éprouver quotidiennement les nerfs de son meilleur souffre-douleur : sa femme.
Ils se disputaient, se regardaient méchamment, et pourtant jamais ils n'ont passé une journée l'un sans l'autre. Jamais ils n'ont connu le mode d'emploi de la vie autonome. Les disputes avaient le don de souligner le sentiment d'être vivant. On meurt sûrement plus vite dans l'harmonie conjugale.
David Foenkinos raconte en fait une éclosion. A partir de la mort du grand-père plus rien ne sera comme avant, un autre âge succède à celui de l'innocence. L'entrée dans le monde adulte s'accélère avec la prise de conscience de la disparition, donc de la gravité.
Pendant les jours qui ont suivi, j'ai été un étranger dans ma vie. J'étais là, je vivais, mais j'étais comme irrémédiablement attaché à la mort de mon grand-père. Puis les douleurs s'échappent. J'ai pensé à lui de moins en moins souvent, et maintenant il navigue paisiblement dans ma mémoire, mais je n'éprouve plus le poids au cœur des premiers temps. Je crois même ne plus ressentir de tristesse. La vie est une machine à explorer notre insensibilité. On survit si bien aux morts. C'est toujours étrange de se dire que l'on peut continuer à avancer, même amputés de nos amours. Les jours nouveaux arrivent, et je leur disais bonjour.
Il y a aussi dans ce changement de vie l'apprentissage de la responsabilité. C'est en effet le narrateur qui va prendre en mains sa grand-mère, devenue veuve. Elle est placée dans un foyer pour personnes âgées après avoir obtenu de ses trois fils l’assurance qu’ils ne vendront pas sa maison.Commence une vie bien terne au milieu d’autres pensionnaires qui attendent à leur tour la mort. Le personnel, lui, est partagé entre le renoncement et la méchanceté comme cette hôtesse d'accueil qui inspire les mots suivants au narrateur :
Elle avait un côté 1942, mais du mauvais côté de 1942. Elle disait qu'elle attendait la retraite avec impatience, et j'avais envie de lui dire de prendre une chambre tout de suite ici. Je trouvais ça fou qu'une femme qui baignait ainsi dans la déchéance humaine soit si pressée d'accélérer le mouvement.
Les souvenirs des personnages connus (on citera par exemple Kawabata : Nous avons été frappés par la mort, et cela nous donne l'obligation d'aimer) s'intercalent très finement dans cette histoire familiale sans jamais casser la « dynamique » du texte. Car dans ce roman d'apprentissage, le narrateur poursuit son éveil. Une nouvelle étape est franchie lorsqu'il rencontre une jeune fille lors des obsèques de son grand-père.
A ce moment-là, ma vie amoureuse consistait à me rendre régulièrement dans un cimetière (je passe sur l'aspect symbolique).
La vie sentimentale du narrateur fait parfois écho à celle de ses parents. Commence alors un flash-back où l’on retrouve le père disant à sa future femme, lors d'un premier rendez-vous : vous êtes tellement belle que je préférerais ne jamais vous revoir. Il y a assurément beaucoup de grâce dans ce livre de David Foenkinos et, sans mauvais jeux de mots, de la délicatesse.
Les mots avançaient vers moi avec la grâce de leur invisibilité.
La légèreté ne dispense pas un certain questionnement chez le narrateur qui prend de l'épaisseur au fil des pages. Jamais il n’est en dehors du monde, jamais il ne traverse insensiblement son temps. Sans être un livre à thèse, ce roman capte l'esprit d'une époque et le confronte à celui de générations anciennes tout en évitant le « c'était quand même mieux avant ».
Je faisais partie de mon époque, ce temps où aucune idée n'est plus suffisamment forte pour nous lier les uns aux autres.
Le narrateur se responsabilise encore un peu plus lorsque, de façon presque concomitante, sa propre mère se met à débloquer et sa grand-mère disparaît de son foyer pour aller en Normandie, à la recherche d'une ancienne amie, Alice, sans doute atteinte de la maladie d'Alzheimer (Alzheimer que l'on retrouve aussi dans les souvenirs de « personnalités »).
Parti à sa recherche, le narrateur fait la connaissance d'une nouvelle jeune femme, Louise qui va prendre une place centrale dans sa vie, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas casser l'effet de surprise du lecteur. Cette énième étape coïncide avec le passage à l'écriture.
ça n'excitait plus grand monde. L'écriture était devenue quelque chose de si commun. Tout le monde écrivait. On entendait dire qu'il y avait plus d'écrivains que de lecteurs. Les jeunes filles, j'en avais fait l'expérience, n'étaient plus vraiment admiratives d'un jeune homme obnubilé par un projet littéraire.
C'est Gérard qui fait basculer le narrateur vers l'écriture. Patron d'un hôtel dans lequel travaille le personnage principal du roman, il est donc l'un de ceux qui changent la trajectoire de vie du « héros » heureux de pouvoir s'adonner à sa passion sur son lieu d'activité.
Il n'y avait aucun bruit dans l'hôtel. Pour un Taliban du niveau sonore comme moi, cela représentait les conditions idéales du sommeil.
Dans ce dernier opus, David Foenkinos maintient l'attention du lecteur en recourant avec parcimonie à des rebondissements comme lorsque la mère du narrateur rencontre un professeur d'allemand (cela donne lieu à un échange de propos assez incroyables avec le mari). Et puis, il y aura un coup de théâtre final concernant ces mêmes parents qui contraste avec la situation sentimentale du personnage principal. Lequel se laisse aller à des confidences fortement teintées de gravité.
Quelle idiotie d'attendre en permanence l'affection de ses parents ; il suffisait qu'ils vous jettent un petit os pour qu'on le ronge joyeusement en remuant la queue.
Quelques pages plus loin.
J'avais accumulé suffisamment de passé et d'expérience pour pouvoir sourire du désastre.
L'innocence prend officiellement fin lorsque la nouvelle panoplie est complètement endossée. L'enfant du début qui a perdu son grand-père, a vu ses parents s'entre-déchirer, ses relations sentimentales se compliquer, donne à ce moment-là l'impression de renoncer. En fait, il n'en est rien. Le narrateur a « simplement » appris à encaisser la douleur, ce qui est peut-être la vraie marque de reconnaissance des adultes. Encaisser, pas accepter. Car chez David Foenkinos, il y a certes le désespoir mais l'énergie qui en résulte.
Je me souviens du jour où quelque chose s'est débloqué en moi. C'était comme si j'avais accumulé la mélancolie nécessaire à l'écriture. Oui, c'est sûrement à cet instant que mes mots sont venus enfin.
Il ne s'agit pas d'un discours de battant, ni d'un « mode d'emploi ». L'auteur ne prétend pas dire une vérité universelle.
C'est juste la vie d'un homme de tous les jours. Et c'est très bien comme ça.

