Le tapis rouge maintes fois foulé a été rangé, les Planches se sont brusquement vidés des festivaliers qui les arpentaient continuellement, inlassablement, le grand Ecran qui diffusait les arrivées à l’extérieur du CID, parfois involontairement burlesques, a disparu, les affiches de films ont été pliées, les flashs se sont éteints, le soleil même s’est brusquement éclipsé… comme si tout cela n’avait été qu’un songe. Le festival menace de s’évanouir dans les brumes de mes souvenirs où il subsiste encore, là seulement. Evanoui comme un rêve. Un rêve dans lequel on ne rêve que de replonger, fouillant dans sa mémoire jusqu’à la nausée pour en retrouver la saveur indicible, les sensations indescriptibles pourtant, les souvenirs épars, les instants magiques. Comme à l’issue d’un rêve il ne me reste que des bribes de souvenirs donc, des images parfois floues ou 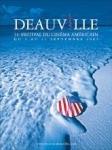 imprécises, l’essentiel en tout cas, la nostalgie aussi, malgré tout. Et les instants magiques alors ? Ce sont bien souvent eux que l’on poursuit inlassablement dans un festival, ce qui le singularise, le différencie d’une simple projection dans une salle obscure, désespérément obscure. Des instants magiques, inénarrables, incroyables même : depuis 12 ans ce festival m’en a procuré une multitude à ne plus savoir qu’en faire, à rêver éternellement. Cette année le festival les a distribués avec parcimonie, ils n’en avaient donc que plus de valeur. Inestimable. D’un festival on se réveille endoloris après cette griserie éphémère et non moins intense. Soif insatiable d’une septième art euphorisant. Soif insatiable d’instants magiques, encore. Et puis la douce sensation que cela durera éternellement, que les journées s’écouleront invariablement au rythme des projections, des soirées, des promenades revigorantes sur les Planches, des débats interminables sur les films projetés, pourtant la réalité reprend son cours. Restent les souvenirs, images inaltérables.
imprécises, l’essentiel en tout cas, la nostalgie aussi, malgré tout. Et les instants magiques alors ? Ce sont bien souvent eux que l’on poursuit inlassablement dans un festival, ce qui le singularise, le différencie d’une simple projection dans une salle obscure, désespérément obscure. Des instants magiques, inénarrables, incroyables même : depuis 12 ans ce festival m’en a procuré une multitude à ne plus savoir qu’en faire, à rêver éternellement. Cette année le festival les a distribués avec parcimonie, ils n’en avaient donc que plus de valeur. Inestimable. D’un festival on se réveille endoloris après cette griserie éphémère et non moins intense. Soif insatiable d’une septième art euphorisant. Soif insatiable d’instants magiques, encore. Et puis la douce sensation que cela durera éternellement, que les journées s’écouleront invariablement au rythme des projections, des soirées, des promenades revigorantes sur les Planches, des débats interminables sur les films projetés, pourtant la réalité reprend son cours. Restent les souvenirs, images inaltérables.
Flash back. Jeudi 1er septembre
Une certaine fébrilité s’empare de Deauville dont la sérénité mélancolique se mue peu à peu en une joyeuse effervescence. A la table d’à côté, un célèbre acteur de théâtre dîne en famille. J’observe que ses mains effectuent le geste machinal caractéristique de l’homme politique qu’il a récemment et brillamment incarné dans Le promeneur du champ de Mars de Guédiguian. J’aimerais aussi lui parler de Ionesco qu’il a

Vendredi 2 septembre
Devant le CID et devant le Normandy et le Royal, les badauds commencent à s’agglutiner, pour voir, entrevoir, y être, le dire, le faire savoir, pour demander des autographes et parfois le nom de leurs signataires ensuite. Les festivaliers, quant à eux, sont enjoués, encore, c’est normal c’est le début du festival, les prémisses de dix journées pendant lesquels ils auront bien le temps de tout critiquer, de feindre d’être blasés. Le soir venu arrive la cérémonie d’ouverture. Présenté par l’impayable Laurent Weil, elle débute par un hommage à Waguih Takla, l’irremplaçable présentateur et traducteur du festival qui donnait à chaque conférence de presse un ton si particulier, qui contribuait à l’atmosphère si conviviale de ce festival. Avec lui le festival a perdu beaucoup et un peu de sa personnalité. Ton affecté et visage de circonstance de Laurent Weil puis « the show must go on », évidemment. Avec la cérémonie d’ouverture c’est l’éternel discours des fondateurs du festival : André Halimi et Lionel Chouchan. 31 ème discours même. Les membres du jury, un jury uniquement français sont présentés (leur président Alain Corneau, Dominique Blanc, Romane Bohringer, Rachida Brakni, Brigitte Roüan, EnkiBilal, Christophe, Dominik Moll , Melvil Poupaud) et en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis le festival est déclaré ouvert. Puis, c’est l’heure du film d’ouverture Matador de Richard Shepard dont le titre nous promet un spectacle haletant, un face-à-face palpitant avec la mort, malheureusement un bon titre ne suffit pas, fut-il allégorique. Dans ce film qui mêle comédie et polar et se déroule essentiellement au Mexique, Richard Shepard nous conte la rencontre a priori incongrue entre un tueur à gage cynique et alcoolique (Pierce Brosnan) et un homme d’affaire timide et maladroit (Greg Kinnear). Ce film de genre et ce genre de film se doit d’être particulièrement bien écrit pour que le cocktail soit efficace. Le contre-emploi ne sied pas forcément à Bond /Brosnan malgré les efforts certains déployés par celui-ci pour être laid, drôle, pathétique. Reste le courage de la parodie et quelques scènes pour dérider les spectateurs, encore peu exigeants en ce début de festival.
Samedi 3 septembre
La conférence de presse de Matador (photo de Pierce Brosnan en conférence de presse ci-contre,© Sandra.M ) par laquelle je commence la journée aurait d’ailleurs été aussi pathétiquement ennuyeuse et convenue (évocation de sa société de production « Irish dream time » par Pierce Brosnan, société créée avec Beau Saint-Clair, l’évocation de l’ambiance forcément incroyable du tournage, Pierce Brosnan acceptant tout d’après le réalisateur et trouvant parfois des idées et les tournant deux heures plus tard etc), avec sa traditionnelle question sur James Bond et la non moins traditionnelle réponse de son ancien interprète (ancien donc et apparemment définitivement ancien…malgré une réponse teintée d’amertume et l’évocation de ces « 10

Puis, je vais me promener sur les Planches, mon rituel quotidien dont j’ignore encore s’il est kantien (comprendront ceux qui sont allés voir le film de Karin Albou La petite Jérusalem évoqué ci-dessous) dont je ne me lasse pas du spectacle. Le festival se trouve là aussi. Le président de l’Assemblée Nationale faisant son jogging matinal y croise des revenants de la télé réalité se croyant indispensables au spectacle, croyant l’exhibition de leur désoeuvrement nécessaire au bon déroulement du festival.
La projection suivante est celle de Broken Flowers de Jim Jarmush que j’avais déjà vu à Cannes, qui figure d’ailleurs certainement parmi les meilleurs films du festival de Deauville, et pas forcément parmi ceux du festival de Cannes (voir ma critique dans la rubrique « Festival de Cannes 2005 »), cela vous laisse entrevoir le hiatus qui subsiste encore et peut-être plus que jamais entre les deux festivals.
Le soir, le festival a décidé de rendre hommage à Robert Towne, prolifique et talentueux scénariste, ayant notamment réalisé Tequila Sunrise et signé les scénarii de La firme, Mission impossible (1 et 2), ou ayant encore collaboré à l’écriture du Parrain. C’est avec Chinatown qu’il obtiendra l’Oscar du meilleur scénario en 1975. Roman Polanski était donc particulièrement indiqué pour venir lui rendre hommage, étrange hommage d’ailleurs qui consiste à conter une anecdote sur le chien de Robert Towne, qui laisse ledit Robert Towne et le public quelque peu perplexes, voire embarrassés, face à un Roman Polanski inhabituellement enthousiaste.
A cet hommage succède la projection de The Ice harvest de Harold Ramis, encore un film hybride, mélange de comédie et de film policier, dont son réalisateur est friand ayant déjà réalisé Mafia Blues présenté en avant-première à Deauville en 1999. Dans celui-ci il nous raconte une histoire aux rebondissements improbables dont John Cusack, Billy Bob Thornton et Connie Nielsen interprètent les personnages principaux, respectivement un avocat sans scrupules et son associé qui viennent de dérober deux millions de dollars au roi de la Pègre de Kansas City. Le premier espère quitter la ville avec Renata la gérante du club de strip-tease local... Ce film semble être l’emblème d’une Amérique qui hésite entre le rire et les larmes, l’ironie ou le désespoir. A son image, son cinéma même ne veut pas choisir. Un film classique (trop) au scénario confus et inégal qui contraste avec l’hommage déjanté de Roman Polanski à Robert Towne.
Dimanche 4 septembre
Depuis 3 ans, le festival a également la bonne idée de présenter des documentaires « Les docs de l’oncle Sam ». Malgré le soleil qui incite plutôt à déambuler sur les Planches et à ne pas déroger à mon rituel kantien, en cinéphile imperturbable que je suis, je me décide donc courageusement pour Grizzly man de W.Herzog qui retrace le portrait de Timothy Treadwell qui a vécu régulièrement au milieu des redoutables grizzlys sauvages d’Alaska par lesquels lui et sa compagne seront finalement dévorés, dénouement symbolique d’une nature impitoyable que personne ne peut maîtriser ou dompter. Tout au long du documentaire on s’interroge

La journée s’achève par la projection de Kiss kiss, bang bang de Shane Black dont c’est le premier long-métrage en tant que réalisateur. Robert Downey Jr y interprète un voleur en fuite qui se retrouve accidentellement au milieu d’un casting de polar hollywoodien. Pour préparer son rôle il fait équipe avec un détective privé (Val Kilmer) et une comédienne en herbe (Michelle Monaghan). Ils se retrouveront finalement impliqués dans une réelle affaire de meurtre. Troisième « comédie policière » ou « polar comique » du festival ou censé l’être comme vous préférez. Certes, Shane Black s’amuse allègrement à détourner les règles et les archétypes du film noir, certes le trio d’acteurs est particulièrement efficace, mais voilà une bonne idée, voire une idée originale, ne suffisent pas toujours. A trop vouloir « ne pas dire comme les autres », on finit par ne plus rien dire. Un film qui ravira peut-être les amateurs du genre qui auront plaisir à être déroutés, mais qui pourrait bien ennuyer fermement les autres…

Lundi 5 septembre
Début de la compétition donc. L’atmosphère est différente: l’enjeu est important pour ces réalisateurs qui présentent bien souvent leurs premiers films. Tel est d’ailleurs le cas du premier film de la compétition, Crash (Collision) réalisé par Paul Haggis, auteur du dernier film de Clint Eastwood Million dollar baby. Avant d’être celle des véhicules de ses protagonistes, cette collision est d’abord celle de destins qui s’entremêlent, s’entrechoquent : une femme au foyer et son mari procureur, deux inspecteurs de police, un réalisateur de télévision et sa femme, un serrurier mexicain, un voleur de voitures, une nouvelle recrue de la police, un couple de coréens. En 36 heures, tous ces destins vont basculer. Vers l’ombre ou la lumière. L’effroi souvent, avant. A priori leur seul point commun est de vivre à Los Angeles, d’être confrontés à la même incommunicabilité, à la

Le film suivant de la compétition ( The ballad of Jack and Rose de Rebecca Miller, fille du célèbre dramaturge) évoque aussi des heurts. La confrontation est ici d’abord celle de Rose avec la maîtresse de son père, Jack, avec lequel elle vivait éloignée du monde sur une île déserte jusqu’à ce que celui-ci fasse venir cette dernière et sa famille. Jack, ancien membre d’une communauté hippie est un être épris d’idéaux, Rose exprime la violence des idéaux de l’adolescence. Les deux s’entrechoquent aussi. Film troublant sur une période troublée. Les situations basculent néanmoins brusquement (trop), les réactions sont excessives (trop)…même si elles sont révélatrices de cette époque de l’adolescence à fleur de peau, de ses tourments, ses excès. Le film oscille constamment entre innocence et amour interdit. Rebecca Miller semble hésiter entre classicisme et transgression. Reste un film inégal et hésitant, troublant aussi, l’implicite admirablement filmé, le portrait d’une relation père/fille en demi-teinte intense et ambiguë, et la magistrale interprétation de Daniel Day Lewis en père aux dernières lueurs de sa vie, troublé par sa fille, elle, bouleversée par les dernières lueurs de l’enfance…
When will I be loved est ensuite précédé d’un hommage à son réalisateur James Toback auteur de Mélodie pour un tueur dont Jacques Audiard s’est inspiré pour De battre mon cœur s’est arrêté. Après avoir célébré pendant des années les monstres sacrés du cinéma américain, cette année Deauville a décidé de mettre à l’honneur un cinéma plus confidentiel. Dans When will I be loved, Vera (Neve Campbell) partage sa vie avec Ford, un jeune escroc qui utilise les femmes afin de devenir riche et célèbre. Il pense faire fortune le jour où il rencontre le comte Tommaso Lupo, un vieillissant milliardaire italien. Ce dernier est prêt à débourser 100000 dollars afin de passer une nuit avec Vera. Un remake de proposition indécente, vous dîtes-vous certainement ? Non, non, attention, le film se veut indépendant, moderne, post-moderne même. Oui mais voilà à trop vouloir transgresser et se démarquer on finit par digresser inutilement… Le personnage de Neve Campbell qui y joue « de l’amour et du hasard » davantage qu’elle ne se demande « When will I be loved » y est néanmoins ambigu et machiavélique à souhait. Pour cela et cela seulement…
La soirée s’achève par le dernier film de Lasse Hallström An unfinished life, lequel était déjà venu présenter L’œuvre de Dieu, la part du diable à Deauville, en 1999. On y retrouve la même photographie soignée, on y trouve encore un générique alléchant : Morgan Freeman, Robert Redford, Jennifer Lopez. « An unfinished life » n’est malheureusement qu’un film très classique qui se veut être une belle et démonstrative illustration du pardon : si le meilleur ami (Morgan Freeman) de Einar (Robert Redford) pardonne à un ours de l’avoir estropié, ayant lui-même pardonné à Einar de ne pas l’avoir secouru pour cause d’état éthylique, Einar peut bien pardonner à sa belle fille (Jennifer Lopez) d’avoir causé l’accident qui a engendré la mort de son fils… !?! Simple, voire simpliste et surtout moralisateur. Ajoutez à cela le « jeu »totalement inexpressif de Jennifer Lopez, et ne reste qu’une belle carte postale du Wyoming dans lequel s’époumonent et soliloquent deux monstres sacrés du cinéma qui s’y sont inexplicablement égarés…
Mardi 6 septembre.
La journée débute par le 3ème film de la compétition The Brick de Rian Johson. Deauville et ses films indépendants affectionnent le thème de l’adolescence, la radiographie de ses errements et ses dérives. Si The Brick met également en scène des adolescents, cela relève avant tout de la volonté de son réalisateur, selon ses propres termes de « dépoussiérer les conventions d’un genre ». « J’ai voulu faire une detective story en revisitant les codes du genre de manière inédite en prenant à contre-pied les règles établies ». Dans The Brick un lycéen

Profitant de sa présence opportune en Europe où il y tourne actuellement la très secrète adaptation du Da Vinci Code, le festival a décidé d’honorer Ron Howard, réalisateur notamment d' Apollo 13, Un homme d’exception ... La tâche incombe au producteur Irwin Winkler avant que Ron Howard, dans un discours interminable, ne le remercie, ainsi que Deauville, les autorités, et semble-t-il toutes les personnes ayant croisé sa route. Y succèdent des extraits des films de Ron Howard avec en « exclusivité mondiale » la très efficace bande annonce du « Da Vinci Code »…Puis après une standing ovation avortée et spontanément…recommandée par la présentatrice c’est l’heure de l’avant-première de son dernier film Cinderella man , littéralement « l’homme Cendrillon », en français titré « De l’ombre à la lumière ». C’est en effet un véritable conte de fées, l’itinéraire d’un autre « homme d’exception » inspiré de l’histoire vraie du boxeur Jim Braddock (Russell Crowe). La carrière prometteuse de celui-ci est en effet brusquement interrompue par une blessure. Un malheur n’arrivant jamais seul, nous sommes en 1929, c’est la crise économique et Braddock , contraint d’accepter les tâches les plus ingrates pour nourrir sa famille, sombre dans la misère. Evidemment si cela s’achevait là, cela ne serait pas un « Cinderella man », ce ne serait pas un conte de fées, ce ne serait pas un film de Ron Howard, l’American Dream virerait inhabituellement au cauchemar. Mais un jour son agent lui décroche un ultime combat. Jim ayant la rage au cœur et une famille à nourrir, forcément, l’obscurité cède peu à peu la place à la lumière. Evidemment l’intérêt du film ne réside pas là, le titre ayant désamorcé tout suspense quant au dénouement…et les spectateurs avertis que nous sommes savent que la déchéance n’est dépeinte que pour exacerber la jubilation de la réussite, et valoriser l’American Dream, encore, toujours. L’intérêt réside plutôt dans les combats de boxe , filmés de telle manière que Ron Howard nous entraîne dans la subjectivité de son héros, son universel combat pour la survie et la dignité créant alors l’empathie puis la sympathie du spectateur qu’il soit ou non, amateur de boxe. Evidemment ce film n’est pas vraiment un coup de poing dans un cinéma qui a déjà filmé la boxe sous toutes les coutures, comme le démontre l’hommage rendu par ce 31ème festival aux films la célébrant. Le cinéma américain aime tout particulièrement filmer et glorifier ces histoires de revanche sur la vie, de combativité humaine et sportive comme Goal à la fin du festival (voir plus bas) ou le poignant La légende de Seabiscuit de Gary Ross présenté au festival de Deauville en 2003. Cinderella man vient de connaître un échec retentissant Outre-Atlantique: à une période où l’Amérique est plus fébrile, et fragile que jamais, probablement les histoires à la Capra proclamant que la « vie est belle »paraissent-elles incongrues, voire indécentes. Ron Howard se déclare ainsi « attiré par les histoires qui célèbrent les petits instants de grâce humaine » voulant « capturer » ces instants et les insérer dans ces histoires »...
La grâce (l’instant magique donc) est davantage présente et bouleversante quand on ne l’attend pas, quand elle n’est pas (télé)commandée, c’est donc probablement pourquoi elle surgit davantage du film suivant : Everything is illuminated , premier film de Liev Screiber qui nous entraîne sur les traces de Jonhatan (étonnant Elijah Wood) qui se rend en Ukraine pour retrouver la femme qui sauva son grand-père durant l’invasion nazie. Le cinéma compte de grands films sur le devoir de mémoire…oui, peut-être mais ces films n’en demeurent pas moins nécessaires et périlleux. Nuit et brouillard de Resnais, Shoah de Lanzmann, La liste de Schindler de Spielberg, La vie est belle de Benigni…des films si différents et non moins nécessaires. La mémoire et le souvenir sont volatiles, les pérenniser est un des plus beaux combats. Un combat en douceur, implicite, sans emphase, sans grandiloquence, une narration limpide…et d’autant plus efficace. Un film non dénué d’humour et poignant entre couleurs froides et chatoyantes, entre passé obscur et présent illuminé par sa révélation, entre oubli et culpabilité fatale.
Mercredi 7 septembre
Forty shades of blue d'Ira Sachs est le cinquième film de la compétition et il arrive auréolé du prix du jury à Sundance. C’est avant tout le portrait de Laura, une jeune femme russe, vivant à Memphis avec son mari, Alan, célèbre producteur de musique et leur fils de 3 ans. Leur vie confortable mais teintée de solitude, est un jour troublée par l’arrivée du premier fils d’Alan, Michael, du même âge que Laura…Il est de ces films qui vous entraînent, vous charment, vous envahissent, sans que vous sachiez très bien pourquoi. « Forty shades of blue » est de ceux-là. Chaque minute du film, sa musique, son montage, ses couleurs bleutées et crépusculaires portent l’empreinte de la solitude et témoignent de l’enfermement de son héroïne. Les silences pesants, les regards qui disent, mentent, taisent, constituent un véritable dialogue que certains jugeront trop elliptique mais qui ravira les amateurs d’implicite qui préfèrent les nuances (=shade) du bleu au manichéisme du noir et blanc.
Avec Reefer madness d’Andy Fickman , deuxième film en compétition de la journée, en revanche l’implicite n’a pas sa place. Du silence implicite on passe de la musique explicite puisque d’une comédie musicale il s’agit, une comédie musicale sur les effets et les méfaits de la marijuana. Cette fois la dérision et l’extravagance sont au

La projection du soir c’est Elisabethtown de Cameron Crowe (Rencontres à Elisabethtown), aucun festivalier ne peut l’ignorer. Depuis deux jours, des pancartes sont affichées partout dans le CID indiquant que tout téléphone portable sera confisqué, ordre du distributeur dudit film craignant le piratage. Le téléphone portable étant un peu un deuxième cerveau pour beaucoup (ou un premier, c’est selon), des menaces de rébellion planent sur le CID, toute projection débutant déjà par les sifflement de spectateurs mécontents se voyant interdire l’utilisation de leur appareil photo dans l’enceinte du CID pendant tout le festival. Ce film est annoncé comme le meilleur du festival. Au souvenir de Jerry Maguire et de Vanilla sky, je reste dubitative mais le festivalier étant un être sans préjugés, (surtout le festivalier ayant précédemment vu et retenu la leçon de « Crash ») je me rends à Elisabethtown avec bienveillance, les neurones dubitatifs en sommeil. Rarement un film m’aura pourtant paru aussi interminable et insipide (probablement parce-que je n’avais pas encore vu « Bea season » projeté le lendemain…) Cela commençait pourtant plutôt bien : Drew (Orlando Bloom) a créé une chaussure de sport dont le lancement imminent pourrait bien être l’échec du siècle. A trois jours de la médiatisation de son échec, Drew apprend que son père vient de mourir et qu’il doit se rendre à Elisabethtown dans le Kentucky afin de régler les détails des funérailles. En chemin, il rencontre Claire (Kirsten Dunst), une hôtesse enjouée, dont rien ne semble pouvoir entamer l’optimisme… Kirsten Dunst venue présenter le film avec son réalisateur Cameron Crowe à Deauville paraissant aussi enjouée que son personnage, je m’attends donc à passer un bon moment, d’autant plus que ledit Cameron (euh Crowe... pas Diaz comme le suggérèrent mes voisins dans la salle) exprima son désir d’aller à l’encontre des films glorifiant l’American Dream. Si la rencontre entre ces deux personnages antagonistes promet d’abord d’être intéressante, voire explosive, le film sombre bientôt dans la mièvrerie,( tout enjeu disparaissant une fois les deux personnages réunis aux premières minutes d'un film qui en compte 132) et le spectateur dans le sommeil, notamment un célèbre écrivain, d'ailleurs plus célèbre qu'écrivain somnolant sur le siège d'à côté. Dommage car une réelle alchimie existe entre les deux acteurs, le dialogue amoureux au téléphone et le voyage avec l’urne funéraire auraient pu être amusants et inventifs … Et puis M. Cameron (Crowe, donc pas Diaz), pourquoi avoir cédé à la happy end et plonger dans l’American Dream contre lequel vous disiez vouloir aller, sa fameuse chaussure de sport devenant un succès planétaire ? Je ne vous engage pas vraiment à vous rendre à Elisabethtown… vous voilà prévenus !
Jeudi 8 septembre
Dans Pretty persuasion de Marcos Siega, septième film de la compétition, Kimberly Joyce, brillante adolescente de Beverly Hills à la fois manipulatrice, extrêmement drôle, foncièrement cruelle et naturellement sexy, ne recule devant rien pour devenir célèbre. Elle convainc ses deux meilleures amies de témoigner contre leur professeur… La critique des Etats-Unis se voudrait acerbe, les réflexions cinglantes, l’humour décapant mais à trop vouloir montrer ses intentions on finit par les rendre caduques et surtout American Beauty était déjà passé par là… Le machiavélisme de l’héroïne est tellement caricatural qu’elle en deviendrait presque sympathique. Le réalisateur qui signe ici son premier long-métrage a beaucoup travaillé pour la télévision, probablement est-ce la raison pour laquelle Pretty persuasion ressemble davantage à une série pour les adolescents qu’à un long-métrage…Le film n’est néanmoins pas totalement inintéressant, sauvé par quelques répliques très actuelles, et politiquement incorrectes et par le jeu de Evan Rachel Wood, déjà remarquée dans le très réussi Thirteen présenté à Deauville en compétition, en 2003.
Avec Keane de Lodge Kerrigan, produit par Steven Soderbergh, l’autre film de la compétition de la journée, c’est un autre univers dans lequel nous nous trouvons immergés, par lequel nous sommes inexorablement saisis. Le regard de Keane semble accroché au nôtre, à la caméra, et semble s’en emparer comme d’une bouée de sauvetage, et ne plus pouvoir s’en détacher, ou bien l’inverse nous sentant les témoins impuissants de sa douleur indicible. William (Damian Lexis) est un père qui tente d’accepter l’inacceptable, la disparition de son enfant de six ans, six mois plus tôt, à New York. Il se retrouve face à ses démons, ses remords, ses angoisses, la vacuité de son existence. La caméra à l’épaule de Lodge Kerigan ne le quitte pas une seconde, la tension (et l’attention) est constante. Elle cherche et vacille avec lui, égaré dans New York, indifférente à sa détresse. A tout moment il menace de sombrer dans l’inéluctable, l’irréversible. Puis, il se lie d’amitié avec une mère célibataire et sa petite

Avec Bee season, de Scott McGehee et David Siegel l’avant-première du soir, notre tension (et attention là aussi) retombent franchement. Eliza Naumann, onze ans, vient d’une famille bourgeoise instable. Son père, Saul, un professeur d’Université, lui préfère son frère, et sa mère, Miriam, une scientifique, absorbée par sa carrière. Lorsqu’elle s’inscrit à un tournoi d’orthographe, sa famille est persuadée de son échec mais, à leur grande surprise, elle gagne. Son nouveau talent lui ouvre de nouvelles portes et les sollicitations se font de plus en plus nombreuses. Sur fond de quête mystique de chacun de ses membres, les deux réalisateurs traitent de la cellule familiale non sans une certaine maladresse. On s’oriente d’abord vers les atermoiements d’un enfant surdoué, ce qui aurait pu être intéressant…puis les égarements de sa mère qui culpabilisent à la mort de ses parents. Enfin, les réalisateurs semblent se focaliser sur la perfection apparente de chacun qui finit par éclater et révéler les fêlures d’une existence apparemment irréprochable. L’Homme est fragile, n’est pas infaillible, et ne peut être heureux que s’il l’accepte s’évertuent à nous démontrer les deux réalisateurs (il fallait bien être deux pour cela et faire appel au couple Gere/Binoche) non sans nous avoir infligé d’interminables concours d’orthographes. Pourtant annoncée, Juliette Binoche n’a pas fait le déplacement à Deauville, bien qu’également à l’affiche de « Mary » d’Abel Ferrara, présenté le lendemain…Dommage que Scott McGehee et David Siegel n’aient pas su davantage mettre à profit leurs talents de réalisateurs qu’ils avaient démontré dans The deep end présenté à Deauville en 2001, et que ce « thriller mystique » n’ait choisi ni l’un ni l’autre pour finalement n’appartenir à aucun genre...à moins que ce ne soit celui des films de concours d’orthographe, par ses réalisateurs initié.
Mon esprit virevolte déjà et mes jambes le suivent bientôt pour guider ma petite personne vers le restaurant l’Etrier de l’hôtel Royal, toute entière invitée au dîner du prix littéraire cette année remis au toujours sémillant Budd Schulberg, malgré ses 91 ans. Ce dernier a notamment écrit le scénario oscarisé de Sur les quais d’Elia

Vendredi 9 septembre
L’avant-dernier film en compétition du festival On the outs de Lori Silverbush et de Michael Skolnik se déroule dans un quartier de Jersey City où se croisent les destins de trois adolescentes. Dans un univers qui broie leur identité, parfois leur dignité, elles tenteront de passer à l’âge adulte. Avec elles le spectateur s’enfonce avec effroi dans un tunnel qui paraît inextricable, un cercle vicieux dont l’issue paraît impossible, pourtant au dénouement de cet âpre parcours initiatique pour l’une d’elles se trouvera la lumière. Les deux réalisateurs filment leurs destins croisés et le cadre dans lequel elles évoluent avec une précision presque documentaire. Certaines scènes sont bouleversantes, et si d’autres peuvent paraître plus artificielles, l’intérêt demeure constant pour ces trois personnages blessés, désorientés, brillamment portés par les trois comédiennes et une équipe de film enthousiaste que nous avons eu beaucoup de plaisir à croiser pendant tout le festival à Deauville.
Le festival s’est écoulé à une vitesse fulgurante et arrive déjà le dernier film en compétition Edmond de Stuart Gordon, tiré d’une pièce de David Mamet, brillante référence pour un film qui ne l’est malheureusement pas autant, également malgré la présence de William H. Macy dont l’interprétation avait déjà beaucoup marqué les festivaliers dans Lady chance, présenté en compétition, en 2003, à Deauville. S’il interprète ici aussi un personnage à la dérive, ses motivations sont beaucoup moins crédibles tant ses actions sont caricaturales. Après avoir consulté une voyante, Edmond Burke (William H.Macy donc), un cadre supérieur policé et marié, réalise qu’il a toujours mené une vie banale et monotone. Sous le choc de cette révélation, il décide de quitter l’ennui rassurant de son foyer pour les bas-fonds de la ville… Aucun cliché ne nous est épargné et une noirceur qui se voudrait humoristique les rend encore plus pathétiques et vains. Son revirement est tellement brusque et excessif que bien vite notre attention s’en détache. Dommage, le sujet, éminemment cinématographique, était intéressant. La distanciation du spectateur est aussi importante que son implication l’était dans Keane. La différence s’appelle peut-être la modestie ou le talent… Stuart Gordon, spécialisé dans le cinéma horrifique pense visiblement que la terreur est forcément synonyme d’hémoglobine. Probablement parce-qu’il n’a jamais croisé le regard de Keane qui hantera pourtant le spectateur bien longtemps après la projection, bien plus que les scènes sanguinolentes d’Edmond.
Avec Moi, toi et tous les autres , son premier long-métrage, c’est un tout autre univers que nous invite à découvrir l’actrice, scénariste, réalisatrice, Miranda July, et déjà tout simplement à « un univers » qui la caractérise d’emblée, qui ne ressemble à aucun autre. Elle y interprète (filme et scénarise aussi donc) Christine Jesperson, une jeune artiste touchante et spontanée, qui mélange dans son quotidien, art et réalité. Richard Swersey, vendeur de chaussures, père de deux garçons et tout juste redevenu célibataire, est prêt à tenter de nouvelles expériences. Mais quand Christine entre sur la pointe des pieds dans sa vie, il panique… Dès les premières images, nous sommes envoûtés par ce monde qu’elle retrace, qui est le nôtre et pas tout à fait, plutôt le nôtre vu par le prisme de son singulier regard. La difficulté de communiquer est là encore au centre de l’histoire. Les moyens de communiquer n’ont jamais été aussi rapides et nombreux et pourtant la communication s’avère plus difficile que jamais avec ces « tous les autres » plus proches et plus lointains qu’ils ne l’ont jamais été, le paradoxe d’une mondialisation qui enferme plus qu’elle n’ouvre au monde et aux autres, un paradoxe que mettent en lumière et en images nombre de films de cette 31ème édition, un des maux de ce 21ème siècle et de ses balbutiements. A une célérité déconcertante tout peut alors basculer dans l’interdit ou la poésie, et Miranda July n’oublie ni l’un, ni l’autre. L’art contemporain auquel s’est adonnée la réalisatrice et que pratique son personnage principal imprègne également fortement le film et lui procure cet aspect iconoclaste, celui d’une œuvre lunaire et riche, à la fois poétique et réaliste, en tout cas attrayante du début à la fin, nous hypnotisant comme un œuvre d’art moderne, aux contours et au signifié flous dont on ne demande qu’à percer le délicieux mystère… Entre l’art et la réalité, pourquoi faudrait-il choisir ? Pourquoi ne pas faire de sa vie un art ? Le plus

La magie ne s’estompe pas avec la séance suivante puisqu’elle est précédée d’un hommage au charismatique Forest Whitaker. Après avoir joué dans une dizaine de films ( Good morning Vietnam, Bird, Prêt-à-porter, The crying game, Ghost dog, Panic room, etc), il est passé à la réalisation en 1995, sa dernière et troisième réalisation « Des étoiles plein les yeux »datant de 2004. Forest Whitaker est visiblement particulièrement ému de l’hommage que lui rend le festival, malgré un discours qui semble ne pas avoir été écrit par son lecteur, Alain Corneau, celui-ci ne devant initialement pas rendre cet hommage. L’émotion de Forest Whitaker n’en demeure pas moins prégnante. Forest Whitaker lui répond en déclarant faire ce métier pour « les instants magiques » comme ceux-là. Lui aussi. Réminiscence d’autres instants magiques : les larmes d’Al Pacino, l’émotion de Morgan Freeman, l’enthousiasme de Johnny Depp, les facéties de Robin Williams, la prestance de Clint Eastwood, la grâce de Lauren Bacall…et tant d’autres encore que j’ai vu défiler et s’émouvoir sue cette scène du CID. Mais revenons au présent à Forest Whitaker, je vous l’avais dit, je m’égare toujours ! Cet hommage n’est pas la seule raison de la présence de Forest Whitaker, puisqu’il est également présent à Deauville pour présenter Mary d’Abel Ferrara dans lequel il tient un des rôles principaux.
Abel Ferrara, après Venise, est visiblement très heureux de venir présenter son dernier film à Deauville, et ne tarit pas d’éloges sur Forest Whitaker et Juliette Binoche qui, pour lui « demeurera toujours Marie-Madeleine ». Elle y incarne en effet Marie Palesti, une actrice, qui incarne elle-même Marie Madeleine pour le cinéma et qui reste illuminée par ce personnage. Tony Childress (Matthew Modine), réalisateur joue Jésus Christ dans son propre film. Ted Younger (Forest Whitaker), célèbre journaliste, anime une émission télévisée sur la foi. Entre fascinations et quêtes spirituelles, le destin les réunira… Trois destins, trois lieux (New York, Jérusalem, et Rome) qui s’entrecroisent et s’entrelacent par une mise en abyme et par leurs questionnements. Questionnements artistiques, mystiques, existentialistes : ceux d’un cinéaste intraitable qui ressemble étrangement à Ferrara, ceux d’une actrice imprégnée du biblique personnage qu’elle a interprété, ceux d’un journaliste face aux conséquences de sa vie chaotique. C’est leur conscience et ses doutes qui réunit ou sépare ces trois destins. La rédemption est au bout du chemin de croix jalonné d’images fortes, entre série B et trouvailles auteuristes. Le monde de Ferrara ne ressemble à aucun autre, en tout cas il nous aura emmené dans celui de Mary avec passion, ferveur même. Le voyage vaut la peine pour peu qu’on accepte de se laisser guider par sa caméra frénétique, ses personnages qui nous font intensément face, surtout Forest Whitaker, en homme face à sa conscience tourmentée…
Samedi 10 septembre
Cette année le film ayant reçu le prix Michel d’Ornano habituellement projeté dans la salle du Casino, a les honneurs de la prestigieuse salle du CID. Des films aussi divers que Le bleu des villes, Les jolies choses, Filles perdues, cheveux gras, ont obtenu cette distinction destinée à récompenser le premiers scénarios français portés à l’écran. Cette année le prix est décerné à La petite Jérusalem de Karin Albou. Ayant déjà vu ce film présenté au dernier festival du film romantique de Cabourg, j’y retourne néanmoins avec plaisir. La petite Jérusalem est un quartier de Sarcelles, en banlieue parisienne où de nombreux juifs ont émigré. Laura (Fanny Valette), 18 ans, est tiraillée entre son éducation religieuse et ses études de philosophie qui la passionnent et lui offrent une autre vision du monde. Alors que sa sœur Mathilde (Elsa Zylberstein) tente de redonner vie à son couple, Laura succombe à ses premières émotions amoureuses. Karin Albou « esquive », avec la même subtilité que le film éponyme, ce qui aurait pu être une caricature sur la banlieue, nous livrant un film au discours et aux questionnements identitaires et philosophiques universels. Le titre renvoie autant à la judéité qu’à la féminité, au fond les deux sources d’atermoiement du personnage principal. Est-on libre en enfreignant la loi ou en la respectant ? Loi du désir ou loi religieuse ? Loi philosophique ou Torah ? Laura oscille entre l’un et l’autre, entre ses désirs et la raison, sa liberté et la loi, le choix de sa propre loi ou l’obéissance à la loi -religieuse- pour finalement trouver le chemin de sa propre liberté. Je vous laisse découvrir l’itinéraire tortueux et passionnant, passionné aussi, qu’elle aura emprunté pour y parvenir. Karin Albou nous fait cheminer dans sa conscience fiévreuse, sans jamais juger, nous laissant parfois choisir, douter avec elle, nous renvoyant habilement et constamment à nos propres questionnements. Un film sur le doute amoureux, philosophique, religieux qui n’en laisse planer aucun quant au talent de sa réalisatrice et de son interprète principale. Les dialogues sont aussi bien écrits que les silences, admirablement filmés, plongés dans une obscurité métaphorique. Un film intense sur la liberté. Libre. Mon coup de cœur du festival…du film américain, aussi français soit-il.
Evidemment le questionnement philosophique est beaucoup moins sollicité dans Goal, naissance d’un prodige de Danny Cannon, premier volet d’une trilogie sur le football qui devrait s’achever à la coupe du monde de 2006. D’ailleurs, ce n’est pas non plus ce que à quoi je m’attends, plutôt à l’équivalent footballistique de Cinderella man, où le sport n’est qu’un prétexte à l’éloge de la combativité, de la revanche sur le destin (notre héros est asthmatique), du dépassement de soi-même et donc à des scènes d’identification auxquelles ce sport me semble se prêter plus encore que la boxe. Le prodige en question s’appelle Santiago Munez, qui, à 10 ans, passe la frontière mexicaine, pour aller vivre aux Etats-Unis en rêvant de devenir un joueur de foot. Plus tard repéré par un ancien footballeur, il part pour l’Angleterre. Pour être engagé dans l’un des clubs les plus prestigieux du monde, il va devoir prouver qu’il a le talent et le cran nécessaire. Dommage que Goal aille un peu trop rapidement droit au but (je sais c’est facile, moi aussi, je cède parfois à la facilité…) et ressemble davantage à une compilation de clins d’œil et de clichés sur ce sport: publicité pour Adidas, le joueur qui tombe dans les pièges de la célébrité et de la vie facile mais qui miraculeusement rentre dans « le droit chemin », la hargne du héros (dont ) car son père est apparemment indifférent à sa réussite, et même indifférent tout court, les passages éclair de Beckham et Zidane pour rappeler l’attention des amateurs de foot et des autres au cas où elle aurait été distraite. Et surtout les scènes de match d’un sport pourtant tellement « cinégénique » manquent d’emphase, d’ivresse et de grandeur. Subsiste un sympathique divertissement qui, bien que très prévisible, est porté par le regard d’un jeune comédien qui accroche celui de la caméra… Allez gageons que le deuxième opus nous contera sa descente aux enfers et le troisième son retour miraculeux et la victoire de son équipe à la coupe du monde…
L’imagination et l’originalité sont davantage au rendez-vous dans le film d’animation de Mike Johnson et Tim Burton, Les noces funèbres de Tim Burton. Forcément se dit-on avec le nom du maître de la fantaisie au générique. Au XIXème siècle, dans un petit village d’Europe de l’Est, Victor (dont le mimétisme est d’ailleurs frappant avec celui qui lui prête sa voix : Johnny Depp), un jeune homme, découvre le monde de l’au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria, l’attend désespérément dans le monde des vivants. Bien que la vie au Royaume des Morts s’avère beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme. Evidemment ces noces funèbres résonnent comme un écho à L’Etrange noël de M .Jack. Comme toujours, dans un univers a priori obscure, Burton sait créer une atmosphère lumineuse, poétique, onirique, enchanteresse et enchantée, foisonnante de trouvailles fantaisistes, réveillant notre âme d’enfant qui ne demande qu’à croire que « pas même la mort ne les sépare » ou que le monde des morts est plus joyeux que celui des vivants. Dans ses bas-fonds, Gorki n’aurait osé imaginer une telle poésie. L’oxymore du titre porte tout le film de son beau et romanesque paradoxe. Ce conte hybride, fantastique, musicale, poétique, drôle aussi vous emmènera bien plus loin, bien plus haut, que dans l’au-delà : il vous fera retrouver vos rêves d’enfant, un pouvoir magique dont seul Tim Burton semble détenir le secret et qu’il manifeste une fois encore. Remarquablement. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands ayant ainsi retrouvé leurs regards d’enfant…émerveillés.
Après cette belle parenthèse onirique, je me replonge dans mon étrange réalité et me dirige vers la soirée « Goal !» organisée par le distributeur du film Buena Vista International. Acteurs, boxeur, mannequin, présentateur (singulier à dessein,…cette année Deauville a oublié de se mettre sur son 31) s’y côtoient dans un mélange de cacophonie et d’indifférence. Je me souviens de l’ambiance électrique qui régnait dans ce même endroit, deux ans auparavant, pour la sortie du film d’animation Nemo et cette soirée-ci semble n’en être qu’une pâle copie. Qu’importe semble-t-il, c’est une des rares soirées de ce festival, il faut apparemment y voir et y être vu, faire semblant de ne rien voir et de ne pas vouloir être vu, et plus encore de s’amuser. Comme c’est toujours mieux en face, forcément, et qu’une autre soirée nous nargue de sa musique et de ses néons, je quitte la soirée Goal pour la soirée Chevignon, dans la fameuse villa où se déroulaient les soirées quotidiennes du festival, lorsque le festival ou plutôt ses sponsors en organisaient encore quotidiennement. J’y repense avec nostalgie puis j’y termine la soirée, une de ces soirées étranges où les visages et les attitudes prennent des reflets changeants et lunatiques, où la fiction vue précédemment semble avoir été plus réaliste que cette réalité ayant


