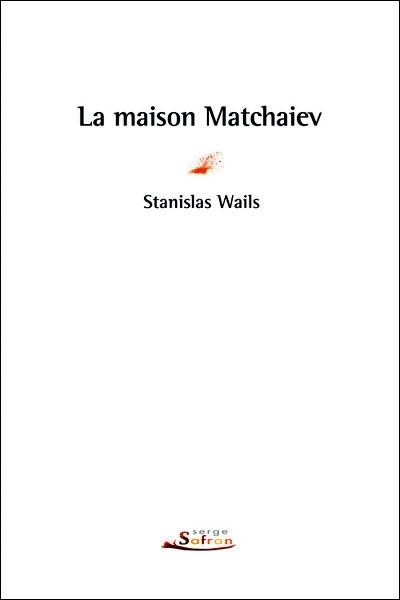
On peut porter un prénom d'origine slave et n'avoir aucun lien avec cet univers-là, sinon une attirance a priori, littéraire assurément, peut-être plus. La preuve avec ce roman dont la quatrième de couverture nous apprend que son auteur est né à Paris en 1973. Après des études de Lettres, il apprend l'arabe et part deux ans à l'ombre des pyramides égyptiennes. De retour en France, il gravit les marches du 7e art, d’accessoiriste à scénariste, de conseiller musical à régisseur… Et il travaille comme assistant-réalisateur sur les films de Tsaï Ming-liang ou Alain Resnais.

Dans son premier livre, Stanislas Wails nous ouvre les portes d'une fratrie composée de Pierre, Anne et Joshua Matchaiev. Déjà privés d'une mère qui les a abandonnés il y a bien longtemps, les voici orphelins de père. Sergueï s'est suicidé dans sa maison de Saint-Théraume. La demeure doit revenir aux enfants.
Si vous vous attendez à une énième histoire sur des frères et sœurs qui s'écharpent à propos de l'héritage, vous allez être déçus. Pourtant, à voir leurs différences de caractère et de trajectoire, il y aurait de quoi penser que ces trois-là vont s'écharper. Si Pierre, l'aîné, est, comme on dirait installé dans la vie, Anne, elle, finit une thèse et apprend le sanskrit. Joshua aussi est étudiant, aux Beaux-Arts.
Le point commun de ces personnages est d'être sans descendance. L'orientation sexuelle explique cela pour partie – Joshua aime les garçon – mais une histoire familiale lourde à porter, « dominée » par le patriarche Andreï Vassilievitch, y est sans doute pour beaucoup :
avec Andreï Vassilievitch Matachaiev les choses son forcément plus compliquées... C'était une noix dure, comme on dit en russe. Un gars pas commode, quoi. Un vrai bolchevik en acier trempé très pote avec Djerzinski. Il avait un haut poste à la Guépéou, intouchable le gars, à même pas trente ans. Mais en 1932-1933, il a senti le vent tourner, le tovaritch Matchaiev, et, contrairement à tous les autres, lui il a réussi à filer. Dans la famille, on raconte qu'il a pris la place d'Eugène Dabit. Le gars, sympa, avait eu l'excellente idée de mourir de la scarlatine à Sébastopol en plein voyage officiel, et Andreï a si bien baratiné Gide et Herbart, qu'ils n'ont pas déclaré le décès. Ils ont laissé Dabit à l'hôtel, du style « Il dormait, on voulait pas le déranger », et hop Andreï a passé la frontière avec eux, ni vu ni connu, en se faisant appeler Eugène.
La première partie du roman, menée tambour battant, est haletante, comme quoi on peut montrer la psychologie des personnages sans « faire lent ». Le tour de force consiste à fabriquer des êtres très contrastés qui ont tout de même un dénominateur commun.
Nos cœurs sont tranchants, mais la contrepartie c'est qu'ils sont solides. On s'y coupe, mais on ne les brise pas.
La deuxième partie, plus posée, ne perd en rien de sa force, bien au contraire. Stanislas Wails sait conserver l'attention de son lecteur sans recourir à des procédés faciles. Car il y a la promesse, jamais aussi directement formulée, qu'un événement va soudain tout bouleverser. Cette seconde moitié du livre permet aussi de nous éloigner du seul « rôle social » des personnages qui apparaissent dans leur singularité. Leur intériorité, leur fragilité deviennent manifestes. Il y a des moments de toute beauté comme celui-ci qui m'a fait penser au très mélancolique Intérieurs de Woody Allen.
Il tria les photos à toute allure, comme on se dépêche de boire une boisson trop amère ou de sauter dans une eau trop froide : le désagrément est certes plus intense, mais il dure moins longtemps. Il se demanda tout de même, pendant que ses doigts obéissants posaient les photos à tour de rôle sur l'un des trois tas désormais bien fournis, si Sergueï avait souvent ouvert cette boîte pour respirer l'étrange odeur qui s'y dissimulait, ou si de la savoir là lui suffisait.
Plus loin :
Il y entra comme on pénètre dans une église ou une mosquée, au cœur d'une ville étrangère et bruyante. Les sons furent d'un coup étouffés, la lumière tamisée par les feuilles et les branches : la forêt toute entière retenait son souffle pour ne pas risquer d'effaroucher la mystérieuse atmosphère qui y flottait. Il avait oublié à quel point il aimait, quand il vivait ici, se perdre des heures durant parmi les arbres, sentir leur force et leur fragilité, savourer cette vague inquiétude dont l'air était imprégné, lever les yeux vers la mosaïque vibrionnante qui le protégeait, ou les baisser cers le tapis de mousse et de bois brisé qui se craquelait sous ses pas. Il se laissa errer au gr du hasard, mais sentait confusément que quelque chose dans sa mémoire ou dans son corps se souvenait des chemins à emprunter pour atteindre la rivière cachée au sein de ce sanctuaire.
On pensera bien sûr, en lisant ce roman, à La Cerisaie d'Anton Tchekhov. D'ailleurs vous entendrez Stanislas Wails, dans l'interview ci-dessous, y faire référence lorsqu'il évoque le suicide de Sergueï. L'admiration de l'auteur pour la littérature russe se lit tout au long de ce roman qui garde toutefois sa spécificité. L'admiration ne conduit pas nécessairement à la dévotion.
La maison Matchaiev est un roman plein de vie. Il n'y a rien de paradoxal dans ces propos. L'histoire a beau naître d'un drame familial, un suicide, elle ne se fige jamais dans le seul registre du tragique, de la désolation. On sourit à ce que disent les personnages – j'ai un faible pour Irène Galopin, infecte agent immobilier auteur d'un vertigineux Mais vous connaissez le Bourguignon, il est superstitieux - ou, mieux encore, à ce qu'ils ne disent pas. Leur douleur est évidente mais elle est cachée sous une chape de plomb. Ils ont de la pudeur, de la retenue même si l'étincelle slave peut tout faire exploser.
Patience : le « feu d'artifice » arrive.
Et voici l'interview de Stanislas Wails. Bonne écoute.

