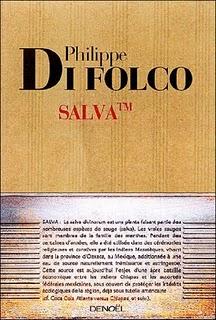
Éditions Denoël
Le lecteur appréciera sans doute que je confesse d’emblée ma relation d’amitié avec Philippe Di Folco. La crainte du copinage littéraire, dont on a bien raison de considérer qu’il fait courir au goût commun le risque de la corruption, ne saurait pourtant suffire à interdire que l’on se penche sur l’œuvre d’un proche. L’écrire ainsi, en guise de préambule et d’avertissement, constitue autant un gage de mon honnêteté que j’adresse au lecteur qu’une injonction morale à laquelle je décide de me soumettre ; et peut-être une manière, fût-elle illusoire, de mettre les affects au panier pour ne me consacrer enfin qu’au travail critique – car telle est bien mon intention.Au royaume du roman contemporain français, les intimistes sont rois. Le faire observer n’est pas le regretter : dans cet intimisme-là les lettres françaises ont toujours excellé, et qu’il s’absorbe en lui-même fait assurément progresser l’imaginaire de tout écrivain authentique. Une fois prises ces précautions d’usage, il n’est pas interdit, tout de même, de redouter la tendance naturelle du juste intimisme à se dégrader en narcissisme. Quelque chose du vase clos ; de la tour d’ivoire ; ou du ressassement, ce frère ennemi de la rumination féconde qui nous fait persévérer dans notre être. Aussi l’incorrigible pessimiste peut-il être enclin, voire autorisé, à observer la lente dérive du continent singulier vers l’îlot précaire du particulier, ainsi que procéderait la frêle embarcation qui, transportant en son bord un pêcheur assoupi, se retirerait en glissades étales sur les eaux sombres et profondes d’une mer étrange et lugubre, finalement condamnée à disparaître bien loin derrière la ligne d’horizon, ou plus prosaïquement à s’échouer sur un sable infertile et sec. Sans doute cette tendance au recroquevillement boudeur fait-elle seulement écho à quelque mouvement dangereux et souterrain de nos sociétés, percluses d’angoisse dans un monde où le seul fait d’avancer, mécanique, semble être admis comme une preuve de notre volonté de progresser. Dès lors la littérature se poserait-elle comme le dernier des havres de sérénité, de lenteur et de recueillement, après que la folie des hommes se fût obstinée à détruire jusqu’aux dernières parcelles de paix. A défaut du monde, donc, mon monde : le quant-à-soi comme refuge terminal, la compassion de soi à soi et l’intimisme compulsif comme remparts devant la marée montante de l’histoire et de la multitude.
C’est le mérite de Philippe Di Folco que d’avoir réussi à pénétrer l’antre de quelques âmes humaines devenues choréiques sous l’effet des spasmes de notre monde. Il n’y a plus d’intimités qu'incorporées dans le monde médiatisé, soumises, travaillées, manipulées par lui. L’écriture de Di Folco rappelle d’ailleurs pas moments celle d’un sociologue qui se serait laissé gagner par la sympathie pour son sujet, ou encore d’un disciple, indiscipliné mais reconnaissant, de Georges Perec. Nous ne sommes pas ici dans un roman psychologique (une situation, des individus, des émois) mais dans un thriller métaphysique (une arrière-scène de confusion, une conscience éparpillée du temps, une cognition brisée sous le double effet de la pathologie mentale et de la brutalité exogène). Quelque chose d’assez peu commun, finalement, qui pourrait avoir puisé chez Dantec son catastrophisme fasciné, chez Houellebecq sa très aristocratique satisfaction du sentiment de déclin, chez Lynch son goût mystique pour l’expérimentation, chez les frères Coen le goût assumé de la banalité du glauque et, paradoxalement peut-être, chez un Burt Bacharach ce plaisir délicieux pour la joliesse des petites choses impeccables, ces couleurs qui scintillent et lénifient, cette qualité d’orfèvre qui est la marque des grands méticuleux, des obsédés de la forme, des amoureux du travail bien fait, et surtout ce fol espoir qui vous rend fou d’apaisement, qui fait de vous un insatiable du calme et de la volupté. En votre for intérieur pourtant, une petite voix vous hurlera que l’apaisement est chimère : crapule, chafouin, manipulateur, le réflexe d’espérance vous maintient dans son halo d’inabouti et dessine sous vos yeux une forme virtuelle qui détale à la façon d’un lézard – tout en faisant semblant de ne pas vous devancer de beaucoup. Cette petite voix est précisément celle de Philippe Di Folco dans ce troisième roman au contenu baroque et au titre énigmatique, « SalvaTM ».
La grande difficulté pour qui cultive un projet aussi complexe, aussi total, est de travailler sur une forme qui lui fasse écho : on n’entre pas dans la complexité comme dans une fable. Il faut donc abolir autant que possible les dimensions académiques du temps et de l’espace pour ne s’attacher qu’aux flux et aux présences. D’où la dimension scientifique de « SalvaTM », portée par une érudition tous azimuts obligeant l’auteur à endosser l’habit d’un exégète des neurosciences, des sciences administrative et médicale, de la psychologie ou des procédures institutionnelles. Je le dirai tout de go : cette dimension érudite, fort impressionnante, n’est pas ce qui m’a le plus séduit. Le souci du vrai, ou du moins du véridique, est pour un auteur une obligation et un terrible piège : il court toujours le risque de l’imposture et de l’impasse. L’érudition de Philippe Di Folco n’est pas en cause, et jamais elle ne sent l’imposture ; on la sent même passionnée, gourmande, adolescente ; le risque d’impasse est plutôt dans l’ordre du narratif, entendu au sens où la plume qui pompe son encre dans le sang pur de la véracité scientifique prend le risque de conduire le lecteur à un effort qui n’est plus seulement littéraire ou romanesque. Nous conseillerons donc au lecteur de s’accrocher, de patienter, de ne pas chercher systématiquement le sens de tous les mots alambiqués et notions abstraites qu’il rencontrera sur son chemin, de laisser l’intrigue faire son travail et l’autoriser à emprunter les interminables souterrains créés par notre imagination.
L’histoire est pourtant plus simple qu’il y paraît au premier abord. Elle débute de nos jours, lorsqu’un certain F. se rappelle son amitié avec Luca Calabresi, jeune garçon rencontré il y a vingt-cinq ans dans un collège où se noua une amitié romanesque, absolutiste, à la vie à la mort comme il est d’usage de le jurer à ces âges. Luca est un personnage intense, follement séducteur, peu ou prou illuminé, d’une obscurité un peu fantasmatique et d’une intolérance légèrement supérieure au tropisme normal de l’adolescent moyen. Or voilà, F. en est convaincu : Luca a disparu. Aussi va-t-il tout mettre en œuvre afin de retrouver sa trace et son contexte, et avec eux le fil d’une histoire qui a tous les traits de ce que l’on identifie généralement sous le phénomène de l’effet papillon. Dans ce roman qui mérite assez bien la qualification de total, il y a en effet quelque chose des petites causes et des grands effets, voire du chaos fondateur autour duquel s’organise l’énigme des vies humaines. Le procès est obscur, l'instruction ne l’est pas moins. Elle bascule d’ailleurs et sans autre forme de procès dans un espace-temps proprement hystérique où l’on retrouve Luca, allongé sur un lit, entravé, aliéné à lui-même et surveillé par une infirmière déboussolée. A ce stade, il est encore difficile de savoir si Luca est tenu enfermé dans cet étrange Institut dirigé par Ethel Sehnsucht, ou s’il ne fait que recevoir l’ordinaire des soins hospitaliers. Et qui donc est cette Ethel Sehnsucht, dont on apprend au passage qu’elle a répondu au désir de fellation d’un certain Louis Althusser et fait l’amour à des personnages aussi improbables qu’Andreas Baader, Georges Pérec ou Régis Debray ? quels buts inavouables l’Institut poursuit-il ? à quelles expérimentations savantes et ultrasecrètes se livre-t-il ? comment, pourquoi Luca a-t-il atterri ici ? et qu'est-ce que « Salva », scansion magique qui semble devoir s’immiscer dans les moindres aspérités de l’existence ? Le narrateur utilise les voix éclatées des vies parallèles pour nous donner, non les codes, mais au moins les clés d’appréhension d’une histoire qui n’embrasse les destins particuliers que pour s’attacher à dresser l’épopée d’une époque déçue – déchue. C’est ici qu’il faut nuancer les références à Dantec ou à Houellebecq. Sauf à les imaginer tous deux avant qu’ils n’aient tout à fait cédé aux sirènes de la fin du monde, baignant encore dans le temps béni de l’innocence, abritant en eux-mêmes, fût-ce in extremis, une ultime étincelle d’humanisme classique et résistant, à l’arrachée, à la tentation de désespérer entièrement de l’homme. La manière de porter attention aux petites gens est tout entière tournée vers l’empathie, la compassion, la solidarité militante. Il y a chez Di Folco quelque chose d’un vieux rêve prolétarien, un très ancien fantasme rédempteur de la condition misérable, une adhésion immédiate, quasi inconditionnelle, aux souffrances d’en bas. Là où Houellebecq prend son malin plaisir à disséquer le social jusqu’à s’en faire vomir, Di Folco va d’instinct chercher dans une certaine déshérence individuelle le ferment de son imaginaire politique. Ainsi le pauvre Moussa, personnage de passage, Malien échoué en France pour y faire ses études de médecine, éboueur, ouvreur dans un cinéma porno ou nettoyeur de tombes, en tout cas homme à tout faire de la société hygiéniste, est-il décrit avec l’exacte distance que confèrent la solidarité immédiate et l’indifférence relative pour ce qui n’est, au fond, qu’un syndrome parmi d’autres du monde qui se délite. C’est ce qui permet à la poésie de rôder partout dans un texte aux ambitions très contemporaines, mais aussi très post-. Le goût du collage et du trompe-l’œil, la revendication du plaisir que procurent l’excès visuel et la kitcherie, la réfutation pour ainsi dire idéologique des critères et autres distinctions du bon goût officiel, conduisent l’écrivain à une liberté formelle parfois déroutante, par moments un peu sèche à mon goût, ou excessivement teintée des idiotismes du jour, mais jamais sans dessein ni fondations. Et à un éloge, d’apparence paradoxale en ce roman qui semble animé d’une très ancienne douleur, de la vie légère et bachique. Philippe Di Folco n’est pas pour rien enfant des seventies. Il fait dire à l’un des narrateurs : « Laissons le salpêtre aux grottes, aux caves, buvons le vin tiré la veille, saoulons les philosophes, abandonnons leurs quelques illusions, débarrassons-nous du pétrole, revenons aux déserts pour en tirer des histoires à dormir vraiment, bien allongés sur l’herbe, la pluie d’étoiles, les constellations, des créatures en colliers, laissons l’or aux astres, revenons aux contes et légendes, on a besoin de connaître la suite, la suite de l’histoire, comment fait le petit soldat pour conquérir la princesse, où s’en vont le bateau et ses marins, que devient Alice après le miroir traversé, écoutons, écoutez, les histoires montent, eau de mots devenus temps vivant sous l’index d’un apprenti sorcier tranquille ». Campe sous la désillusion de l’histoire officielle quelque chose d’un militant alter que l’on aurait vacciné contre l’optimisme. D’où le désenchantement : non seulement l’impuissance mais le désir de ne plus pouvoir espérer, et cette forme larvée, non écrite, non théorisée, de renoncement à une grande Histoire dont nous attendions beaucoup hier encore. Tant et si bien que « SalvaTM » fait aussi la fiction de notre monde, ce monde où l’on ne sait plus très bien distinguer le vrai du faux. C’est dans cet entrelacs déjà inexplorable que va puiser l’écrivain, dont on sent bien l’obscur plaisir à vouloir nous perdre davantage encore dans le vaste monde, et qui a compris que l’objet de la littérature peut être de ne pas éclairer le monde mais de l'embrumer toujours plus. Di Folco laisse aux hommes leur droit au mystère et redonne à l’histoire ce quelque chose de la quête du Graal. En cela, il s’éloigne doublement des idiosyncrasies collectives contemporaines, où le souci de l’aveu individuel (fût-il extorqué), le goût de la transparence et le travail schizophrénique de la mémoire comme horizons indépassables de l’utopie démocratique, ressemblent à s’y méprendre aux attributs d’une religion désespérée qui chercherait son ressourcement dans l’eau bénite. Une fois le livre refermé, le lecteur exténué sortira de son trauma, surpris peut-être d’avoir réussi à traverser ce continent prolifique, et reconnaissant envers Philippe Di Folco de n’avoir épargné ses personnages que pour mieux terrifier notre monde.
Article paru dans la Newsletter des Livres n° 66 - Fondation Jean-Jaurès - Janvier 2006

