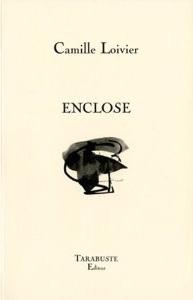 Enclose : une note en fin de livre nous indique que c’est le nom d’une rivière en Limousin. Bon titre, puisqu’il souligne à la fois l’enfermement et le flux du passage, le voyage et le temps, la transparence… Tous ces motifs vont venir s’entrecroiser et tisser l’unité du livre. Il est divisé en trois séquences de longueur à peu près égale : Photo-fantômes renvoie plutôt au passé familial ; les Dix-sept poèmes écrits dans un fauteuil mêlent rêverie et souvenirs de voyages ; la troisième partie, Poésies métisses, vise plus particulièrement l’expérience de l’Asie.
Enclose : une note en fin de livre nous indique que c’est le nom d’une rivière en Limousin. Bon titre, puisqu’il souligne à la fois l’enfermement et le flux du passage, le voyage et le temps, la transparence… Tous ces motifs vont venir s’entrecroiser et tisser l’unité du livre. Il est divisé en trois séquences de longueur à peu près égale : Photo-fantômes renvoie plutôt au passé familial ; les Dix-sept poèmes écrits dans un fauteuil mêlent rêverie et souvenirs de voyages ; la troisième partie, Poésies métisses, vise plus particulièrement l’expérience de l’Asie.
Le vers libre assez long mais très fluide convient bien à cette poésie de la mélancolie douce et de la mémoire. Lyrisme ? Certainement. Ajouter romantique serait trop, même si un vers comme « ni les voiles au loin descendant vers Haïlong » ne peut manquer de ramener en écho Demain dès l’aube… Non, cette poésie est nourrie d’intime, certes, mais elle n’est ni narcissique, ni exhibitionniste, ni outrancière. Elle a la singularité d’une vie simple, sans prétention d’être exemplaire, héroïque ou aventurière : une rivière enclose et fuyante, à la fois. « on se demande souvent / ce qu’était la vie avant d’être né / mais ce qu’elle est depuis / on ne le sait pas non plus. » (p 24)
A partir, le plus souvent, de la réalité immédiate (végétaux, oiseaux, objets…) la rêverie va se développer vers le passé personnel ou vers l’ailleurs. Il y a une forte conscience chez Camille Loivier que tout le réel est instable, transitoire, fragile, et qu’il ne reste bientôt pas plus trace de la vie des gens que des maisons d’enfance ou des jardins… Un poème comme Destruction, à partir des « photographies d’Atget du vieux Paris » fait penser au Cygne de Baudelaire. D’où la mélancolie, mais toujours sans fanfare, simple constat : « La maison est maison toujours vide / on est bien ici mais pas ailleurs en pensée / ni souvenir ni rêve ne remplacent la présence / voilà qui rend la mémoire dérisoire » (p 15), « la maison s’éloigne soudain dans l’abandon // on sait maintenant que l’on est dedans / toute l’impossibilité d’en parler (…) on ne sait pas à quoi cela tient / et pourtant / une distance est prise. » (p 103) Les objets aussi peuvent faire retour arrière, mais toujours avec la conscience nette de la séparation : un vieux piano (p. 98), « des morceaux d’un bol cassé » (p 114), mais « la lumière sur les objets dans l’oubli / par temps gris il ne reste rien » et « on n’entend pas / le bruit de la rivière en contrebas / dans le poème » (p. 100).
L’autre pente de la rêverie, pour la poète qui écrit « dans un fauteuil », est celle du voyage. « les grues ne migreront pas ce soir vers le nord / je m’imagine parmi elles où je suis / dans la langue, leurs cris rauques me donnent des ailes » (p 64). C’est aller vers d’autres paysages, d’autres gens, d’autres modes de vie, mais sans jamais tomber dans l’exotique ou le touristique. Il n’y a par exemple quasi jamais de description complète de paysage, juste des détails comme retenus au passage, sans développement insistant sur la couleur locale. C’est un autre réel, lointain, mais il est traité comme le réel, ici. Car la mémoire vivante ne retient que ce qu’elle veut, et ce n’est pas forcément le « tombeau du roi de Bornéo en friches //ce n’est pas cela (…) qui persiste / mais l’accroche du pneu sur l’asphalte humide / l’ombre des lampadaires dans la lumière / des platanes » (p. 93).
Voyager, c’est aussi entrer dans le « tambour » des langues ; on peut rappeler ici que Camille Loivier est spécialiste des langues et littératures d’Extrême-Orient. Passer dans un autre univers linguistique n’est pas pour elle une angoisse mais un plaisir, même si elle reste modeste : « je ne parle aucune langue mieux que la mienne / balbutiante en japonais, allemand, chinois, anglais / espagnol, grec et latin et puis rien / je sors pour entrer dans toutes les langues / et ne pas comprendre / ne pas comprendre et / rester cachée à l’intérieur du tambour / pour juste en ressentir les vibrations » (p. 81)
Cette expérience du déplacement dans l’espace, le temps, la langue, est aussi une quête de soi, même s’il n’y a pas d’illumination, de révélation, au bout. On a bougé, mais on ne sait pas ce qui a bougé. « comment ne pas dire de soi / qu’il ne reste plus rien / quelque chose a changé mais / impossible de saisir quoi » (p. 72). Voilà peut-être pourquoi on écrit.
[Antoine Emaz]
Camille Loivier, Enclose, Tarabuste éditeur, 130 pages, 11 €

