Voici donc, par ordre de difficulté psychologique de lecture :
 Le cuisinier de Martin Suter, chez Bourgois, 2010 : une lecture qui ouvre l’appétit
Le cuisinier de Martin Suter, chez Bourgois, 2010 : une lecture qui ouvre l’appétitMaravan est un des nombreux réfugiés tamouls travaillant dans un grand hôtel suisse, le Huwyler, qui est fréquenté par le monde de la presse et de la finance. Il était un cuisinier prometteur spécialisé dans les préparations ayurvédiques dans son pays, le Sri Lanka. Mais en Suisse, il est cantonné à un travail de grouillot le jour alors que le soir il s'exerce à la cuisine moléculaire, en tentant chez lui des expériences sophistiquées qui vont le mener très loin.
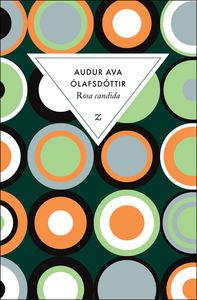 Rosa candida de Audur Ava Ólafsdóttir, traduit de l'islandais par Catherine Eyjólfsson, chez Zulma, 2010 : une lecture buccolique
Rosa candida de Audur Ava Ólafsdóttir, traduit de l'islandais par Catherine Eyjólfsson, chez Zulma, 2010 : une lecture buccoliqueLa mère d'Arnljotur est récemment morte dans un accident de voiture durant lequel elle e eu la force de lui téléphoner pour lui transmettre ses dernières volontés. Le jeune homme partageait avec elle le jardin et la serre où elle cultivait une espèce rare de rosa candida à huit pétales. Il va quitter la maison familiale, en laissant son frère autiste et son père octogénaire et peut-être réaliser le rêve dont il est porteur.
Le livre a déjà été récompensé par le Prix Pages des libraires 2010.
 Déluge de Henry Bauchau aux Éditions Actes Sud : une lecture flamboyante
Déluge de Henry Bauchau aux Éditions Actes Sud : une lecture flamboyanteUne écriture magnifique d'un auteur qui étonne toujours par l'intelligence de la construction psychologique. C'est plus complexe à lire qu'il n'y parait et c'est dommage d'avancer vite parce que d'autre ouvrages attendent.
 Les femmes du braconnier de Claude Pujade-Renaud chez Actes Sud : une lecture troublante
Les femmes du braconnier de Claude Pujade-Renaud chez Actes Sud : une lecture troublanteJe suis certaine que beaucoup adoreront parce que c'est une histoire littéraire, un peu dans l'esprit de Loving Franck de Nancy Horan. les fictions historiques ont leur public. Il s'agit de la reconstruction de la vie de Sylvia Plath avec une approche psychanalytique. Chaque membre de la famille s'exprime. Les voisins et les amis aussi. J'avais commencé en parallèle le livre suivant qui m'a fait abandonner celui-ci tant il était original.
 L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet, de Reif Larsen, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hannah Pascal, NiL éditions, 2010 : une lecture attachante
L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet, de Reif Larsen, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hannah Pascal, NiL éditions, 2010 : une lecture attachanteC'est un objet-livre comme je n'en avais jamais vu. C'est d'ailleurs un premier roman qui s'apparente aux docu-romans.
On apprend page 3 que le téléphone sonne, mais il faut attendre la page 17 pour lire « allo ». Entre temps nous aurons eu droit à 14 pages de digressions avec un sens du détail qui confine à l’obsession. Quand par exemple le garçon donne l’heure à laquelle il ouvre un magazine il l’annonce à la minute près : 6 h 17, et pas 6 h ou 6 h 30. Il raccroche page 28. C’est la fin du premier chapitre.
On vient d’apprendre que le héro a été choisi par le Smithonian, qui est une institution scientifique américaine, pour recevoir une distinction honorifique à la gloire de son travail, sans se douter qu’il n’a que douze ans, ce dont lui-même convient qu’il s’en souvient rarement.
Depuis quatre ans il réalise des croquis très détaillés de toutes les activités qu’il entreprend. Cela confine à la manie, ou au TOC parce que cela correspond à un besoin de se rassurer en dissipant le mystère parfois terrifiant entre l’ici et l’ailleurs. (p.32) Sa façon de procéder pour faire sa valise est symptomatique de ses angoisses. Et quand son père lui demande de l’aider il est submergé d’émotions contradictoires.(p.43)
Dans la famille Spivet la mère, que l’enfant appelle Dr Clair, est une entomologiste réputée qui traque la cicindèle vampire tandis que le garçon dessine une carabe bombardier. Rien d'étonnant à ce que le fils ait une vraie passion pour les insectes, tous les insectes, y compris les ravageurs du maïs.
Tout est prétexte à dessin et l’auteur en a véritablement truffé son ouvrage. C’est le schéma d’un grille-pain qui explose malencontreusement (p.30). C’est aussi un situs inversus (p. 60) qui personnellement m’amuse puisque mon père est né ainsi et que je n’avais jamais eu l’occasion de voir à quoi cela ressemblait. C’est ainsi qu’on peut apprendre mille et une choses comme le code d’honneur du cow-boy en lisant ce livre qui ressemble à un almanach. L’auteur s’est documenté sur tous les sujets qu’il aborde.
Ce n’est pas un ouvrage facile à lire, parce qu’on a du mal à conserver le fil de l’aventure du jeune garçon même s’il pose une question d’importance : quand un enfant devient-il adulte ?
Il interroge sur la prédestination. A-t-on tout dans la tête à notre naissance ? Avons-nous seulement oublié comment accéder à ce savoir ? Il démontre que la créativité s’accompagne d’un esprit qui procède par esprit d’escalier. Il n’hésite pas à comparer des découvertes aussi disproportionnées en terme d’importance que la théorie de la relativité et la mise au point de la recette des cookies aux pépites de chocolat.
Un livre inclassable qui est une vraie découverte.
 Ouragan de Laurent Gaudé, chez Actes Sud, 2010 : une lecture essoufflante
Ouragan de Laurent Gaudé, chez Actes Sud, 2010 : une lecture essoufflanteLa tempête est annoncée à La Nouvelle-Orléans et l’évacuation s’organise alors qu’une poignée refuse de partir. La férocité des hommes s’additionne à la furie des éléments. La prison et le zoo seront dévastés eux aussi. La ville n’a jamais autant mérité son surnom de "tombe humide". Pourtant l’espoir avait tenté de tracer sa route dans cet enfer.
 Sébastien de Jean-Pierre Spilmont, éditions de la Fosse aux ours, 2010 : une lecture déprimante
Sébastien de Jean-Pierre Spilmont, éditions de la Fosse aux ours, 2010 : une lecture déprimanteOn s’apitoie sur ce grand garçon qui n’a pas eu d’enfance, qui pour une raison qui restera ignorée, est resté " dans son monde" parce qu’il "détestait celui des autres" (p.15). Les chapitres sont brefs mais les vexations subies par le garçon sont infinies, d'abord dans sa famille où il est vu comme un monstre : "On ne peut pas se permettre de laisser la bave de son gosse, même sur un tapis, quand on est riche. (…) Les salauds laissent eux aussi leurs traces sur les tapis, des traces de cruauté qu’on ne remarque pas toujours. "(p. 85 )
Les soucis continuent évidement à l'école où il ne "fonctionne" pas bien, ce qui conduit la psychologue à proposer "la meilleure solution dans l’intérêt de l’enfant" à des parents trop contents de s’en tirer à si bon compte. Sébastien est transféré dans une institution où on relègue les marginaux. Seuls ses grands-parents acceptent sa différence et semblent pouvoir apaiser ses accès de violence.
On frémit de son calvaire et on supposera que c’est d’amour qu’il a surtout manqué. On en viendra vite à comprendre que tout cela ne pouvait que mal finir. Qu'à force de supporter beaucoup de misères, l'injustice déclenchera l'irréparable. C''est sans surprise qu'on découvre ce qui s'est passé le jour où son grand-père l'a emmené à Paris pour rencontrer d'anciens combattants d'Algérie.
L’histoire est construite à la première personne, comme si c’était Sébastien lui-même qui nous racontait son périple. Mais la construction est trop bien élaborée, les mots trop bien choisis pour que ce soit ce garçon qui "n’a rien dans la tête" qui nous fasse lui-même le récit de sa vie sous forme de confession.
Un livre qui fait penser à "Où on va, papa?" de Jean-Louis Fournier chez Stock en 2008 et au livre de Mark Haddon "Le bizarre incident du chien pendant la nuit", paru chez Nil éditions en 2004.
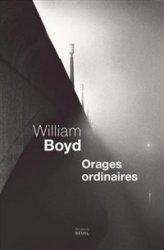 Orages ordinaires de William Boyd, traduction de Christiane Bess, Seuil, avril 2010 : une lecture qui vous mine le moral
Orages ordinaires de William Boyd, traduction de Christiane Bess, Seuil, avril 2010 : une lecture qui vous mine le moralAdam Kindred, jeune climatologue, rencontre un médecin qui oublie un dossier qu'il entreprend de lui rendre. Il découvre ce médecin poignardé. Pour échapper au tueur qu'il a surpris et à la police qui le croit coupable, il se réfugie sur les bords de la Tamise où il se crée un refuge de fortune. Il se mêle bientôt aux sans-abri et aux marginaux. Son enquête l'amène à démasquer une conspiration émanant de firmes pharmaceutiques.
Le titre est à demi mensonger. Difficile de croire que la situation qui est décrite dans ce très gros livre, de tout de même 476 pages est tout sauf ordinaire. C’est très anglais, très noir, très tortueux, très violent. Un vrai livre d’horreur, dans la tradition du cinéma de cette même catégorie.
J’ai commencé par apprécier le propos bien que la prise de conscience de la rapidité avec laquelle on peut tout perdre ne soit pas nouvelle. Gérard Jugnot l’a démontré avec force dans Une époque formidable. Une maladie, la perte d’un emploi, un divorce et la dégringolade n’est pas loin :
Si vous ne téléphonez pas, ne réglez aucune facture, n’avez pas d’adresse, ne votez jamais, n’utilisez pas de carte de crédit ni ne tirez d’argent à une machine, ne tombez jamais malade ni ne demandez l’aide de l’État, alors vous passez au-dessus du radar de compétence du monde moderne. Vous devenez invisible, ou du moins transparent, votre anonymat si bien assuré que vous pouvez vous déplacer dans la ville - sans confort certes plein d’envie, ou prudemment bien sur- tel un fantôme urbain.(Page 74)Quand on n’a rien, alors tout, même la moindre petite chose devient un problème. Je ne me suis pourtant pas attachée au personnage. J’ai fini par avoir peur qu’il ne me file la poisse et j’ai lâché prise à la deux centième page, peu de temps après que je ne lise que chaque semaine en Angleterre 600 personnes environ disparaissent.
 La disparition de Paris et sa renaissance en Afrique de Martin Page, aux éditions de l'Olivier : une lecture étonnante
La disparition de Paris et sa renaissance en Afrique de Martin Page, aux éditions de l'Olivier : une lecture étonnanteAvant Woody Allen, Martin Page décrit amoureusement la capitale sans se restreindre aux lieux connus de tous. Son personnage principal, Mathias, est un employé municipal qui embarque le lecteur jusque dans les pièces secrètes de l’Hôtel de ville comme cette chambre rouge où le maire se repose dans un confort spartiate.
A l’inverse encore du réalisateur américain il ne cache pas la misère : Il y a une fatalité triste dans cette colonisation des quartiers pauvres par les classes moyennes. (…) les cafés labellisés, les boulangeries franchisées et les magasins de vêtements détruisent le tissu urbain plus sûrement que les expulsions et les démolitions. (p. 54)
Il nous explique qu’à Paris (mais on pourrait le dire de toutes les villes) il y a deux sortes de personnes. Celles qui mangent toujours dans les mêmes restaurants et celles qui en changent. L’auteur (comme moi) appartient à la deuxième catégorie, capable de se régaler d’une fabada dans un restaurant espagnol. J’ai cherché sans succès la recette de ce plat qui serait une variante espagnole de notre cassoulet mais je veux bien le croire sur parole.
Plus que du respect, Mathias éprouve une empathie pour les élus municipaux. Il a été frappé, écrit-il par « l’humanité, la petite humanité mièvre de ceux qui ont le pouvoir sur eux-mêmes et leurs pensées. (…) Travailler pour une institution ou une entreprise a une influence sur ce que nous pensons. En faisant partie du cabinet du maire, je sais que j’ai perdu en indépendance d’esprit». Le syndrome de Stockholm n’est pas loin ou à tout le moins un formidable esprit de corps.
Sauf que suite à ce qui serait passé inaperçu s’il ne s’était agi d’une personnalité voilà Mathias chargé de régler une bavure policière qui va l’amener à changer radicalement de point de vue. Fata Okoumi a reçu un coup de matraque sur la tête et Mathias est l’intermédiaire entre cette femme et le maire de Paris pour éviter un incident diplomatique.
Contre toute attente le fonctionnaire se prend d’affection pour la victime, au début parce qu’elle était une femme, qu’elle était noire. (…) Le retour à la réalité me déroutait, je ne comprenais pas. (P.75 ) Mathias s’imagine au cœur d’une affaire de terrorisme, exagère le pouvoir de la femme d’affaires, et finit par déraper carrément dans l’affolement en proposant une solution totalement déraisonnable sur laquelle j’aurais voulu protéger le suspense. Difficile puisque l’auteur révèle l’issue du livre et de l’intrigue dans le titre.
Les relations de Mathias avec Dana, la fille de la victime, sont étonnantes. S’interdisant de confondre les émotions et les sentiments il tente de retrouver le calme en faisant de l’ordre chez lui. Mais sa rencontre avec Fata va bouleverser sa vie. Il osera jouer de la trompette, démontrant qu’il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves avant de décider de tout abandonner.
Le livre de Martin Page se termine dans une forme de divagation alambiquée mais il n’empêche que son écriture obéit à des ressorts psychologiques qui font longtemps réfléchir. Comme cette phrase sur le couple ( P.95 ) : Seul l’amour permet de connaitre la solitude, car l’autre est là pour faire barrage au monde.
Ou cette autre sur le parallèle entre fiction et réalité (P.124 ) : e crois que l’on ne rencontre vraiment que des gens que l’on peut imaginer ; c’est-à-dire qui sont proches de nous. Mon implication dans cette aventure n’était pas un hasard. Au même titre que la fiction, le réel obéit à des lignes narratives.
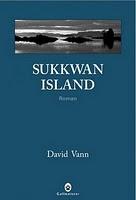 Sukkwan Island de David Vann, chez Gallmeister, 2008 : une lecture accablante
Sukkwan Island de David Vann, chez Gallmeister, 2008 : une lecture accablanteUn roman noir, à coté duquel la Route de Cormac Mc Carthy semblerait presque fade.
Le roman démarre avec une brève évocation des jours heureux, avant que l’homme ne soit devenu laid avec ses bébés pareils à des cloportes (p.12). Et puis, très vite, Roy a 13 ans et son père Jim, dentiste, décide avec l’accord de son ex-femme de l’emmener au beau milieu de nulle part, vivre comme Robinson sur une ile sauvage. Çà se poursuit sur l’air de la Petite maison dans la prairie mais le lecteur s’attend au pire et il fait bien.
Roy travaille comme un forçat, coupant du bois, pêchant et vidant des saumons à longueur de journée. Il ne voit pas le bout de sa peine et aimerait repartir. Il voudrait retrouver ses amis, sa vraie vie. Il n’a pas envie d’essayer de survivre à l’hiver.
Très rapidement l’adolescent est pris en étau et ressent une culpabilité comme s’il était en train de tuer son père. Il faut reconnaitre que le paternel sait s'y prendre pour le tracasser : Tu m’as dit que tu resterais un an et j’ai fait des projets. J’ai démissionné et j’ai acheté cet endroit. Qu’est-ce que je suis censé faire si tu t’en vas ?
L’adulte manipule le jeune : Tu as raison. Il faut être un homme pour supporter çà. Je n’aurais pas dû emmener un enfant avec moi. Roy cède et reste, avec la sensation qu’il venait lui-même de se condamner à une sorte de prison et qu’il était trop tard pour reculer. (p.83)
La machine infernale est lancée. Dès lors le jeune garçon vit comme un automate, pratiquement sans espoir, avec l’impression qu’il est seulement en train d’essayer de survivre au rêve de son père.
Le père, lui, vit dans une excitation mégalomane, s’imaginant un bon mariage, ne pas avoir rompu les deux précédents, ne pas être devenu dentiste, ne pas avoir le fisc à ses trousses et puis après tout çà avoir peut-être un fils comme Roy et un grand bateau. (…) Je ne serai jamais parfait ou sans problèmes, et je vais arrêter de m’excuser. (p.96)
Le lecteur est atterré de constater que l’enfant soit cité en quasi dernière position. On ne peut ressentir aucune compassion pour cet adulte qui est en train de massacrer la vie de son fils.
Le livre de David Vann est aussi insoutenable à lire que le serait un film d’horreur. On a compris que rien de positif n’en sortirait. Si cela n’avait tenu qu’à moi j’aurais arrêté là. D’autant que l’écriture n’est pas si bien construite que çà. Il y a des idées qui arrivent incongrument et de manière surprenante. Par exemple dans cette phrase : Son père semblait aller mieux, ce qui n’était pas une si mauvaise chose, alors il poursuivit sa lecture sur la guillotine et essaya de ne plus penser à la maison. (p.97)
Je me dis que j’ai du louper quelque chose. On ignorait qu’il lisait quelque chose sur la guillotine, un sujet qui ne peut pas être anodin tout de même …. Et on cherche le sens caché du message …
Plusieurs fois ils frôlent la mort. Le père fait toutefois mine de s’être amélioré, pantalonnant qu’il est en train de devenir un homme nouveau qui renait de ses cendres. L’enfant s’illusionne un tout petit peu. Une tempête fait rage. L’hiver s’installe. Jim fait mine de se suicider et l’histoire s’enfonce encore plus loin dans un tunnel sans retour.
La première partie du roman était noire. La seconde est franchement glauque. Le pire est atteint (p.152) quand Jim se répugne lui-même à chercher une façon de raconter l’histoire pour que tout que tout en paraissant triste elle eût l’air inéluctable.
J’ai lu (et apprécié) la Route de Cormac Mc Carthy. David Vann va beaucoup plus loin dans l’insoutenable. Quand le premier écrit une fable, un roman philosophique, le second se cantonne à un thriller psychiatrique.
Jim sait ce qui s’est produit mais ne semble pas en réaliser l’épouvante réalité : Je n’arrive pas à croire que j’aie vraiment fait çà. Un truc ne tourne pas rond. (P. 156)
Oui, c’est le moins qu’on puisse penser. Parallèlement Jim continue de laisser son esprit divaguer et réaliser que ce qu’il lui aurait fallu c’est une communauté de gens, un endroit fixe, un sentiment d’appartenance. (p.157). C’est peut-être là la clé pour comprendre le message de l’auteur. Peut-être faut-il aussi aimer Soulages ?
Quand l’hydravion est annoncé Jim se trouve tout excité. Il est prêt à reprendre le cours normal de sa vie (p.161). Il reprendra vite pied avec la réalité quand le shérif arrête le flot de ses explications en exigeant de reprendre point par point pour consigner les faits sur une déposition.
A la toute fin, p. 180, Jim semble avoir compris qu’il n’y a plus rien à attendre, que sa propre perte.
Le lecteur se retient de conclure que tout cela a été écrit … en pure perte … Le livre est cependant couronné de lauriers. Il a (déjà) reçu le Prix Médicis étranger 2010, le Prix des lecteurs de l’Express et le Prix de la maison du livre de Rodez. Il est qualifié de "bombe littéraire" par RTL. La seule explication que j’y voie est que ce roman, qui est une première œuvre a de fortes résonances autobiographiques qui ont du influencer les critiques littéraires et les libraires. Et que ce qui terrifie fait toujours meilleur recette que ce qui réjouit.
A vous maintenant de faire votre choix. Je pense que le mien apparait clairement, mais je ne cherche pas à exercer une influence. Verdict le 19 juin prochain !

