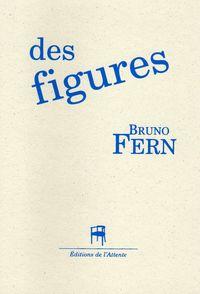 Lire l’oblique, lire d’oblique : la quatrième de couverture opère un premier glissement — il y en aura d’autres (de sens, de sons, d’évidences) — qui disjoint le déterminant et son nom désalignés/désaliénés. Oui, il se trouvera des figures, mais nous sommes prévenus : elles ne seront pas là où on les attend, et le regard devra travailler à les reconstituer ou à les imaginer, à la manière d’un puzzle dont une pièce échappée persisterait à relancer par sa marginalité notre curiosité.
Lire l’oblique, lire d’oblique : la quatrième de couverture opère un premier glissement — il y en aura d’autres (de sens, de sons, d’évidences) — qui disjoint le déterminant et son nom désalignés/désaliénés. Oui, il se trouvera des figures, mais nous sommes prévenus : elles ne seront pas là où on les attend, et le regard devra travailler à les reconstituer ou à les imaginer, à la manière d’un puzzle dont une pièce échappée persisterait à relancer par sa marginalité notre curiosité.
des figures : précisons qu’elles semblent être au nombre de quarante si on feuillette les pages de ce livre au carré. Mais ce recueil puissance deux s’achève sur un coefficient multiplicateur : « bis », syllabe magique qui encourage et guide une relecture par laquelle l’ensemble résonne autrement, au cours d’un parcours qui, cette fois, défigure ce que chaque page semblait avoir mis en place. Le poème est dérouté par lui-même, que ses lectures internes déconstruisent, désassemblent, ou au contraire consolident. On est déjà passé du quarante à son double, du latin au français, de l’adverbe multiplicatif à l’oiseau sacré vénéré par les Égyptiens : « Drôle d’oiseau que lit/de loin d’Égypte à nu/faisant avec ce qu’il a pu/dans celui-ci manque aussi une syllabe/c’est donc à répéter/ bis ». Et le voyage dans la langue ne fait que commencer…
Une page n’équivaut pas à un poème. Chacune ouvre, au moins, à deux poèmes. Une syllabe molécule, en haut sur la gauche, se détache d’une série versifiée et capte l’attention du lecteur. Cette syllabe titre, signifiant disjoint et lancé au-devant de lui-même, propose un horizon d’attente que chaque vers lui succédant viendra, brièvement, combler. Une syllabe clé qui ouvre aussi chaque vers à l’un de ses possibles. Une syllabe locomotive qui tire les vers comme autant de wagons d’un train électrique qui, à chaque page station, charge et décharge des morceaux de langue : citations (Apollinaire bien sûr, mais également Beckett, Quélen, Baudelaire ou Adorno), références, expressions toutes faites, proverbes, micro-fictions, fragment de dialogue. Et l’œil réalise alors que lire tisse du lien : délie, relie, casse et colle des morceaux d’une langue qui n’oublie jamais le sourire ni le clin d’œil. Une syllabe initiale qui, telle un coup de dés, n’abolit ni le hasard ni la nécessité. Ces poèmes jouent (à) l’entre-deux, ils se glissent dans l’ouverture d’un son — « Là », « Ef », « Sur », « Stup », « Cha », « Sus », « Con », « Bou », etc… — auquel ils proposent des enchaînements sonores complémentaires, et s’amusent à décliner des listes non exhaustives de propositions et d’alternatives. Avec malice, la voie (voix ?) du texte prend la tangente, conduisant notre regard et notre ouïe à un exercice permanent de va-et-vient qui constitue peut-être ce que l’orthoptie tente pour des yeux malades. L’œil écoute, certes, mais le poème se refuse à toute forme d’évidence.
Clic-clac, Rose déclic dirait peut-être Dominique Fourcade, moi lecteur j’allume j’éteins j’allume j’éteins j’allume j’éteins, quarante fois de suite, des embrayeurs qui donnent accès au texte sans pour autant le décharger de son déséquilibre constitutif. Cette série sans cesse interrompue fait la lumière sur le milieu intérieur du poème, fragmentation fluctuante au sein même de l’encadrement que constituent ses modes de lecture horizontaux, verticaux, mais essentiellement biaisés.
Flash.
Ces figures sans majuscule réalisent des petits circuits électriques pour lesquels la syllabe première manifesterait à la fois l’interrupteur et le point lumineux. En lisant j’allume la langue, et j’accepte le risque du court-circuit qui déstabilise l’ordre des possibles. Défiguration configuration refiguration : ces figures allumées et lumineuses éclairent quelques-unes des articulations décalées par lesquelles la langue n’est jamais tout à fait en chute libre, retenue par le vers, soutenue par le regard, maintenue par le souffle.
[Anne Malaprade]
Bruno Fern, des figures, Éditions de l’Attente, 2011, 48 p., 8 euros.

