
© Markus Rico
En septembre dernier, les Éditions Asphalte publiaient Les Eaux-fortes de Buenos Aires de Roberto Arlt, un recueil de chroniques écrites entre 1928 et 1933 pour le journal El Mundo dans lesquelles était décrite la vie des faubourgs portègnes et de ses figures légendaires : ses oisifs, ses paresseux et ses machos. Cet art de vivre que les lecteurs européens s’imaginent souvent être toujours la caractéristique de la capitale argentine n’existe pourtant plus depuis longtemps. En publiant aujourd’hui Golgotha de Leonardo Oyola, les Éditions Asphalte nous font découvrir un autre Buenos Aires. Les faubourgs où l’on dansait le tango ont cédé leur place aux villas miseria, à des bidonvilles où la violence se déchaîne sur le rythme déchaîné des guitares électriques (cf. playlist).Né en 1973, Leonardo Oyola est l’un des principaux représentants de la nouvelle génération des écrivains argentins. Golgotha est son troisième roman, le premier à être traduit en français. Comme l’écrit très justement Carlos Salem dans sa préface, Golgotha est un « western moderne ». Il s’agit d’un roman sans concession, d’une extrême violence, mettant en scène une police contrainte de livrer une guerre absurde et sans merci aux gangs qui règnent sur ces quartiers misérables.Entretien aimablement traduit de l’espagnol (Argentine) par Judith Vernant.
Éric Bonnargent : Parce que les écrivains argentins les plus connus et les plus lus en France sont Arlt, Borges et Cortazar, les lecteurs français ont une vision quelque peu surannée de l’Argentine. À lire Golgotha, on constate que l’indolence et la quiétude prêtée aux Argentins ne sont plus. Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de cette violence qui, à vous lire, semble régner aux périphéries de Buenos Aires ?
Leonardo Oyola : C’est douloureux à admettre mais ce n’est pas un fait nouveau : qu’on le veuille ou non, il existe dans mon pays une corruption institutionnalisée et impunie, et nous, les Argentins, en tant que société, avons développé un haut niveau de tolérance à l’égard des commerces illicites. Lorsqu’on parle de l’Argentine, on fait généralement référence à la Capitale fédérale, qui n’est qu’une partie de la province de Buenos Aires. C’est dans la zone qui entoure la capitale, le « conurbano bonaerense », que la vie est la plus dure, voire, si l’adjectif a du sens, la plus sauvage. Le manque d’éducation et la misère qui dominent rendent tout plus « primitif ». Et, face à un corps policier dépassé et mal préparé pour offrir un encadrement convenable, la justice individuelle et la loi du talion sont bien plus courantes que nous voulons l’admettre publiquement.
Lagarto, le narrateur, est un flic désabusé dont le métier l’oblige « à regarder ailleurs, à faire celui qui n’entend pas ». À l’inverse, Calavena a regardé et entendu et la guerre a été déclenchée entre la police et les villas. Y a-t-il une volonté délibérée des autorités d’abandonner les villas aux trafiquants ?
Certains lieux particuliers possèdent leurs codes propres, presque carcéraux. Celui qui tue, celui qui sort de prison puis retourne vivre à la villa s’attire le respect. Le destin consiste à rester vivre à la villa ou à en partir, point. Le destin est d’atteindre ses 18 ans. Si tu es une femme, il consiste à atteindre ses 18 ans sans être tombée enceinte, sans avoir de famille à charge. Il te reste alors encore une chance de sortir du bidonville. Mais dans le cas contraire, la pente à gravir sera dix fois plus raide. Si tu es un garçon, avoir 18 ans signifie mettre le turbo et aller travailler légalement, ou bien – s’il y a déjà eu délit – se consacrer professionnellement à la délinquance, en sachant que les peines infligées seront beaucoup plus sévères après la majorité. L’autorité publique et les gouvernements en place sont débordés par cette réalité. L’abandon de ces territoires peut être interprété comme une espèce de trêve tacite : « On ne s’implique pas, on regarde ailleurs, et vous ne vous comportez pas trop mal. » D’un certain point de vue, cela fonctionne, parce que la situation se maintient.
Vous écrivez que « la reine d’entre les reines n’est pas la mère du Christ. […] La reine d’entre les reines, ici et n’importe où ailleurs, est et sera toujours la Violence. Parce que ça, c’est une mère… la mère de tous les maux. Celle qui nous galvanise. » Croyez-vous vraiment que seule la violence anime les hommes et qu’elle soit inévitable ?
La violence, nous la portons tous en nous de manière latente. Malheureusement, elle est monnaie courante dans des contextes de marginalité et de pauvreté. Elle y est du moins plus visible. Dans mes autres romans et dans mes nouvelles, je flirte constamment avec les genres littéraires. J’aime beaucoup le fantastique et l’humour. Mais je ne transige pas avec mes terreurs : les fantômes et les monstres ne me font pas peur, mais un type qui porte une arme chargée, si. Pour revenir à votre question sur la violence, la Bible place le kilomètre zéro au moment où Caïn tue Abel. Je crois fermement que si Abel, ce « faible », avait su ce qui allait lui arriver, il n’aurait pas hésité une seule seconde à tuer son frère le premier. Parce que c’est une question de survie, et que la violence, quand elle se déchaîne, a un effet domino : elle engendre plus de violence.
Les titres des chapitres de Golgotha évoquent les différentes étapes de la vie de Jésus et il y a de nombreuses allusions à la religion, ne serait-ce que par le nom de l’un des personnages principaux : Román Abel Centurión, dit Calavera qui incarne la figure du Christ. L’action se passe pourtant dans un quartier où seul San La Muerte est vénéré. Pourquoi avoir choisi une telle construction ?
Parce que je voulais exprimer que nous pouvons tous crucifier, comme nous pouvons tous être crucifiés. En cela la religion chrétienne est un bel exemple de double morale. Calavera n’est que l’un des Christ de Golgotha, tout comme Kuryaki, avec qui Calavera se comporte littéralement un centurion romain, portant des clous pour ses pieds et pour ses mains. Ceux qu’on appelle les « saints populaires » dans mon pays – le gauchito Gil, San Jorge, San La Muerte – ont une relation plus distante avec l’Église mais pas avec les gens, qui les vénèrent en masse. San La Muerte est le Seigneur par excellence de celui qui va affronter quelqu’un ou quelque chose. C’est pourquoi il est à ce point vénéré par les délinquants les plus aguerris. L’une des prières les plus connues, qu’on répète comme un mantra, dit : « Seigneur La Muerte... Mort à mon ennemi ! » La proximité du combat et le combat proprement dit sont dans la nature même du « Santito » et dans la foi de son dévot, à fleur de peau. Pauvre de lui, celui qui affronte un homme qui a la Foi et qui porte un pistolet, car son adversaire est doublement armé.
Vos descriptions de l’accouchement du petit Nazareno, de l’avortement raté d’Olivia, du cadavre pendu de María Magdalena entre autres sont terriblement réalistes. Vous n’hésitez pas à peindre l’horreur, froidement, objectivement. Pourquoi cela ?
À cause du ton que j’ai choisi de donner au roman, et parce que le la voix du narrateur est celle d’un témoin. Les mots de Lagarto expriment la lassitude et la résignation. Un officier de police – comme un médecin ou un infirmier – qui travaille dans la ville où il vit finira par se trouver, dans l’exercice de ses fonctions, face à un voisin ou un être cher. Ce n’est qu’une question de temps. Aussi expérimenté soit-il, cela affectera l’objectivité de son travail. Son quotidien professionnel, parfois atroce, sort alors de sa routine apparemment inaltérable lorsque la victime est une connaissance. C’est ce qui arrive à Lagarto et à Calavera : ils ont vu de nombreux cadavres, mais le jour où l’un d’entre eux se trouve être un proche, ils doivent, de l’extérieur, demeurer stoïques, alors qu’intérieurement, ils sont entrés en conflit avec leur vocation. La colère contenue éclate d’un seul coup, ce qui n’est pas sain, et cela finit tragiquement. L’âme s’obscurcit. Et lorsque l’âme est noire et que noir est le cœur... là, il y a la mort. On m’a appris que l’âme était composée de quatre éléments : le devoir, l’amour, la peur et la colère. Et quand tous ces éléments sont en harmonie, l’homme est un être heureux et supérieur. Habituellement, l’un de ces quatre éléments s’impose aux autres, tout au long de la vie ou pour des périodes longues ou courtes, mais qui, en définitive, marquent et signent un chemin. C’est ce qui arrive à Calavera avec la colère, et à Lagarto avec le devoir. Leurs âmes sont gouvernées par ces sentiments et cela fait d’eux un duo dangereux : ensemble, ils sont la furie et l’impardonnable.
Le rock’n’roll semble avoir une influence directe sur votre écriture qui est rythmée, précise et acérée. Les citations en exergue de chacune des trois parties du livre sont d’ailleurs extraites de chansons de groupes de rock. Quelle est la place de la musique dans votre vie et comment vous influence-t-elle ?
Quand je me mets à écrire, la musique m’influence énormément. Et pourtant je n’y connais absolument rien. Je ne sais pas ce qu’est une partition. Je fais des playlists sur des CD, sur mon MP3 et sur l’ordinateur.[1] Je cherche à me faire contaminer par les rythmes. À voir ce que me transmettent ces morceaux. Pour moi, un chapitre doit avoir le rythme d’une chanson que j’aime, à cause de ce que me donne cette chanson. Ce que j’écris dans ma tête doit « sonner » comme ce morceau. C’est une chose que seul l’auteur peut ressentir. Je ne prétends pas que le lecteur le vivra ainsi, avec une telle exactitude : c’est impossible. Et, bien que j’écoute de tout et me nourrisse de différents genres musicaux, ça se termine toujours de la même façon. Avec le one, two, three, four ! J’ai Creedence, Johnny Rivers et les Stones dans le sang. J’ai le même moteur quand je me mets devant l’ordinateur et quand je vais danser : donner envie. J’espère que ça se voit.
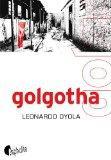
Leonardo Oyola, Golgotha. Éditions Asphalte. 14 €
Entretien initialement publié dans Le Magazine des livres (mars 2011)
[1] La playlist de Golgotha composée par l’auteur sera d’ailleurs disponible sur le site des Éditions Asphalte : http://asphalte-editions.com/blog/

