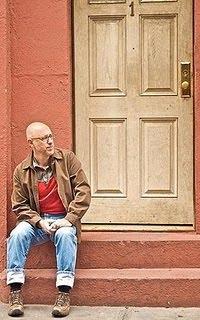
Ceux qui suivent ce jeune blog se seront je crois rendu compte de l'intérêt certain que je porte au travail littéraire de l'écrivain argentin Sergio Chejfec (Buenos Aires, 1956), dont l'œuvre jusqu'ici largement ignorée en France (sauf par la MEET, qui avait publié en 1996 le récit Cinq), connait actuellement une double actualité, avec d'une part la publication par l'excellente maison d'édition Passage du Nord-Ouest de la très belle traduction par Claude Murcia de Mes deux mondes, dernier roman en date de notre auteur, et d'autre part la publication de l'intrigant récit Les malades dans l'anthologie Nouvelles d'Argentine, publiée il y a quelques mois par Magellan & Cie (où Chejfec est par ailleurs bien entouré, puisqu'on y croise également Ricardo Piglia et Sergio Bizzio entres autres). L'auteur, qui commence également à faire son nid en Espagne, où l'éditeur indépendant Candaya à publié deux de ses romans, rencontrera n'en doutons pas en France également l'accueil que son œuvre subtile et pertinente mérite.
Dans cet entretien réalisé par mail et traduit par mes petites mains, il est question de quelques unes des caractéristiques du corpus chejfequien ainsi que de quelques auteurs dont les œuvres entrent ou n'entrent pas en résonance avec la sienne. Ayant déjà largement évoqué Mes deux mondes, ainsi que deux autres livres de Chejfec encore non traduits (El llamado de la especie, et El aire), je n'étendrais donc pas plus cette présentation, histoire de ne pas me répéter et de ne pas ennuyer mes lecteurs, et me permettrait donc cavalièrement de vous renvoyez directement à mes posts précédents. Passons donc sans plus tarder à l'entretien :
1/Je voudrais commencer en abordant la question du « je » et de sa présence dans votre littérature. Ce « je », on pourrait l’appeler « réflexif », et dire qu’en ce sens, il n’est pas celui de l’auto - fiction, sinon une sorte de « je » flottant, indéfini, voire timide. Comment et pourquoi avez-vous construit ce « je » très personnel, cette voix qui est celle de vos livres ?
Naturellement, le mot « je » est très chargé en hypothèses de diverses catégories, et ce tant depuis la critique comme depuis la fiction proprement dite. Pour cette raison, je préfère parler de narrateur. En général, dans mes récits, le narrateur est le personnage principal, même quand il s’agit, parfois, de narrations à la troisième personne. Ce sujet - narrateur qui est derrière chaque description, épisode ou réflexion, exerce des mouvements d’approche ou d’éloignement par rapport à ce qu’il dit et à ce qu’il considère comme son objet. Et par-dessus tout, il s’interroge de manière plus ou moins directe sur ce que signifie ce qu’il observe et relate. Ces mouvements ont pour résultat différentes formes ou masques du narrateur, qui généralement tendent vers ce mode que vous décrivez, flottant, indéfini ou hésitant.
Peut-être est-ce ainsi parce que les narrateurs qui racontent ne me plaisent pas, contrairement à ceux qui interprètent. Demander au narrateur qu’il se contente de raconter, c’est le condamner à l’innocence, ou pire, à l’ingénuité.
2/Dans Mes deux mondes, le narrateur semble par moments se déprécier volontairement, comme si c’était là une façon d’être. Cette autodépréciation serait-elle alors l’ouverture permettant à l’environnement de se faire plus tangible, et devenir ainsi « romanesque » ? Le lecteur à parfois l’impression que le narrateur se doit d’être sans qualités pour pouvoir ainsi développer son observation du réel comme si le « je » devait s’effacer pour laisser passer sa pensée. Qu’en dites vous ?
Je crois que cela a indirectement à voir avec le type d’assurance que nous cherchons dans les récits. La littérature doit-elle avoir un discours affirmatif ? Les récits doivent-ils déclarer quelque chose en particulier ? Nous plaisent-ils, ou nécessitons nous que les romans nous signalent que la vérité est une et une seule, qu’elle est ici, visible, et que le roman lui-même nous la signale ? Ou préférons nous les romans qui proposent une relation plus insidieuse avec la réalité et la vérité ? Dans mes romans, le narrateur parfois n’est pas sûr de ce qu’il décrit et de ce qu’il pourrait vouloir dire. Non parce qu’il aurait une difficulté intellectuelle, du moins je ne le crois pas, sinon parce qu’au milieu d’un paysage culturel et historique complexe, il ne voit pas de motifs pour essayer de le simplifier en offrant une lecture « véritable ». Mais l’assurance est aussi un ton, une imposition du langage parlé ou de l’écriture. Ce qui revient à dire que par opposition, la perplexité, le doute, la confusion obéissent aussi d’une certaine façon à une construction rhétorique. Ainsi, de et par cette relation de méfiance envers la « vérité » et la « réalité », mes récits ne peuvent se prendre eux-mêmes très au sérieux. Ils se doivent d’installer et de proposer le doute sur eux-mêmes et sur ce qu’ils disent.
D’une certaine façon, je crois que c’est en cela que consiste la littérature. Non en un discours sûr de ce qu’il cherche à dire et convaincu de ses intentions, mais tout le contraire. De tous les textes discursifs que nous pouvons rencontrer, depuis les plus quotidiens comme la presse jusqu’aux plus sporadiques comme les modes d’emploi de machines et autres artefacts, en passant par les manuels universitaires et les dictionnaires, les déclarations politiques et les sentences juridiques, la littérature est la seule forme de discours dont l’intentionnalité est diffuse. De fait, personne n’attend la sortie d’un nouveau livre inconnu et personne n’est tout à fait sûr de l’utilité de ce qu’il lit.
3/ Dans Cicatrices de Juan José Saer, on peut lire cette fameuse affirmation du personnage Tomatis : « Il y a trois choses qui ont une réalité dans la littérature : la conscience, le langage et la forme. La littérature donne forme, à travers le langage, à des moments particuliers de la conscience. Et c’est tout. La seule forme possible est la narration parce que la substance de la conscience est le temps. » Il s’agissait à l’évidence pour Saer d’une sorte de définition programmatique pour sa propre œuvre, néanmoins et au-delà, je me demandais s’il n’y avait pas là une direction face à laquelle votre littérature pourrait se situer …
Je crois que Saer est un des rares écrivains qui a su synthétiser esthétiquement ce legs moderniste qui consiste à amplifier en mode littéraire, et plus particulièrement narratif, la scène de la conscience subjective comme noyau irradiateur de sens. Je crois que Flaubert, Proust, Joyce, Kafka, le Nouveau Roman, créent des modèles de représentation de cette conscience. Certains sont plus programmatiques ou fermés que d’autres. Saer les récupère et se nie à les considérer comme modèles « naturels » de représentation. C’est là où réside le grand secret et la timide génialité de Saer : il n’oublie jamais que ces modèles, même en leur forteresse persuasive, en leur éloquence, tendent naturellement à la convention. Cela fait de Saer un écrivain véritablement atypique, pour ne pas dire unique. Un écrivain qui se doit à un legs, mais qui s’en méfie.
4/ Dans vos récits, la nature occupe toujours un espace important, parfois presque fantastique ou inquiétant, parfois plus « objectif », mais toujours, disons, menaçant. Les animaux semblent aussi renvoyer à cette même menace, qui serait celle de notre origine. Dans Mes deux mondes, on peut lire : « le regard de l’oiseau installe [l’observateur] dans une stupeur des plus angoissantes, dans la mesure où il voit reflété le fond de violence d’où il vient et sa fatale origine ; je veux dire qu’il y voit à la fois de la pauvreté et du délire ». Ainsi, dans beaucoup de vos livres, nous rencontrons cette lutte entre ville et nature, serait-ce une façon d’actualiser l’axiome « civilisation et barbarie » ?
Je ne crois pas que cela passe par l’axe « civilisation - barbarie », même si, parfois, la tension entre ville et nature me semble très présente. C’est quelque chose qui nous traverse culturellement et politiquement en tant qu’habitants de n’importe quelle ville d’aujourd’hui. J’aime à penser les animaux comme des êtres nous assistant, comme des aides semi-artificiels pour créer un monde fabriqué qui ressemble au monde naturel. Je crois qu’il est déjà presque impossible de parler de nature au sens d’une « nature sauvage », il serrait plus judicieux de parler plutôt d’ « air libre », car ce que nous pouvons rencontrer aujourd’hui comme nature est une forme diversifiée de l’air libre. C’est pourquoi les formes « naturelles » ou « artificielles » de construction de la nature me semblent passionnantes, et je crois qu’elles sont d’une certaine manière présentes dans mes romans. Tout cela est lié au degré de réalité. Ma littérature est liée au fait que le construit, le fabriqué, l’artificiel, et particulièrement le délibéré, etc., tendent toujours à êtres plus réels que le spontané, le naturel, l’inespéré, etc.

5/ Dans Mes deux mondes, le narrateur semble être fatigué de ses continuelles promenades, comme s’il s’agissait d’une activité que la modernité aurait rendue stérile. Ce narrateur affirme ainsi : « en réalité, aucune marche ne m’a apporté d’authentiques révélations » et aussi : « je n’ai jamais rien rencontré, seulement une vague idée du nouveau ou du différent ». Le flâneur, aujourd’hui, ne peut donc rien espérer ?
Le flâneur trouva son apogée au XIXème et durant la première moitié du XXème siècle. Ce fut un haut moment de la sensibilité urbaine, qui identifiait le marcheur comme la subjectivité urbaine par excellence. Je crois que suite à une série de changement culturels, urbanistiques et économiques, le marcheur aujourd’hui n’est plus ce sujet urbain par excellence. Le flâneur traîne avec lui une espèce de sensibilité résiduelle. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas des personnes qui se sentent prédestinées à marcher et marcher au travers des villes, et de les apprécier à leur manière. Je suis un militant de ce type de déceptions. Je veux seulement dire que cette époque d’éclosion et d’apogée de la subjectivité marchante s’est conclue. Les sujets urbains sont maintenant les monuments, ou les corporations, ou les voitures, ou les marques de la ségrégation, selon la ville ou le pays. Puisque nous vivons encore dans des villes tributaires de ce moment de modernité maximum, la promenade finie parfois par être une activité de l’ordre du rite, de la coutume et de la déception.
6/ Vos premiers livres - El aire, El llamado de la especie, etc. – fonctionnaient de bien des façons comme des fables, alors que vos livres plus récents s'approcheraient plutôt de l'essai romancé. Néanmoins, dans les deux cas, la pensée en reste le noyau. Que signifie pour vous cette évolution ? Vos premiers livres semblaient posséder un ton plus expérimental, cryptique que ceux d’aujourd’hui …
C’est ainsi, les premiers livres avaient un propos délibérément plus métaphorique. Ces derniers temps, j’écris des textes plus « testimoniaux », pour les nommer d’une manière ou d’une autre. Malgré cela, je crois que l’intention métaphorique est toujours présente, à ceci près qu’aujourd’hui elle est à l’intérieur des textes, et non plus, comme auparavant, à la superficie. La fable, en tant qu’emblème d’un discours au signifiant précis, m’a toujours attiré pour son efficacité et sa simplicité. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il s’agit d’une forme qui donne pour acquise la confiance du lecteur face à ce qui est raconté, et qui s’appuie sur des hypothèses et des sens partagés. C’est étrange, car formulé ainsi, il pourrait sembler contradictoire que la fable me plaise. Mais la simplicité de ce qui ne se propose qu’une seule chose à la foi me semble émouvante et valorisable.
7/ Dans Baroni : un viaje, vous mentionnez l’écrivain uruguayen Mario Levrero, qui a développé dans son œuvre – particulièrement dans La novela luminosa, le livre cité dans Baroni – une approche du monde passant par une sorte de mystique animiste du quotidien. S’il n’y a pas de mysticisme dans vos livres, les narrateurs semblent malgré tout parfois y désirer quelque chose qui pourrait être un sens ajouté, une dimension supplémentaire impossible à trouver. Seriez-vous d’accord pour dire qu’en ce sens il y a des correspondances entre les deux œuvres ?
Je crois que s’il y a des correspondances entre certains des romans de Levrero et Baroni ou Mes deux mondes, elles passent par l’idée de montrer la construction du récit. Non pas la construction dans un sens structurel ou technique, sinon dans celui du développement de l’écriture, c’est-à-dire la superficie textuelle du roman en tant que produit des décisions du narrateur et d’évènements délibérés et qui se placent au même niveau que d’autres recours appartenant au champ de la « fiction » proprement dite.
Quant à l’inclination mystique, il se produit chez Levrero un mélange entre l’accident mystique et la péripétie de bande - dessinée. Le mysticisme de Levrero ne parvient pas à être transcendantal, jamais il ne s’envisage comme une expérience liée à un quelconque absolu, peut-être à cause du caractère ironique voire parodique de sa vision de la littérature, mais également à cause de la nature de ses protagonistes ou narrateurs, êtres névrotiques complètement inaptes à être des mystiques conséquents.
Pour ce qui est de mes romans, disons qu’il y a une sensibilité vers certains types d’expériences religieuses, voire, si le cas se présente, mystiques. C’est un regard un peu nostalgique, comme s’il s’agissait d’une disposition répandue, mais dont le narrateur ou personnage est dépourvu. Pour le dire d’une manière graphique, il m’arrive parfois d’être, sans être une personne religieuse, absolument sensible aux expériences religieuses des autres.
8/ La critique Beatriz Sarlo à dit : « Chejfec atteint une sorte de tranquille solitude au sein de l’espace nerveux des nouveautés littéraires. On a l’impression d’être face à un écrivain libéré des calculs, qui sait qu’il rencontrera ses lecteurs sans avoir à aller les chercher ». J’aimerais savoir si vous attendez quelque chose de vos lecteurs, et si de plus vous croyez en l’existence d’un lecteur disons « autonome », un lecteur libéré du marché de l’édition et de ses manipulations, un lecteur qui serait « authentique » …
Il y a un lecteur physique et un lecteur implicite. En général ils ne coïncident pas, bien qu’en certains cas si. Le lecteur physique (c’est-à-dire l’individu qui vit dans notre propre ville, ou dans une quelconque partie de la langue ou du monde, et dont les actions sont vérifiables, actions qui consistent par exemple à acheter un livre ou à l’emprunter dans une bibliothèque) n’est pas plus réel que le lecteur implicite (ce personnage caché dans tout récit et qui lit ce récit à mesure que l’auteur l’écrit et que le lecteur physique le lit). On pourrait dire que la littérature s’articule autour du lien entre ces deux lecteurs, et qu’une littérature se différencie d’une autre par la façon dont cohabitent ces deux lecteurs.
Je crois que chaque littérature, chaque auteur, crée son propre lecteur. Je ne me réfère pas seulement à ce lecteur intérieur, mais surtout à l’autre, au personnage social qui intéresse les statistiques. Peut-être est-ce parce que je vis hors de mon pays depuis longtemps - bien que tout ce que j’écrive je le publie en Argentine - que la figure du lecteur est pour moi un peu abstraite. À cela, il faut ajouter le fait que je ne crois pas que mes livres puissent un jour, ne serait-ce qu’un tout petit peu, connaître un succès massif. Dans tous les cas, je crois que pour moi le lecteur n’est pas un problème, je ne le perçois pas comme une partie de la réalité à laquelle je devrait être attentif, ou soigner, ou favoriser.
9/ Dernière question : j’aimerais savoir comment vous-même vous situez au sein de la littérature latino-américaine actuelle, et d’autre part ce que le succès surprenant et logique d’un Bolaño en Europe et aux Etats – Unis vous suggère …
Il m’est difficile de généraliser. Et n’importe quel regard qui se propose d’embrasser un panorama aussi ample doit le faire. De plus, je crois qu’aujourd’hui la littérature latino-américaine est plus diverse et plus polyfacétique qu’il y a quelques décennies. Et il me semble également que le « phénomène Bolaño”, plus qu’un signe de rénovation de la littérature latino-américaine, rend plutôt compte de l’extinction d’un modèle. C’est le dernier souffle de ce qu’offrit la littérature latino-américaine dans les années 50 et 60. On peut vérifier cela au sein de la textualité même de Bolaño : cette filiation continentale qu’il revendique, tout comme sa tendance à évaluer les autres écrivains latino-américains en termes de salvation ou de déroute. Je ne dis pas que c’est bien ou mal, seulement que de sa littérature irradient des signaux d’une étape en processus d’épuisement.
