Marc Villemain
Il n'est pas inintéressant de lire en parallèle Les dépossédés et Le style du monde. D’un côté, Robert McLiam Wilson, né en 1964 à Belfast, auteur de Ripley Bogle et de La douleur de Manfred, accompagné ici par Donovan Wylie, photographe qui, depuis l’écriture de ce livre hors norme, a fait du chemin et gagné bien des galons ; de l’autre, Vicente Verdu, souvent présenté comme l’intellectuel le plus brillant de sa génération, et qui est un peu à l’Espagne ce qu’Alain Minc est à la France, l’euphorie libérale en moins. Le premier nous parle de ceux que l’on a dépossédés – de leur maison, de leur famille, de leur argent, de leur travail, de tout –, le second de la marche obstinée du monde vers un progrès qui n’en finit pas de nous laisser sur la désespérante impression d’une fuite en avant, et qui pourrait bien nous revenir à la figure comme l’instrument de destruction de l’humanisme classique – thème sloterdijkien par excellence. Il n’y a pas, formellement, d’accointance particulière entre les deux livres. L’un est écrit par un observateur empathique des misères ordinaires et romancier unanimement célébré, l’autre par un docteur ès lettres diplômé de Harvard, par ailleurs journaliste vedette d’El País. L’écrivain nous ferait plutôt penser à Dickens, ou à Zola, l’universitaire évoquera plutôt Barthes, ou Finkielkraut – mais un Finkielkraut libéré des tentations de l’âge d’or. Les deux pourtant nous livrent les clés d’un monde dans ce qu’il a de plus inique (pour Wilson) et de plus inepte (pour Verdu), le premier en s’obligeant à habiter l’individu concret, broyé, anonyme, le second en cherchant à embrasser la plus grande totalité possible. En résulte pour le lecteur une semblable consternation, faite d’effroi, de compassion et de rage chez Wilson, de terreur technoïde et civilisationnelle chez Verdu.

Éditions Christian Bourgois
Robert McLiam Wilson et Donovan Wylie (dont on regrettera que les clichés très justes soient aussi médiocrement restitués) n’ont guère plus de vingt ans lorsque, à la naissance des années quatre-vingt dix, ils se lancent, stylo en poche et appareil photo en bandoulière, dans une vaste enquête sur la misère en Grande-Bretagne. Margaret Thatcher appliquait alors ses recettes à la lettre, et la mode occidentale profitait plus que jamais aux ultras du libéralisme. McLiam Wilson connaît la pauvreté pour l’avoir lui-même fréquentée de près. Mieux que d’autres, il sait qu’elle « est peut-être la seule expérience humaine, en dehors de la naissance et de la mort, que tout être humain est capable de partager ». Et en effet, « si nous continuons de nous intéresser à la pauvreté, c’est parce que bon nombre d’entre nous sentons qu’elle n’est pas très éloignée ». Ce contre quoi il se dresse finalement, en dehors de la misère elle-même et de ce mélange d’accoutumance et d’impuissance dans laquelle elle semble devoir nous plonger, c’est peut-être contre son abstraction grandissante, sa déréalisation : « Les innombrables discours musclés, l’idolâtrie de l’argent et l’autocélébration médiatique nous ont presque convaincus que la pauvreté n’est plus une situation humaine. Elle est devenue une idée, une notion anachronique. On ne la tient plus pour une entité qui écrase et détruit la vie des gens. La pauvreté a été annulée. » De fait (et le constat vaut pour la Grande-Bretagne de la fin du vingtième siècle comme pour la France du début du vingt-et-unième), les pauvres sont non seulement parqués, isolés, jetés aux périphéries ou directement en prison, mais de plus en plus ignorés, radiés, objets d’une idéologie statistique sans doute très utile aux grands équilibres, mais dont la dimension symbolique (« quelques petits chiffres trapus, suivis du signe dodu et rassurant du pourcentage ») contribue largement à leur éviction du système – d’ailleurs, « du point de vue du système, tu n’existes pas », déclare l’un d’entre eux. À sa manière, Vicente Verdu, dans Le style du monde, ne dit pas autre chose quand il écrit qu’un « gouvernement peut se régénérer de nos jours à condition de s’assujettir au programme de blanchiment dicté » par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale « (programme composé très souvent de recettes économiques provoquant l’appauvrissement des plus pauvres et l’augmentation du pouvoir du capital) ». Ce qu’il y a de poignant dans le livre de McLiam Wilson, et qui transforme son enquête sociologique initiale en expérience littéraire, c’est la qualité instinctive de son empathie pour celles et ceux qu’il rencontre. Car il s’agit bien du livre d’un écrivain, pour lequel « l’empathie nécessaire du roman constitue peut-être l’une des seules voies d’accès à la compréhension d’un tel phénomène ». Peut-être est-ce, en effet, ce qui donne toute sa force à ce livre, autrement plus puissant dans ses conséquences que n’importe quelle expertise sociologique. Mais il fallut pour y parvenir que McLiam Wilson fasse fi de toute idéologie, y compris d’un bourdivisme d’ambiance, qu’il bouscule quelques idées reçues, se fasse violence, témoigne des autres tout autant que de lui-même, et accepte de laisser parler ses ambiguïtés, ses peurs, ce que lui-même nomme souvent sa « honte ». Aussi le voit-on à un certain moment rebrousser chemin, n’ayant plus « ni la force émotionnelle ni la force morale indispensables pour témoigner des souffrances et des épreuves », et laisser le photographe poursuivre seul l’enquête à Glasgow. Cette sincérité devant l’épreuve empêche le livre de tomber à aucun moment dans l’affectation ou la sensiblerie : Wilson n’est pas dupe, pas plus qu’aucun des dépossédés qu’il rencontre. « Mon attitude mitigée a d’abord choqué légèrement Donovan, comme s’il fallait aimer tous les pauvres. Une telle idée relève de la sentimentalité bourgeoise de la pire espèce ». Il n’empêche : chaque être rencontré est extraordinaire de combativité, d’abnégation, de stoïcisme et de générosité. Tout ce que le bourgeois prend pour un vice dès lors qu’il est pratiqué par plus pauvre que lui (l’alcool, le jeu, la résignation, l’inactivité, la fertilité excessive, les heures accumulées devant un écran de télévision…) apparaît ici comme le trait distinctif de tout être qui aurait chuté, condamné dès lors à se débattre entre une société dont la machine judiciaire et administrative se fait chaque jour plus oppressante, les rêves qu’il fomente pour ses enfants, et une survie ordinaire dans des conditions que peu d’entre nous pourraient ne serait-ce que concevoir. Ainsi cette femme, dont le mari dépense trop au jeu – mais « trop », ici, est déjà très peu – et qui ne peut se résoudre à lui en vouloir, quelles que soient les difficultés (gravissimes) du foyer : elle sait et comprend en effet que, « dès qu’il dépense de l’argent, il se convainc qu’il n’est pas pauvre ». Il faut être dépossédé comme elle l’est pour cultiver pareille sagesse, et ne pas sombrer dans le moralisme sécuritaire autour duquel se dessinent souvent les programmes politiques de notre temps – et sans doute des temps à venir.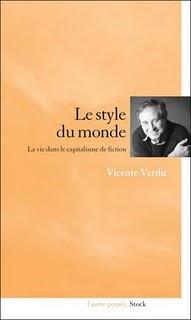
Éditions Stock
Lorsque Vicente Verdu, s’appuyant sur le Rapport annuel des Nations Unies de 1998, souligne que « les dépenses annuelles en parfums aux États-Unis et en Europe seraient suffisantes pour apporter une solution définitive aux problèmes de santé et d’alimentation sur toute la planète », et que « les achats de crèmes glacées en Europe dépassent le budget nécessaire pour couvrir les besoins sanitaires et d’eau sur terre », l’on ne peut s’empêcher de songer aux dépossédés de Robert McLiam Wilson. Car la terminologie compte : on ne parle pas ici de pauvres, mais de dépossédés, autrement dit de gens qui ont possédé et qui se sont vus peu à peu presque entièrement dépouillés. Le fait est, et Brice Matthieussent a raison d’y insister dans sa postface, que nous avons affaire à un « processus », et que Wilson aussi a raison lorsqu’il refuse la terminologie du « pauvre » et « s’insurge contre une telle naturalisation de la précarité ». Autrement dit, la foule immense des pauvres s’étend du fait de la déréliction planétaire économique, sociale et culturelle, rarement de son propre chef. C’est ici que, incidemment, Vicente Verdu vient non seulement corroborer mais étayer l’intégralité du constat dressé par Robert McLiam Wilson. Son sujet n’est pas la misère, mais le monde désormais tout entier lové au cœur du « capitalisme de fiction », ce capitalisme qui « ne pose plus comme objectif suprême la production des biens mais l’invention d’un état de choses conforme à nos désirs ». D’une écriture à la limpidité et la suggestivité exemplaires, Vicente Verdu remonte le fil de nos marottes, et tire aussi haut que possible le rideau qui nous masque la vraie scène contemporaine : nous nous croyons maîtres incontestés de nos désirs, seuls instigateurs de notre réalité, entrepreneurs raisonnables du futur, mais nous continuons pourtant d’être le produit de ce qui nous dépasse, le fruit putrescible d’un arbre dont nous ne voyons plus ni les racines, ni la cime. Tel est d’ailleurs le dessein véritable de ce nouveau capitalisme : il s’agit bien de « produire une nouvelle réalité présentée comme ultime », « une réalité de fiction ».Aussi la multiplication des clapiers identitaires (au mieux folkloriques, au pire terrorisants) ne doit pas faire illusion : c’est bien à l’homogénéisation du monde que besogne le capitalisme global. Sans doute la Chine observe-t-elle nos effritements en cours avec quelque gourmandise : il n’en demeure pas moins que les deux émissions de télévision préférées des Chinois en 2002 furent « X Files » et les « Teletubbies », et qu’il se boit chaque heure dans le monde pas moins d’un million de bouteilles de Coca Cola. Le désappointement au cœur de la réflexion de Vicente Verdu, dût-il parfois sembler expéditif, n’en est pas moins stimulant. Car une chose est la course du monde, une autre est ce qui le fait courir. Et si l’interrogation est permise dès lors qu’il s’agit de discerner ce qui nous attend réellement, la crudité du regard jeté sur les motifs, les fantasmes, les croyances et les ambitions du monde, touche souvent très juste. Ainsi, quand Verdu écrit que « la bataille en faveur des miséreux ne peut pas se passer de la vente aux enchères de manteaux d’actrices », ou encore que « jadis, les villes pouvaient être paralysées par les grèves générales ; aujourd’hui ce sont les matchs de football qui en sont responsables », nous ne sommes pas loin des Dépossédés de McLiam Wilson. Un peu à la manière d’un Slavoj Zizek, dont le Plaidoyer en faveur de l’intolérance pourrait faire figure de manifeste post-marxien, Le style du monde nous plonge dans une forme de mélancolie que vient teinter la nostalgie impossible, l’espoir déçu et l’impuissance militante. L’idiosyncrasie de la modernité – fût-elle post-moderne – n’en finit pas de charrier le pire en prêchant le meilleur : la démocratisation, la transparence, le métissage, l’art, tout ce qui aurait pu constituer le terreau, voire le fer de lance, d’une (re)politisation prometteuse n’en finit pas de s’essouffler et de mourir par inadvertance, indifférence, indolence. Nous détournons nous-mêmes de ses voies et de sa puissance tout ce qui pouvait nourrir le renouveau de la pensée politique. Il faut dire qu’il y a de la religiosité dans les fondements mêmes de nos croyances démocratiques, précisément parce que les fondements nous indiffèrent et que seules les croyances nous emplissent d’aise. Aussi la démocratisation ne réside-t-elle plus que dans « le droit de satisfaire le désir de devenir soi-même un événement », et ce faisant ne fait qu’apprêter son déclin en se condamnant au clinquant, au faux, au double, à l’esthétisation, au recyclage, à l’écologie comme ersatz de l’humanisme. C’est le mérite de ce livre de dire les choses sans ambages, sans souci de complaire aux progressistes vertueux, et tant pis si nous restons finalement un peu sur notre faim, à l’issue d’une exploration qui s’accommode parfois un peu vite de son diagnostic.
De l’optimisme comme du pessimisme, nous savons depuis longtemps ce qu’il faut penser : projection d’une complexion individuelle, manifestation exorbitante d’une psychologie singulière balayant de ses tourments l’image du monde, ils sont impuissants à en rendre compte. La rage, elle, est autrement plus fonctionnelle. Impuissante aussi, souvent, sans doute, mais suffisamment dérangeante pour contraindre le monde à la réaction. C’est là ce que ces deux livres ont en partage, celui de Robert McLiam Wilson, que taraude une rage immédiate et charnelle, celui de Vicente Verdu, que corrode une forme de désolation exaspérée. On dira peut-être que (le sentiment de) l’impuissance est toujours au bout du chemin. Mais c’est aussi à cela que tient la justesse de ces livres : à la pureté de leur inconsolable affliction.
Article paru dans la News des Livres de la Fondation Jean-Jaurès, novembre 2005

