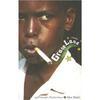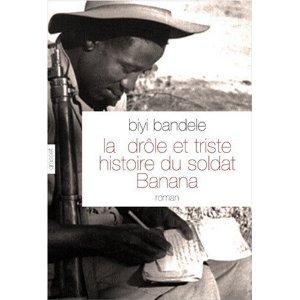 L’innocence est une vertu dangereuse, p. 239.
L’innocence est une vertu dangereuse, p. 239.
Voilà un livre d’une intensité formidable ! Biyi Bandele - écrivain nigérian né en 1967 - réussit la gageure à transcrire les boucheries des champs de bataille birmans durant la seconde guerre mondiale opposant les Japonais aux troupes coloniales britanniques. La drôle et triste histoire du soldat Banana est le tableau sans complaisance ni voyeurisme des souffrances et démences d’une soldatesque plongée dans une jungle démesurément terrifiante - divinité ogresse des temps légendaires -, quotidien des soldats nigérians venus renforcer les lignes alliées. Aucune place à la démesure métaphorique chère à Victor Hugo mais une plume pudique et nerveuse sourcilleuse du détail ; le mot d’ordre, ne pas tronquer l’histoire de ces africains engagés dans les sections « chindits », forces militaires conduites par le général Wingate - génie illuminé en rupture avec sa hiérarchie – envoyées derrière les lignes ennemies pour des opérations d’harcèlement.
Dans ces conditions extrêmes que peut bien faire ce bavard d’Haoussa, le Farabiti Banana, garçonnet candide de treize ans ? A-t-il voulu à l’instar de ses deux amis quitter son Nigeria natal et mentir sur son âge pour échapper aux remboursements de lourdes dettes ou encore voulu mécontenter son père ? Non, seulement fuir un patron tyrannique et voir du pays ; visiter cette Birmanie étrange vantée par les recruteurs militaires. Et aussi goûter du combat pour revenir sur sa terre natale avec l’aura du guerrier héroïque et faire taire ainsi les quolibets sur sa soi-disant naïve personne. Dès lors pas question pour lui d’être un simple muletier, état dégradant que lui réservent ses supérieurs. Que tout le monde le sache, Banana sera un guerrier « chindit » et rien d’autre !
De la jungle birmane, aucun salut à attendre : une fois atterri dans l’enfer vert, rejoindre à tout pris la « Ville blanche », camps des alliés, furoncle nauséabond en territoire ennemi encerclé de barbelés où pourrissent les corps de milliers de japonais abattus au cours d’offensives kamikazes. La couleur blanche ? Les toiles des parachutes, unique moyen de ravitaillement, qui recouvrent le champ de bataille et les alentours. Parmi les hurlements des obus que se lancent et relancent les ennemis, les cris sauvages et résignés des japonais qui s’acharnent désespérément chaque nuit, les odeurs méphitiques de la Mort se repaissent des cadavres en décomposition.
« Pendant les semaines précédentes, tandis que les attaques japonaises étaient devenues un simple désagrément nocturne quotidien, la forteresse avait pris l’allure d’un purgatoire habité par la mort et la maladie. L’odeur dans l’enceinte et à ses abords était devenue abominable. (…) Les effluves n’émanaient pas seulement des hommes qui avaient cessé de se laver depuis que la Rivière Boueuse était devenue une morgue flottante ; ils n’émanaient pas seulement des mules mortes dispersées dans tout le périmètre (…) Ils émanaient avant tout, sous une forme âcre et tenace, des corps en décomposition de près de deux mille Japonais accrochés en une infinie variété de contorsions morbides aux barbelés qui entouraient la forteresse (…) Dix mille charognards fondaient sur les barbelés chaque matin et ne repartaient qu’à contrecœur, quand les premiers seaux à charbon (obus japonais) arrivaient et qu’ils savaient que les hommes allaient se lancer une fois de plus dans cet étrange rituel, qui ne manquait jamais de remplir leur garde-manger consommé avec avidité (…) Avec les oiseaux arrivèrent les mouches. Il y en avait des millions qui vrombissaient partout dans la forteresse, plaie pire qu’un nuage de sauterelles », pp. 255 et 256
A l’enfer des assauts monstrueux succèdent les décomptes des cadavres, vieux compagnons d’infortune, alors que la paranoïa et la folie assaillent les survivants : les arbres se font kidnappeurs, son ombre, un ennemie à abattre, les lucioles, un nuage incendiaire démoniaque. Si le rire subsiste dans la section pour cause de réflexions farfelues du jeune Banana, il se fait toutefois de plus en plus rare maintenant que ce dernier perd son innocence, que la folie martèle sa quête d’héroïsme, que les sangsues deviennent ses compagnes obsessionnelles.
Merci à Biyi Bandele pour son immense mérite à redonner vie à ces hommes venus de lointains cieux pour une cause qui peut-être leur échappait… Etait-t-elle vraiment la leur ? Atrocités, férocités, courage, bruits, silences, verbe hésitant, mains tremblantes, frayeurs, rires, blagues douteuses, le romancier réussit un tour de force remarquable. Le phraser se fait simple et lapidaire, miroir des émotions et instincts des combattants. L’anglais maladroit teinté de Haoussa et d’autres idiomes vernaculaires africains accentuent le réalisme. Le soldat Banana et ses compères sont tout proches. La drôle et triste histoire du soldat Banana est incontestablement un roman indispensable. Le lire c’est peut-être rendre hommage à tous ces sacrifiés.
« Des mules ? s’étrangla Ali comme s’il avait été piqué par une fourmi voyageuse. Savez-vous qui je suis ? Je suis le fils de Dawa, roi des sourciers dont le nez béni pouvait sentir l’eau à Sokoto alors qu’ils se trouvait à Saminaka. Je suis le fils de Hauwa, dont la mère était Talatu, dont la mère était Fatimatu, reine du gâteau moelleux kulikuli, dont le souvenir fait encore saliver les vieillards jusqu’à ce jour. Notre peuple dit que la distance est une maladie ; seul le voyage peut le guérir. Croyez-vous qu’Ali Banana, fils de Dawa, arrière-petit-fils de Fatima, a traversé la grande mer et voyagé aussi loin, le fusil à l’épaule, pour veiller sur des mules ? », pp. 52 et 54
 Biyi Bandele, La drôle et triste histoire du soldat Banana, 2007, éd. française Grasset, 2009, 272 p.
Biyi Bandele, La drôle et triste histoire du soldat Banana, 2007, éd. française Grasset, 2009, 272 p.