 Sont-ce les tristes circonstances de ces derniers jours qui m’ont fait apprécier avec plus de facilité ce que les films avaient à m’offrir, ou est-ce une réelle hausse de la qualité, je manque de recul pour m’en convaincre, mais le fait est que j’aime presque tout au cinéma en ce moment. Et parce que ça m’a fait du bien, moi qui n’ai pas l’habitude de chroniquer tous les films que je vois, je vais aujourd’hui faire l’effort d’avoir un mot pour tous les films que j’ai vus ces derniers jours. Bien sûr je ne m’épancherai pas sur les qualités de Rabbit Hole, le beau film de John Cameron Mitchell, puisque j’en ai parlé hier. Tout comme j’en ai profité pour évoquer Le Chaperon Rouge (ouf, un des rares mauvais films vus ces derniers jours).
Sont-ce les tristes circonstances de ces derniers jours qui m’ont fait apprécier avec plus de facilité ce que les films avaient à m’offrir, ou est-ce une réelle hausse de la qualité, je manque de recul pour m’en convaincre, mais le fait est que j’aime presque tout au cinéma en ce moment. Et parce que ça m’a fait du bien, moi qui n’ai pas l’habitude de chroniquer tous les films que je vois, je vais aujourd’hui faire l’effort d’avoir un mot pour tous les films que j’ai vus ces derniers jours. Bien sûr je ne m’épancherai pas sur les qualités de Rabbit Hole, le beau film de John Cameron Mitchell, puisque j’en ai parlé hier. Tout comme j’en ai profité pour évoquer Le Chaperon Rouge (ouf, un des rares mauvais films vus ces derniers jours). Bon, le sans-faute n’a pas non plus été réalisé, puisque Scream 4 et Mon père est femme de ménage m’ont finalement laissés sur ma faim, le premier par abus d’effets de style saoulant, le second par une sympathie trop légère qui ne mène au bout du compte nulle part. Parlons des autres films, plutôt. Parlons de Source Code, le tant attendu second film de Duncan Jones, qui avait ébloui avec son premier essai Moon, et confirme ici qu’il est l’un des jeunes cinéastes les plus ambitieux et élégant en matière de science-fiction. Il propulse avec Source Code Jake Gyllenhaal dans une course contre la montre, le faisant revivre inlassablement les mêmes huit minutes dans la peau d’un autre afin d’élucider un acte terroriste.
Comme avec Moon auparavant, Jones surprend en poussant son film plus loin que ce qu’on attend de lui, s’intéressant tout autant aux questions éthiques et morales de notre société qu’à l’efficacité de son action. Le film court en ne choisissant pas la voie de la facilité, bousculant les attentes quitte à dérouter dans son dénouement. Il y en a deux qui bousculent eux aussi, d’une autre façon, ce sont les frères Farrelly avec leur opus Bon à tirer (B.A.T.), dans lequel les frangins à qui l’on doit les cultissimes Mary à tout prix et Dumb & Dumber (entre autres, bien sûr), ne reculent devant rien. Ils lâchent les brides de la réserve pour s’épancher dans le burlesque pur, osant le scabreux jusqu’au-boutiste comme au temps de leur gloire dans les années 90. Ils écorchent le modèle moral de la famille prisée par la comédie américaine pour la confronter à l’infantilité masculine et la tromperie féminine.
 Ces dernières années, les frères Farrelly sont tombés dans l’oubliette du box-office aux États-Unis, et si une fois de plus Bon à tirer est resté dans les limbes du business, les réalisateurs sont parvenus à dynamiter d’humour la pellicule, aidé par un duo Owen Wilson / Jason Sudeikis qui distille un mélange de candeur puéril et d’énormité hilarante qui fait mouche. Mes voisins de salle doivent encore se rappeler de mon rire explosif. Mais les américains n’ont pas l’apanage du rire en ce printemps. Stéphane Kazandjian réussit un petit tour de force avec Moi Michel G Milliardaire Maître du Monde, un faux documentaire qui se plait à tourner en dérision l’ultra-libéralisme via un faux personnage plus vrai que nature (hum… Jean-Marie Messier…), Michel Ganian, grand patron représentant à la perfection le capitalisme moderne, self made man pas si self made que ça, qui autorise un documentariste gauchiste à le suivre partout pour en tirer un film. La farce est grande, François-Xavier Demaison et Laurent Lafitte d’une complicité parfaite, et le cadre économique planté le fruit d’un travail monstrueusement bien fait. Le film est une comédie délicieusement inattendue.
Ces dernières années, les frères Farrelly sont tombés dans l’oubliette du box-office aux États-Unis, et si une fois de plus Bon à tirer est resté dans les limbes du business, les réalisateurs sont parvenus à dynamiter d’humour la pellicule, aidé par un duo Owen Wilson / Jason Sudeikis qui distille un mélange de candeur puéril et d’énormité hilarante qui fait mouche. Mes voisins de salle doivent encore se rappeler de mon rire explosif. Mais les américains n’ont pas l’apanage du rire en ce printemps. Stéphane Kazandjian réussit un petit tour de force avec Moi Michel G Milliardaire Maître du Monde, un faux documentaire qui se plait à tourner en dérision l’ultra-libéralisme via un faux personnage plus vrai que nature (hum… Jean-Marie Messier…), Michel Ganian, grand patron représentant à la perfection le capitalisme moderne, self made man pas si self made que ça, qui autorise un documentariste gauchiste à le suivre partout pour en tirer un film. La farce est grande, François-Xavier Demaison et Laurent Lafitte d’une complicité parfaite, et le cadre économique planté le fruit d’un travail monstrueusement bien fait. Le film est une comédie délicieusement inattendue.Au rayon bonne surprise, je plaide coupable devant Devil de John Erick Dowdle, éreinté par tous mais qui m’a malgré tout fait marcher. La faute en revient certainement à la patte Shyamalan, cinéaste qui tombe peu à peu au fond du gouffre mais ici producteur et auteur qui parvient à retrouver un peu de ce qui a fait le sel de ses meilleurs films, à savoir un sens du récit qui happe l’attention du spectateur avec cette histoire de cinq étrangers qui se trouvent bloqués dans un ascenseur qui pourrait bien se révéler être la dernière demeure de quatre d’entre eux... Certes il ne s’agit pas là d’un film d’épouvante majeur, mais il applique une narration posée à un concepte efficace, ce qui rend le film tout à fait prenant. Bien sûr pour ce qui est du récit, pour qui aime plus alambiqué il faut plus certainement se tourner vers Road to Nowhere.
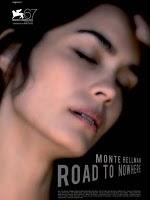 Premier film de Monte Hellman en plus de vingt ans, ce film indépendant américain ne se complait pas dans une idée classique du récit, préférant l’éclater, le tordre, jouer avec pour mieux tromper le spectateur. En cela il rappelle assez fortement le cinéma de David Lynch, poussant la confusion jusqu’à l’angoisse et cette sensation que le fantastique pourrait s’introduire. Il s’agit du récit d’un tournage, un film sur le cinéma et la création donc, dans lequel on ne sait jamais vraiment ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas. Hellman s’intéresse à la dualité des êtres et fait ainsi un gros clin d’œil à Mulholland Drive de Lynch, qui reste tout de même intouchable pour la sensualité, la terreur et le mystère. Baran Bo Odar regarde lui du côté de la Corée.
Premier film de Monte Hellman en plus de vingt ans, ce film indépendant américain ne se complait pas dans une idée classique du récit, préférant l’éclater, le tordre, jouer avec pour mieux tromper le spectateur. En cela il rappelle assez fortement le cinéma de David Lynch, poussant la confusion jusqu’à l’angoisse et cette sensation que le fantastique pourrait s’introduire. Il s’agit du récit d’un tournage, un film sur le cinéma et la création donc, dans lequel on ne sait jamais vraiment ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas. Hellman s’intéresse à la dualité des êtres et fait ainsi un gros clin d’œil à Mulholland Drive de Lynch, qui reste tout de même intouchable pour la sensualité, la terreur et le mystère. Baran Bo Odar regarde lui du côté de la Corée.Le jeune cinéaste suisse signe avec Il était une fois un meurtre, récemment récompensé au Festival du Film Policier de Beaune, un polar empruntant largement à Memories of Murder de Bong Joon-Ho. Je n’ai pas lu d’interviews d’Odar, mais pas besoin de sa confirmation pour voir dans son film une filiation avec le chef d’œuvre coréen. Comme lui, son film commence dans un champ de blé dans les années 80. Comme lui, ses flics se heurtent à un tueur insaisissable dans une province campagnarde, voyant leurs vies chamboulées et leur force mentale balayée par cette course dans le vide. En choisissant de montrer d’entrée de jeu au spectateur le visage des meurtriers, le réalisateur ne cherche pas à jouer la carte du suspense conventionnel. Il appuie sur les codes moraux, jonglant avec la fine ligne de l’humanisation de pédophiles. Il en fait trop, sûrement, mais son ambition explose à l’écran et impressionne, à défaut de forcer l’admiration.
 Admiration est un terme que j’emploierai en revanche volontiers pour qualifier Detective Dee : le mystère de la flamme fantôme. Tsui Hark, que l’on n’avait plus vu sur un grand écran français depuis Seven Swords, livre un morceau de cinéma virtuose, fringant et emballant. Son film, c’est Sherlock Holmes au temps de la Dynastie Tang, lorsque la jubilation du cinéma investigateur se métisse avec la flamboyance des wu xia pian. Il offre un spectacle mêlant le fantastique et l’épique, où le cinéma redevient un plaisir d’enfant, où l’écran projette les rêves de nos esprits. Le réalisateur hongkongais rend ses lettres de noblesse au cinéma d’aventures, lorsqu’il est question de plaisir pur à partager, s’amusant même au passage à caresser la censure dans le sens du poil en laissant le pouvoir triompher sur la rébellion, alors que le film en filigrane se plait à dresser un portrait manipulateur, tricheur et meurtrier de ce même pouvoir. Tsui Hark laisse éclater la parabole politique, offrant plusieurs degrés de lecture, promettant à ceux qui ne jurent que par l’évasion deux heures éclatantes, et à ceux aimant que leurs méninges soient mises à contribution un film où il est possible de décrypter un portrait on ne peut plus moderne de la Chine, derrière cette enquête sur de mystérieuses morts au 10ème siècle de notre ère, alors qu’une régente contestée est sur le point d’accéder au trône d’Impératrice.Le seul vrai reproche que je pourrais formuler à l’encontre de Detective Dee, c’est l’emploi peu convaincant de la HD numérique, certainement plus souple pour le cinéaste mais qui ne met pas en valeur la flamboyance que l’on attend du film.
Admiration est un terme que j’emploierai en revanche volontiers pour qualifier Detective Dee : le mystère de la flamme fantôme. Tsui Hark, que l’on n’avait plus vu sur un grand écran français depuis Seven Swords, livre un morceau de cinéma virtuose, fringant et emballant. Son film, c’est Sherlock Holmes au temps de la Dynastie Tang, lorsque la jubilation du cinéma investigateur se métisse avec la flamboyance des wu xia pian. Il offre un spectacle mêlant le fantastique et l’épique, où le cinéma redevient un plaisir d’enfant, où l’écran projette les rêves de nos esprits. Le réalisateur hongkongais rend ses lettres de noblesse au cinéma d’aventures, lorsqu’il est question de plaisir pur à partager, s’amusant même au passage à caresser la censure dans le sens du poil en laissant le pouvoir triompher sur la rébellion, alors que le film en filigrane se plait à dresser un portrait manipulateur, tricheur et meurtrier de ce même pouvoir. Tsui Hark laisse éclater la parabole politique, offrant plusieurs degrés de lecture, promettant à ceux qui ne jurent que par l’évasion deux heures éclatantes, et à ceux aimant que leurs méninges soient mises à contribution un film où il est possible de décrypter un portrait on ne peut plus moderne de la Chine, derrière cette enquête sur de mystérieuses morts au 10ème siècle de notre ère, alors qu’une régente contestée est sur le point d’accéder au trône d’Impératrice.Le seul vrai reproche que je pourrais formuler à l’encontre de Detective Dee, c’est l’emploi peu convaincant de la HD numérique, certainement plus souple pour le cinéaste mais qui ne met pas en valeur la flamboyance que l’on attend du film.Merci Duncan Jones, les Farrelly Bros., Tsui Hark et les autres, d’avoir contribué à égayer mes vacances parisiennes.

