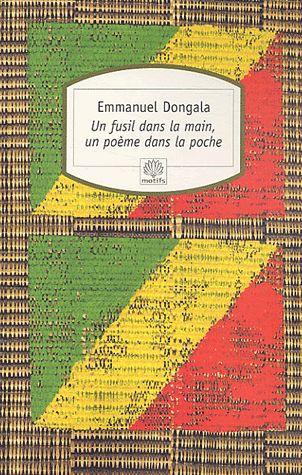 Un fusil dans la main, un poème dans la poche est le premier roman d'Emmanuel Dongala, publié en 1973.
Un fusil dans la main, un poème dans la poche est le premier roman d'Emmanuel Dongala, publié en 1973. L'auteur retrace les luttes armées pour une indépendance très couteuse, des espoirs d'un panafricanisme espéré comme salvateur et qui ne tient pas ses promesses. Ce qui n'est pas sans faire écho avec l'histoire du Ghana, toutes proportions gardées.
Emmanuel Dongala donne à voir une réalité où le tyran a une peau chargée de mélanine et les oppressés toujours les mêmes, où l'on troque le colon blanc pour le despote noir.Le titre du roman résume l'éclatante contradiction à laquelle Mayéla dia Mayéla est confronté : doit il se suffire du combat intellectuel en participants à des discussions ou bien mettre un poème dans sa poche et s'engager dans le combat le fusil à la main ?
Mayéla est un guérillero ambitieux, révolutionnaire et idéaliste. Il prendra partie lors de la de son pays pour l'indépendance. C'est un penseur qui, au delà de la théorie, se donne corps et âme dans la cause de la libération anti-colonialiste. Il atteindra son but en devenant président d'une jeune nation libre, mais les évènements le rattraperont, et l'ascension vertigineuse du libérateur prometteur laissera la place à une chute tragiqueDe la lutte intellectuelle puis armée dans les maquis d'Afrique , jusqu'au sommet du pouvoir. Mayéla incarne ce rêve porté et partagé par les Frantz Fanon (auteur de Peau noire, masques blancs, un indispensable), Amilcar Cabral et Patrice Lumumba.
"Un fusil dans la main, un poème dans la poche" est une métaphore des indépendances africaines, des troubles des périodes post-colonisation, et des désillusions qui s'en sont suivis.
Écrit au moment des indépendances africaines, ce roman reste d'une actualité déconcertante., pour s'en convaincre il suffit de jeter un œil à la presse .Loin de tout manichéisme Emmanuel Dongala a su retracer, avec la force poignante de l'expérience, les blessures d'un continent, d'une communauté, au devenir tout aussi difficile que son passé. Les innombrables références permettent au lecteur de se plonger dans une culture trop souvent négligée malgré son incontestable richesse, si souvent bafouée, spoliée sans cesse. C'est un fabuleux cri d'espoir à l'heure où tout un chacun s'accorde à courber l'échine devant ce qu'on nous présente comme une fatalité.
Dans la préface Emmanuel Dongala indique : « En ces années-là, comme la plupart des écrivains africains de ma génération, je me considérais comme un "écrivain engagé". Et quelles années ! C'était l'époque de la guerre américaine du Vietnam où par solidarité tiers-mondiste nous proclamions notre volonté, comme le prônait le Che, de créer à travers le monde plusieurs brasiers qui devaient consumer l'impérialisme occidental, c'était l'époque du grand mouvement des droits civiques de l'Amérique noire avec ses Malcolm X et ses Black Panthers, sur notre continent, celle de la lutte contre le colonialisme portugais et pour la libération de Nelson Mandela embastillé par le régime raciste de l'apartheid sud-africain. En tout cas, le fond de l'air était rouge et nous avions fait nôtre le slogan de Mao, "le pouvoir est au bout du fusil". (...) Le temps a passé. Mandela entre temps est devenu Président de la République et nos cousins Noirs Américains se font maintenant appeler Africains-Américains, preuve qu'ils n'ignorent plus l'Afrique. Nos livres, j'en suis convaincu, ont leur petite part dans ces victoires. Mais aujourd'hui les héros sont fatigués et les fusils donnent des enfants soldats. (...) Cependant, je crois toujours profondément que nous pouvons changer ce monde en un monde meilleur (...) ».
Extraits :
« (...) ; Marobi proposa à son compagnon d'aller dans un shebeen, un de ces bars clandestins où ils se rencontraient tous les week-ends et jours fériés pour oublier leurs soucis, pour essayer de retrouver leur âme au fond d'un verre et, surtout, se retrouver dans une atmosphère fraternelle. Mais même là-bas il fallait faire très attention car il y avait beaucoup d'espions parmi les Noirs ; l'ennemi du Noir n'a-t-il pas été le Noir lui-même, depuis le temps de l'esclavage jusqu'aujourd'hui ? N'empêche que ces shebeens étaient le seul endroit au monde où ils se sentaient vraiment hommes. Le jour, au travail, ils avaient le Blanc en face d'eux et ils devaient jour le rôle d'oncle Tom, se plier pour ne pas se briser ; le soir à la maison, si on était en congé, on retrouvait sa femme et ses enfants dont les regards insoutenables vous posaient d'une manière insupportable la question de savoir si vraiment vous étiez dignes d'être appelés des hommes, c'est-à-dire les protecteurs de la famille. Et le matin, lorsqu'ils se levaient pour se raser, ils avaient honte de voir leur visage, peur de penser à cette torture mentale qui allait recommencer dans la journée. Alors le soir, pour oublier tout cela, on se retrouvait au shebeen(...)- Vraiment je ne me sens pas bien.- Bois encore, dit Marobi en lui remplissant son verre de bière. Regarde, moi je commence à oublier.- Tu ne comprends rien. Bois, bois, tu ne sais dire que ça. Combien de barils d'alcool dois-je boire pour oublier que je suis un homme....- Si tu veux venger tous les affronts que t'a causés l'histoire, ta vie d'homme n'y suffira pas et je te plains sincèrement. Avant d'accuser ceux qui vendent vos parents partis pour La Mecque y conquérir le titre de Hadj, il faudrait d'abord évoquer la responsabilité de ceux de vos parents ou amis qui y vont tout en sachant ce qu'ils risquent. Aie le courage de reconnaître que peut-être, je dis bien peut-être, l'esclavage n'aurait pas pris cet essor sans la cupidité de certains potentats africains...."Le monde est une tanière où les plus malins utilisent les autres. Nous nous sommes laissés utiliser pendant longtemps, maintenant que nous avons appris, nous devons aussi savoir utiliser les autres pour pouvoir survivre. Désolé de le dire, mais le monde en est arrivé à ce degré de cynisme"...Après son deuxième repas de la journée, Mayéla se sentait bien mieux. Une bonne nuit de sommeil et il ne resterait rien des épreuves subies, à part les marques de fouet. "Mes stigmates" se dit-il en se moquant un peu de lui-même. La chambre était grande, propre, le lit bien fait, et il y avait un petit coin-toilette pour lui tout seul. Il était servi par une infirmière bien propre et bien belle. C'était cela le pavillon des fonctionnaires ! Il pensa à la salle où il se trouvait ce matin. Comment deux mondes aussi différents pouvaient-ils coexister, l'espace d'un couloir ? C'est cela l'Afrique, se dit-il, un monde sans juste milieu. Où l'on passe brutalement de la grande métropole qui vous rappelle New York par son atmosphère, sa superficialité et son égoïsme, aux villages perdus dans les immense savanes ou les profondes forêts. L'Afrique des nouvelles bourgeoisies possédantes avec pavillons spéciaux dans les hôpitaux, face à la masse paysanne dépourvue de tout, et s'entassant comme du bétail dans des salles que l'on imagine mal être des salles d'hôpitaux. Et lui, Mayéla di Mayéla, où était-il dans tout cela ? C'était plus facile de combattre les colons blancs que d'imaginer une société nouvelle après leur départ...."Peut-être l'histoire universelle n'est-elle que l'histoire de quelques métaphores." Et Kapinga d'ajouter :- ... l'histoire de diverses intonations de quelques métaphores. Après tout, pourquoi pas ? Mais cela n'est que coquetterie de littérateur. Moi, je suis plus matérialiste : l'univers est un gigantesque ordinateur où se trouvent réunies toutes les données - et toutes les solutions - du problème. L'histoire est le chemin qui mène de ces données aux solutions, d'où son importance. Tu vois maintenant pourquoi on parle d'un sens de l'histoire. Faire l'histoire n'est rien d'autre qu'imaginer la meilleure programmation des données menant à la meilleure solution. En d'autres termes c'est à nous de choisir, c'est-à-dire qu'il nous appartient de faire l'histoire....Et il se mit à penser aux femmes, comme ça. L'Afrique contemporaine avait trop tendance à négliger les femmes, pensa-t-il. Et pourtant, il ne pouvait y avoir le concept d'éternité sans la femme ; ce n'était pas pour rien que plusieurs sociétés africaines étaient matrilinéaires. L'homme, dans toute sa puissance, serait une manchot sans elle.»
Emmanuel Boundzéki Dongala est à la fois un écrivain et chimiste. Il est professeur de chimie et professeur de littérature africaine francophone. Considéré comme une figure majeure du renouveau de la littérature africaine, il puise son inspiration dans un monde bouleversé et cherche à lire et comprendre ce qui se cache derrière l'apparence des choses et des êtres. Emmanuel Dongala a une écriture d'une grande efficacité et mêle dans ses ouvrages, narration complexe, magie et invraisemblances.Né d'un père congolais et d'une mère centrafricaine, il a vécu l'essentiel de son existence au Congo Brazzaville, jusqu'à son départ forcé à la fin des années 1990, lorsque la république populaire du Congo était plongé dans la guerre civile. Il migre en 1997 vers les USA, grâce à un mouvement de solidarité animé par son ami et immense écrivain Philip Roth.
Son œuvre de romancier et de nouvelliste l’amène à explorer les maquis de l’Afrique australe comme dans Un fusil dans la main, un poème dans la poche. Avec Jazz et vin de palme, il aborde l’univers musical de John Coltrane et le quotidien de la vie congolaise.
Dans Johnny Chien Méchant, Emmanuel Dongala dresse un tableau saisissant de la violence inouïe qui a explosé avec la guerre civile congolaise, en décrivant les dérives meurtrières des enfants-soldats (ce roman a été adapté au cinéma en 2008 sous le titre de Johnny Mad Dog).
Bibliographie :
Photo de groupe au bord du fleuve (Actes Sud, Paris, 2010)
Johnny Chien Méchant (Le Serpent à plumes, Paris, 2002)
Les petits garçons naissent aussi des étoiles (Le Serpent à plumes, Paris, 2000)
Jazz et vin de palme (Le Serpent à plumes, Paris, 1996)
Le feu des origines (Albin Michel, Paris, 1987)
Un fusil dans la main, un poème dans la poche (Albin Michel, Paris, 1974 et réédition 2003 Le Serpent à plumes)

