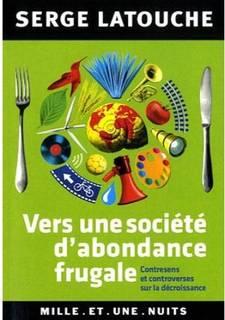 « Manquer de quoi que ce soit, quel supplice, manquer de tout, quel débarras ! », avait écrit Sacha Guitry. Cet aphorisme pourrait traduire, l’humour en plus, la notion de « sobriété heureuse » que propose l’économiste Serge Latouche dans son dernier essai, Vers une société d’abondance frugale (Mille et une nuits, 208 pages, 4,50 €). Le titre, pour le moins oxymorique, de ce livre semble d’autant plus séduisant que, dès les premières pages, il n’est question que de « l’ivresse joyeuse de la sobriété choisie » (p. 11), de « la redéfinition du bonheur comme “abondance frugale dans une société solidaire” » (p. 14) et d’un « modèle de société où les besoins et le temps de travail sont réduits, mais où la vie sociale est plus riche, parce que plus conviviale » (p. 38).
« Manquer de quoi que ce soit, quel supplice, manquer de tout, quel débarras ! », avait écrit Sacha Guitry. Cet aphorisme pourrait traduire, l’humour en plus, la notion de « sobriété heureuse » que propose l’économiste Serge Latouche dans son dernier essai, Vers une société d’abondance frugale (Mille et une nuits, 208 pages, 4,50 €). Le titre, pour le moins oxymorique, de ce livre semble d’autant plus séduisant que, dès les premières pages, il n’est question que de « l’ivresse joyeuse de la sobriété choisie » (p. 11), de « la redéfinition du bonheur comme “abondance frugale dans une société solidaire” » (p. 14) et d’un « modèle de société où les besoins et le temps de travail sont réduits, mais où la vie sociale est plus riche, parce que plus conviviale » (p. 38).
L’auteur part du principe que les ressources de la planète ne pourront plus longtemps alimenter une société fondée sur la croissance et la consommation – un constat probable, mais trop sérieux pour ne pas être examiné, chiffré, débattu, notamment quant aux solutions à apporter au problème. Or ici, la cause est déjà entendue : le développement durable ne suffira pas, les avancées scientifiques permettant d’économiser et de recycler non plus, il convient donc de changer radicalement de paradigme pour entrer dans l’ère de la « décroissance » (qui ne se confond pas, insiste-t-il, avec la « croissance négative »).
Tout l’essai s’articule autour « d’idées reçues » – le plus souvent développées par les adversaires de l’abondance frugale, auxquels Serge Latouche entend « régler leur compte » tout en fournissant un argumentaire à ses partisans. La décroissance ne serait donc ni contre la science, ni technophobe ; elle n’entraînerait aucunement un « retour à la bougie », ni à « un ordre patriarcal communautaire » ; elle ne provoquerait pas de chômage, tout au contraire ; elle serait en outre « compatible avec la démocratie » et elle n’impliquerait pas de « réduction drastique de la population ». La lecture attentive du texte incite toutefois à nettement nuancer ces « vertus ». Car si, à aucun moment, l’auteur n’aborde clairement par le menu ce que serait notre vie quotidienne au sein de la société qu’il appelle de ses vœux, il est possible d’en dessiner les contours en puisant, au fil des pages, d’assez nombreux et étranges indices.
Nul n’est en effet besoin d’être un inconditionnel du néolibéralisme, loin s’en faut, pour s’inquiéter d’un mouvement qui, sans doute parti d’un sentiment noble et sincère, présente bien des aspects d’une nouvelle secte religieuse. Tous les ingrédients en sont réunis. A commencer par l’exploitation des peurs, dans un pur style pré-millénariste qui relègue Le Syndrome du Titanic de Nicolas Hulot au rang de rassurante bluette. Parce que la vision de l’avenir est ici résolument apocalyptique : si l’humanité n’adoptait pas l’abondance frugale, elle irait au désastre et même « les famines, les pandémies, les guerres ravageraient la planète et conduiraient à l’extermination des neuf dixièmes de l’humanité » (p. 136) ; plus loin (p. 143), il est question de ceux qui, par leur politique, « condamnent les deux tiers de l’humanité à l’extermination ». Deux tiers, neuf dixièmes ? On reste autant perplexe sur le chiffrage que sur son mode d’évaluation, qui aboutit à deux résultats différents. Mais, comme le souligne l’auteur lui-même, « reste la “pédagogie des catastrophes” pour accélérer le processus » ! Au moins, ne peut-on pas lui faire grief de dissimuler sa méthode pour emporter les convictions. Il est vrai que la peur, à la bourse des manipulations, reste l’une des valeurs les plus sures du marché idéologique, tous les prophètes de malheur (et tous les gouvernants) le savent.
Après avoir agité l’épouvantail des peurs, il est évident pour toute religion prosélyte de définir le Bien, représenté ici par les « objecteurs de croissance », adeptes de l’abondance frugale, et une forme de Mal, incarnée par tous les autres. Certains sont cités, tel Claude Allègre, qualifié de « savant fou » ; Alain Minc, lui, est exécuté en huit lignes plutôt savoureuses, l’homme d’affaires étant peu ou prou à l’économie ce que BHL est à la philosophie. D’autres ne sont désignés que par groupes ou écoles de pensée : si le modèle néolibéral – qui a prouvé ses limites lors de la dernière crise – figure logiquement en tête de liste, les économistes keynésiens ne sont pas mieux considérés. Plus surprenant encore, le développement durable dont on est en droit d’attendre beaucoup est présenté comme une « imposture planétaire » ! Finalement, martèle l’auteur (p. 47), « seule une rupture avec le système capitaliste, avec son consumérisme et son productivisme, peut éviter la catastrophe. »
Comme toute secte religieuse a besoin d’instaurer une fièvre obsidionale parmi ses fidèles pour entretenir la flamme et le sentiment victimaire, on comprend, au long des chapitres, que le petit nombre de ses élus, seuls détenteurs de la « Vérité », est cerné de tous côtés par les adversaires précités, de gauche comme de droite, journalistes inclus, lesquels ne reculeraient devant aucun moyen pour discréditer son programme et son credo. « Credo » est d’ailleurs le mot juste, car cette religion de l’abondance frugale emprunte au Christianisme d’autres composantes fondamentales : la culpabilisation, la rédemption par l’expiation et la contrition, ainsi que la promotion de l’idéal ascétique.
Au chapitre de la culpabilisation, l’essai dévoile un réquisitoire implacable contre les uniques responsables de la situation actuelle, les Occidentaux : « La société occidentale est la seule société dans l’Histoire qui a libéré […] les passions tristes : l’ambition, l’avidité, l’envie, l’égoïsme » (p. 96). Comme si ces « passions tristes » n’avaient jamais existé dans l’Histoire sur d’autres continents et hors du capitalisme (relisons la Bible où elles abondent !), comme si ces sentiments n’étaient pas simplement le propre de l’Homme, quelle que soit la latitude sous laquelle il vit. Le mythe rousseauiste (et raciste) du « bon sauvage » ne résiste pourtant plus, depuis longtemps, à l’analyse historique.

Il nous faudra donc, nous Occidentaux et surtout Européens, expier nos péchés à travers cette « société de décroissance [qui] se propose de faire le bonheur de l’humanité [sic] par l’autolimitation pour aboutir à l’abondance frugale ». Il est toujours prudent de se méfier de ceux qui veulent faire le bonheur de l’humanité. On sait à quelles dérives cette bien-pensance dangereuse aboutit souvent. Et le modèle proposé, en dépit d’épithètes rassurantes qui ne sont pas sans rappeler la sémantique maoïste des grandes années (joyeuse, conviviale, bonheur, etc.), trahit une évidente radicalité.
« La pauvreté matérielle, une certaine sobriété ont été, pendant des siècles et des siècles, des valeurs positives », justifie l’auteur (p. 162). C’est en effet autour de ces valeurs que s’articulent ses propositions. Quelles sont-elles ? : « Une réduction nécessaire des deux tiers de la consommation des ressources naturelles (pour la France) », une réduction drastique du temps de travail, une « culture du local », sorte de repli autarcique sur une communauté de proximité induite par la réduction des moyens de communication ; citons encore le démantèlement de la grande distribution, sans oublier le retour à la terre (parce qu’il faudra bien donner du travail à tous ceux que cette politique condamnera au chômage), une vieille recette qui, dans l’Histoire, de Vichy à Pol Pot, n’a pourtant pas laissé que de bons souvenirs ni de succès notables.
Serge Latouche se veut toutefois apaisant : « même si le recul de certaines consommations et productions est nécessaire pour retrouver une empreinte écologique supportable, il ramènera la France, toutes choses égales par ailleurs, au niveau des années 1960, qui ne sont pas tout à fait l’âge de pierre. » On respire. Son projet passe en outre par la « suppression des besoins inutiles (dégraissages importants dans la publicité, le tourisme, les transports, l’industrie automobile, l’agrobusiness, les biotechnologies, etc.) » (p. 93) et un « moratoire sur l’innovation technoscientifique et les grands projets (Iter, réseaux autoroutiers, lignes ferroviaires à grande vitesse) ». Une citation de l’économiste Silvia Pérez-Vitoria, favorable à l’agriculture d’autosubsistance, laisse même entendre que nous pourrions en revenir à la traction animale… Idée fort raisonnable au demeurant, comparée au projet de “micro-agriculture bio-intensive” de John Jeavons cité p. 156, projet qui « comprend le compostage de tous les déchets végétaux et animaux, y compris les corps humains post mortem » ! Quelle crédibilité peut-on accorder à une écologie radicale se fondant sur de tels délires ?
Comment l’auteur envisage-t-il l’adoption, par une population qui n’y est pas habituée, d’un tel mode de vie ? « Cette société devenue frugale par nécessité sera peut-être très contraignante », remarque-t-il sans rire. « Certes, poursuit-il, la voie de la sobriété volontaire et conviviale ne passera pas sans douleur. Qui est prêt à “renoncer” à sa voiture, à son lave-vaisselle, à sa résidence secondaire ou à ses voyages à travers le monde ? Qui réclamera la répartition de l’usage des ressources rares par un nécessaire rationnement plutôt que par le pouvoir d’achat ? » (pp. 95-96). Résidence secondaire, voyages à travers le monde ? Voilà qui trahit bien une mauvaise conscience de bobos et de quelques nantis ou aigris, peu de gens pouvant actuellement s’offrir l’une ni les autres. Quant à l’aspect « convivial », on peut craindre qu’il se traduirait par un retour à une société communautaire telle que l’a définie Gert Hofstede et telle qu’elle existe déjà en partie, notamment, en Asie, en Afrique et dans le monde arabe. Une société où l’individu n’existe qu’à travers son appartenance au groupe, où chaque membre du groupe se sent investi du pouvoir d’exercer la pression sociale sur tout autre membre afin de lui rappeler les règles à respecter, quand il ne va pas jusqu’à dénoncer les « déviants », où chacun, enfin, abdique sa part d’individualité au profit de la communauté, laquelle est le plus souvent patriarcale et fondée sur un ordre moral strict.
Pour tenter de nous convaincre, Serge Latouche nous fait bien miroiter le bonheur de « cultiver son jardin, cuire son pain, faire ses yogourts » (p. 80), une convivialité retrouvée, source de satisfaction durable et « dont le sens entre en résonance avec l’agapè de la théologie chrétienne ». Cette référence à la religion (ailleurs, il est encore question de « réaliser une conversion de masse » !) s’accompagne d’ailleurs d’une approche trop moralisatrice pour ne pas dissimuler d’arrières pensées : « les pollutions, les embouteillages, le tabagisme, l’alcoolisme favorisent la croissance » (p. 159). La cité rêvée sera donc sans voiture, mais aussi, manifestement, épurée, policée, sans tabac ni alcool… Qui sait ce que l’avenir d’un tel programme puritain nous réserve en matière d’autres interdits ? En revanche, on peut redouter que la corruption et le marché noir, qui demeurent les constantes des sociétés où l’on entretient la pénurie, connaîtront un avenir radieux.

Bien sûr, aujourd’hui, les idées développées dans cet essai - du moins les moins saugrenues - peuvent servir à nourrir le débat. Tous les projets alternatifs méritent examen et ne peuvent être écartés au seul motif d’un non respect de l’orthodoxie; c’est ainsi qu’une société peut évoluer. Cependant, une phrase de ce livre pourrait bien en décrédibiliser l’ensemble du contenu en dévoilant la dangerosité de l’entreprise. En effet, page 183, on peut lire : « Toutefois, à l’occasion d’une grande crise qui laisserait momentanément vacant le pouvoir détenu par les firmes transnationales, des alliances dans la diversalité des luttes et des initiatives pourraient favoriser la mise en place d’un autre monde. Ce n’est pas gagné, mais c’est le pari de la décroissance et il mérite d’être tenté. » En être réduit à envisager, voire à espérer une crise qui plongerait l’humanité dans le chaos, avec tous les drames humains qu’elle entraînerait, au seul motif de favoriser un modèle de société, voilà qui en dit long sur les intentions de ses promoteurs, pourtant si épris de « morale » et de « vertu ». Seuls quelques télévangélistes américains passablement allumés (et, eux aussi, très puritains) osent encore tenir un tel discours en appelant la fin du monde de leurs vœux dès qu’un conflit renaît au Proche-Orient. Où est donc l’humanisme dans tout celà ? Un pareil procédé, intellectuellement des plus contestables, devrait alerter jusqu’à ceux qui, de bonne foi, trouvent ce modèle séduisant. Guitry, cité au début de cet article, avait à ce propos un mot cruel : « Vos amis, qui vous prédisent des malheurs, en arrivent bien vite à vous les souhaiter, et ils les provoqueraient au besoin pour conserver votre confiance… »
Illustrations : Affiche de propagande agricole, Chine - Attelage animal, carte postale.

