
Crédits photo : Marc Villemain
Ainsi, donc, le plus grand texte en prose de Lionel-Édouard Martin aura (presque) partout essuyé des refus : l’histoire, c’est connu, est pleine d’ironie. Tant mieux, au fond : ce sera, c’est, déjà, l’honneur et la fierté du Vampire Actif, jeune maison qui s’était distinguée en exhumant Pétrus Borel le lycanthrope, d’avoir couru le risque de ce texte magnifique et supérieur. La vieille au buisson de roses est une œuvre tellement aboutie, tellement nécessaire, tellement viscérale aussi, où se joue, non une vision mais « une diction du monde », qu’on ne s’explique décemment pas qu’elle ait dû franchir tant d’années avant de trouver preneur, et qu’aucun éditeur n’ait jusque-là jugé bon de faire entrer dans l’histoire cette authentique leçon de littérature.Cela, je l’ai senti dès la première phrase – ces choses d’abord se sentent. J’ai commencé à souligner ; trop : je n’allais tout de même pas souligner le livre. Alors je l’ai ourlé – des grandes barres verticales décochées dans ses marges ; mais je n’allais pas non plus l’encadrer. C’est qu’il n’est pas une phrase qui n’y soit singulière, travaillée au poinçon ou rudoyée au grattoir, et toujours polie de cet éclat que le temps, l’expérience et le talent savent donner aux choses. Pas une phrase qui ne nous fasse extasier – et qui, ô sublime cruauté, ne nous accule à notre irrévocable modestie. Laisser tomber le stylo donc, et l’ourlet, et le soulignement. Et lire.
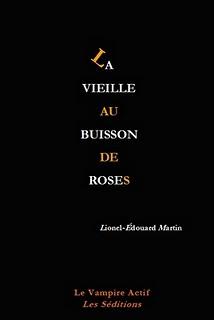
Éditions Le Vampire Actif
Et s’incliner devant l’humaine trinité que forment cette vieille, donc, qui va « dans le noir à la messe, avec pas grand monde », ce « Monsieur de Cruid, marquis de », et le chien, « Diurc » comme dit la vieille en lieu et place de « Duc », à cause que l’accent du coin « insuffle au français l’empreint de son argile. » Devant ces terres dont Lionel-Édouard Martin ne se défait pas et dont il fore, livre après livre, l’obsédant pourtour où s’enveloppent Montmorillon et sa Gartempe, là où la modernité s’obstine à résonner comme un mot creux, une coquetterie de « personnes de qualité ». Cette vieille n’est pas bien différente des autres, qui trimballent leur vie dans des tabliers où « s’ouvre une poche au niveau du nombril » ; d’ailleurs « leurs enfants sont de complexion sphérique ou tranchante, comme de vrais enfants, bons ou méchants, lesquels viennent aussi par le ventre – mais celui de la vieille femme n’a servi qu’aux autres fonctions, il a broyé des aliments, fait tourner du sang, brassé des chyles : mais vierge il est de toute besogne, de tout travail d’homme âprement sexué, n’ayant supporté de poids que celui des draps et des couvertures, et de l’édredon les nuits d’hiver. » Tout Martin est ici. Dans ce mot, non seulement juste, ça n’est même plus le sujet, mais réintroduit dans son rythme, dans sa chair et sa croûte, dans son odeur, son sang et sa généalogie. Tous ses livres parlent de ça, s’obsèdent de cette adéquation exemplaire, physiologique, du mot et de la chose, perpétuent ces mondes oubliés qui ont toujours en commun de n’être jamais oublieux de rien : mondes de mémoire, totale, envahissante sûrement ; d’autant plus douloureux peut-être qu’ils s’ébrouent dans un monde autrement vaste qui, lui, a fait de l’oubli et de l’effacement un combustible nécessaire à son désir, pas moins obsessionnel, d’avancer.Dans le monde de Martin il n’y a que des petites gens, souvent exemplaires, et quand elles ne le sont pas, leur vie est si peu moderne finalement, si peu rieuse, si peu causante, qu’elles en apparaissent toujours plus riches d’un certain courage à vivre. C’est le monde d’une abnégation qui n’est pas seulement matérielle, et où « on a peu l’occasion de parler : aussi, quand il le faut, toute la personne doit-elle s’atteler à la phrase, tirer à hue, à dia, pour la débourber de la chair » – quand d’autres s’embourbent « dans les mots grumeleux de consonnes. » C’est en qualifiant leur langue que Lionel-Édouard Martin campe ses personnages. A cette aune, la vieille, avec « sa propension à diéser le français », produit une langue qui n’est pas moins précieuse et délicieuse que celle de Monsieur de Cruid, marquis de, linguiste éclairé. Sa langue est parlée parce qu’elle ne peut autrement se concevoir. Alors, certes, on écrit, mais « en absence d’autrui, dans une solitude sans écho, tandis que remontent les paroles de l’enfance et le constant soliloque avec les choses évidemment sans réplique, si tragiquement muettes qu’on leur prête un dire et se donne l’illusion de ne pas murmurer dans le vide. » Car c’est toujours un risque de passer par l’écriture : elle n’est acceptable que dans le secret, ou sous la chasteté du voile – « c’est que dans les demeures, l’ombre écoute, ce n’est pas douteux. »
J’essaie de comprendre en quoi ce livre-ci atteint des sommets plus élevés encore selon moi que les précédents. En quoi il creuse l’écart – non tant dans l’acception sportive de la formule qu’en songeant au firmament, qui sépare les eaux supérieures des autres.
Il y a une raison, peut-être, qui pourrait ne point plaire au poète : ce livre porte une manière d’intrigue (derrière laquelle il ne court pourtant pas) et suscite une authentique et étrange attente romanesque : la vieille et le marquis, leurs deux mondes, vont-ils se rencontrer ? que va-t-elle devenir, elle, dans sa misère et sa folie ? et lui, dans son vieux manoir d’anachorète ? Diurc va-t-il retrouver un maître ? ou restera-t-il ce chien « sans race, vaguement ratier peut-être à l’origine ; et d’une vaste laideur de chien déformé par les aléas de l’existence, sevrage précoce, coups de pieds, heurs de véhicules, effets de l’âge, et l’eczéma qui lui rosit la peau sous un pelage blanchâtre à larges flaques de noir. » ?
Mais il y a, plus que tout, ce personnage central – entendez la langue. Nous y sommes, avec Martin, bien habitués déjà. Mais on dirait qu’elle a ici plus de corps encore : elle est une matière agitée, active, étonnamment polymorphe, jamais aussi près de saisir l’éclosion de toute pensée, avec ses ramifications spontanées, ses images concentriques, ces chemins imprévus qui ramènent toujours aux mêmes nœuds de l’existence, ceux de l’enfance, de ses sensations fugaces et fondatrices, de tout ce qu’il y a d’immémorial et d’incertain dans la souvenance. « La vieille se surprit à penser, comme jeune fille elle faisait, liant en écholalies les mots, cyclamen, quand l’archiprêtre lui déposa sur la langue l’hostie telle une fleur blanche qui lui serait poussée dans les entrailles, dans le creux de la faim, petite fleur dense, riche de paroles, éclose sur ses lèvres en motet Renaissance, comme, au printemps, donne à siffloter la tige de folle-avoine mâchonnée dans les prairies. » La langue de Lionel-Édouard Martin redonne de la matière au monde. Mais pas seulement. Elle lui réaffecte aussi une sensibilité que, par nos faubourgs urbains et technophiles, l’on dirait éteinte. Elle fait mieux que ressusciter les choses : elle les actualise. Avec ce texte, son plus magistral, son plus touchant aussi, l’écrivain est peut-être plus moderne qu’il ne le pense.
NB. En marge de cette parution, une petite affaire un peu désolante – mais qui, au moment où j’écris ces mots, semble sur le point de trouver son dénouement. Il se trouve que Le Vampire Actif, qui fait bien les choses, réalise un signet pour chacun de ses ouvrages – en l’espèce, une reproduction du retable de Schongauer, La Vierge au buisson de roses, datant de 1473. Or la paroisse Saint-Martin de Colmar, dont dépend l'Église des Dominicains où est exposé le tableau, a sommé l’éditeur de retirer ledit signet de la circulation, arguant d’un outrage au catholicisme. Outre qu’il n’eût pas été inutile de lire le livre afin d’échouer à y trouver la moindre trace d’un tel outrage, outre que la religiosité de la « Vieille », fût-elle « bigote », s’y révèle infiniment touchante, outre enfin que Lionel-Édouard Martin n’a jamais rien caché de son respect pour le culte marial où il a été élevé, le mobile de ce courroux s’avère bien plus prosaïque, relevant davantage d’une affaire de (même pas gros) sous. On s’étonnera tout de même, en passant, que des catholiques, dont nous croyons savoir qu’ils cherchent à redorer leur blason de par le monde et à faire face à des intégrismes autrement menaçants, témoignent d’une raideur aussi peu justifiée, et d’un sens aussi peu politique.
Article paru dans Le Magazine des Livres, n° 28, janvier/février 2011

