
Crédits photo : Marc Villemain
J’ai toujours pensé, pour connaître un peu ces bonnes vieilles terres du Poitou, que la mort y avait toujours quelque affaire en cours. Aussi m’a t-il été facile (mais l’écriture de Lionel-Édouard Martin, aigre, raffinée, lourde en corps, n’y est évidemment pas pour rien) de reconnaître ce « monde de lenteur » où « la mort donne à causer. » L’auteur est d’ailleurs comme hanté par ces existences paysannes, dont on dirait qu’elles traversent les siècles sans jamais rien attendre d’autre que le rendement de la terre, sans considération apparente pour la grande histoire, sans autre souci que le baromètre, la qualité des labours ou la santé des volailles, et où « le tantôt dominical est consacré à la visite d’une parentèle nombreuse. » Ainsi de l’oncle Ernest, qui s’en va, donc, à quatre-vingt sept ans, et qui n’est pas sans me rappeler ces anciens que je croisais enfant, tôt le matin en attendant le bus, vidant leurs verres de blanc sec avant de partir à la chasse et sirotant eux aussi « le cassis dru. » Le vieil oncle, avec son « béret sur l’occiput comme la tuile faîtière sur le toit de la grange », n’aura donc jamais attiré autant de monde que pour son dernier spectacle au cimetière – davantage encore que lors des veillées villageoises, où on l’imagine sans peine, gouailleur, déclenchant l’hilarité des hommes, embrasant les joues de ces dames.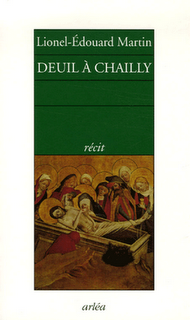
Éditions Arléa
On pense à Pierre Michon, à Richard Millet – quoiqu’il en manque, ici, la puissance narrative : cette manière de ressusciter l’inerte, de faire sourdre l’émotion sous les mots et les gestes les plus prosaïques, de trouver l’humain là où ne semblent se manifester que l’instinctuel, le physiologique, l’archaïque, d’aller le chercher là où le secret, le persiflage et la bigoterie constituent le lot commun de la communauté ; cette manière d’émouvoir le plus ordinaire. Car la paysannerie est ainsi faite qu’elle ne livre rien d’elle-même : toute affectation est impudeur, toute franchise scandale, toute liberté impertinence. Et puis il y a du corps dans ce récit, beaucoup de corps, et ça fleure bon le laurier-sauce, et coulent le vin « tout juste supérieur » ou « la gnole bien sauvage, pas même domestiquée par la barrique en chêne, l’âpre pissot qui goutte au canon de l’alambic et sent le propre, le nettoyant à décrasser les vitres, à restaurer la lumière », et le fumet des labours ou du lapin qui mijote se déverse comme le cri des poules et des enfants, et à la grisaille du petit matin fait contrepoint le grand soleil de quatre heures, celui qui « brille à plein cuivres et ors. » C’est une région tellurique où les vivants ne le sont pas moins, et c’est à cette terre secrète et sans histoire que s’attache Lionel-Edouard Martin, dans un récit qui ravira ceux, peut-être moins nombreux aujourd’hui, qui goûtent davantage à un style, à un rapport à la langue plutôt qu’à une intrigue ; il faut dire que l’auteur est surtout connu pour être poète, et que l’intrigue, dans la poésie, est le langage même.Article paru dans Le Magazine des Livres, n° 3, mars/avril 2007

