Mindflesh
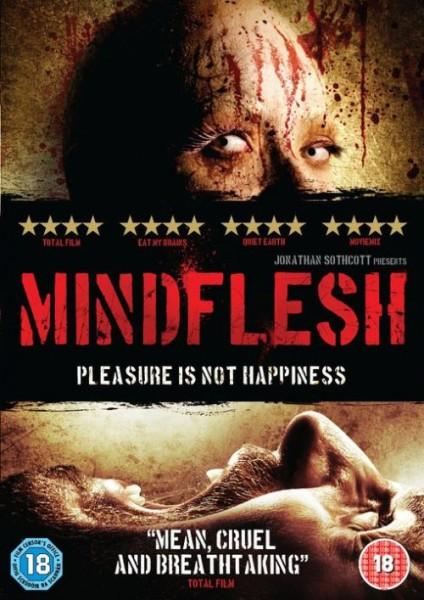 Résumé: Chris Jackson est un chauffeur de taxi obsédé par une femme mystérieuse qui lui est apparu régulièrement dans plusieurs quartiers de Londres. Tous les soirs, il prend le volant en espérant la recroiser et peut-être pouvoir lui parler avant qu’elle ne disparaisse de nouveau. Lorsque celle-ci finit un jour par apparaitre dans son appartement, il devient persuadé qu’il s’agit de la déesse d’un monde parallèle à laquelle il a ouvert une porte grâce à son esprit. Il s’engage alors dans une relation sensuelle avec la visiteuse, quitte à se perdre…
Résumé: Chris Jackson est un chauffeur de taxi obsédé par une femme mystérieuse qui lui est apparu régulièrement dans plusieurs quartiers de Londres. Tous les soirs, il prend le volant en espérant la recroiser et peut-être pouvoir lui parler avant qu’elle ne disparaisse de nouveau. Lorsque celle-ci finit un jour par apparaitre dans son appartement, il devient persuadé qu’il s’agit de la déesse d’un monde parallèle à laquelle il a ouvert une porte grâce à son esprit. Il s’engage alors dans une relation sensuelle avec la visiteuse, quitte à se perdre…
Mindflesh est un petit film indépendant britannique comme il s’en tourne des dizaines tous les ans. Tourné avec un budget dérisoire, le film de Robert Pratten intrigue d’abord avec son histoire étrange rappelant les premiers films de David Lynch. Seulement, Pratten n’a pas forcément les moyens de ses ambitions, et le côté fauché de son long métrage ne tarde pas à se retourner contre lui. Difficile en effet de parler de monde parallèle sans montrer celui-ci, ou d’afficher des monstres à l’écran sans trop dévoiler leur côté artificiel. Pratten tente de masquer la maigreur de son budget par des filtres colorés et autres effets (notamment l’image qui ondule), mais on a l’impression d’avoir affaire à des cache-misère cheap et rapidement redondants et agaçants. Le jeu assez approximatif de certains acteurs ainsi que le manque d’écriture des personnages n’aide pas non plus il est vrai à se passionner pour une histoire a priori nébuleuse, mais finalement très banale, avec un twist psychanalytique pas très finaud. Un film qui montre qu’au Royaume-Uni il est possible de trouver des fonds pour se lancer dans des projets fantastiques étranges, mais que malheureusement il faut plus pour faire un bon film…
Note : 2/10
Royaume-Uni, 2011
Réalisation : Robert Pratten
Scénario : Robert Pratten
Avec : Peter Bramhill, Chris Fairbank, Lucie Liemann
B. A. T. Bon à tirer (Hall Pass)

Hall Pass (on va éviter le titre français une fois de plus bien pourri) est la dernière comédie des frères Farelly, bien connus pour leur humour par toujours très fin mais d’une efficacité redoutable. Avec ce nouveau film, on sent que les frangins tentent de marcher sur les plates-bandes de l’autre roi de la comédie US, Judd Apatow. Hall Pass aborde en effet le genre de sujet typique des films d’Apatow (la « crise de la trentaine » de deux hommes mariés qui regrettent de ne plus avoir la liberté de draguer comme ils l’entendent). Mais la comparaison s’arrête là, puisque l’humour du film est lui typiquement « farellien », avec ces héros entourés de personnages tous plus tarés les uns que les autres, et de nombreuses blagues se passant en-dessous de la ceinture. Et il faut avouer que les Farelly n’ont pas leur pareil pour repousser toujours plus loin les limites du bon goût tout en restant hilarants. Certains gags tombent carrément à plat (la scène du jacuzzi avec exposition de pénis à tout va), mais il est impossible de ne pas se laisser emporter à un moment ou à un autre par le délire du film. Certaines scènes vont assurément rentrer dans le panthéon des films de frérots (la partie de golf sous influence de space cake, la séance de drague à coup de répliques à deux balles, la baston finale totalement hystérique). Owen Wilson et Jason Sudeikis forment un excellent duo, et Jenna Fischer et Christina Applegate apportent l’atout charme au film. Finalement, le seul gros reproche que l’on peut faire au film, c’est qu’il préfère foncer tête baissée dans les gags plutôt que de proposer un minimum d’interrogation sur cette fameuse crise de la trentaine. Ce qui donne au final une intrigue assez convenue et un final beaucoup trop bourré de sentiments et de politiquement correct pour pleinement convaincre. On aurait aimé un peu plus d’audace et de réflexion, mais mis à part ça le film est plutôt une bonne comédie rythmée et dynamique.
Note : 6.5/10
USA, 2011
Réalisation: Peter et Bobby Farelly
Scénario: Peter et Bobby Farelly, Pete Jones, Kevin Barnett
Avec: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Christina Applegate
World Invasion: Battle Los Angeles (Battle: Los Angeles)

Quelques mois après le sympatoche Skyline des frères Strause (oui, je sais que je dois probablement être la seule personne dans le monde à trouver ce film sympa), Los Angeles se retrouve de nouveau au cœur d’un conflit armé entre humains et aliens belliqueux. Mais ici, pas question de suivre un groupe de civils lambda, puisque Battle Los Angeles colle aux basques d’une unité de marines paumés au milieu d’un conflit qui les dépasse. La bonne idée du film c’est justement de ne pas faire de ces soldats des bidasses surhumains comme dans Aliens, mais une unité de marines normale, avec ses éléments forts mais aussi ses maillons faibles. De même, les personnages du film ne sont pas des héros partis pour sauver le monde, mais une unité chargée d’une mission basique : récupérer un groupe de civils et les ramener à la base. En clair, ils sont là pour sauver des vies sans se faire trouver la peau. Du coup, plus que d’un film d’invasion extraterrestre dans le genre d’Independance Day (dont Battle LA se moque gentiment à plusieurs reprises), le nouveau film de Jonathan Liebesman se raproche plutôt de La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. On retrouve le même sentiment d’urgence et de danger permanent, renforcé par une réalisation caméra à l’épaule plutôt maitrisée (à part dans la scène du pont dans laquelle on a du mal à comprendre comment sont placés les factions adverses). Du coup, le film va vite, et on n’a définitivement pas le temps de s’ennuyer.
Par contre, le contrepoint c’est que dès que Liebesman se calme et tente de jouer sur le côté émotionnel, Battle : LA se vautre lamentablement. La faute à des personnages peu développés et peu intéressants (mis à part Aaron Eckhart et Michelle Rodriguez, on les confond tous) et à des dialogues assez nazes (la scène d’émotion au cours de laquelle Eckhart console un gamin qui a perdu son père est un grand moment de comique involontaire). On pourra aussi reprocher au film de repomper pas mal d’idées à droite à gauche, comme une esthétique proche de celle de District 9 (le vaisseau-mère des aliens, le début de l’invasion racontée par les news TV). Mais Battle : Los Angeles réussit tout de même à remporter le morceau grâce à son dynamisme et à quelques idées bien trouvées (notamment une scène d’autopsie bien gore dans laquelle les marines s’acharnent sur un alien encore vivant pour trouver son point faible).
Pas un film spécialement mémorable, mais un honnête divertissement droit dans ses bottes et bien bourrin, qui parvient même la plupart du temps à éviter la guimauve patriotique.
Note : 6.5/10
USA, 2011
Réalisation : Jonathan Liebesman
Scénario : Christopher Bertolini
Avec : Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez
The Lincoln Lawyer
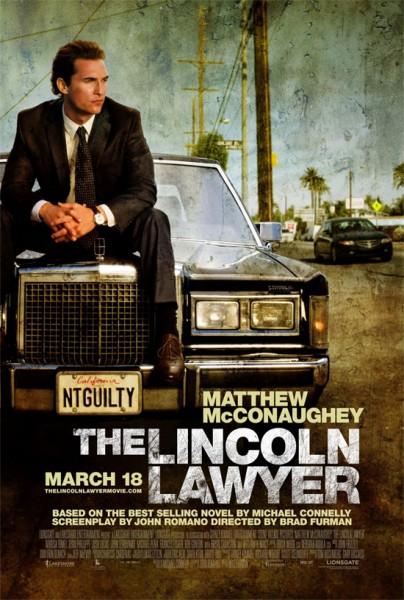
Alors que son confrère Dennis Lehane voit ses romans régulièrement adaptés au cinéma depuis quelques années (Mystic River, Gone Baby Gone, Shutter Island), Michael Connelly n’a pour le moment vu son travail porté à l’écran qu’une fois, avec le sympathique Créance de Sang de Clint Eastwood. The Lincoln Lawyer, comme son nom l’indique est un film de procès, genre dont les Américains sont très friands, et qui peut donner d’excellents thrillers (le génial Peur Primale, qui a révélé Edward Norton), ou des films mous du genou très dispensables (La Faille, avec Anthony Hopkins qui cabotine en tentant de refaire son Hannibal Lecter face à un Ryan Gosling peu convaincant). Dès le début du film, on est en terrain connu, avec cet avocat gouailleur et aux dents longues, prêt à défendre n’importe quel criminel pourvu que celui-ci ait de quoi payer. Et bien entendu, arrive le cas qui va pousser le héros à se remettre en question.
L’originalité de The Lincoln Lawyer réside cependant dans le fait que la question n’est pas ici de savoir si l’accusé est coupable (on nous révèle en effet au bout d’une vingtaine de minutes qu’il est bien coupable, et qu’en plus il a fait condamner un innocent pour un autre de ses crimes), mais comment le personnage de Matthew McConaughey va réussir à le faire condamner sans briser l’obligation de silence qui le lie à son client, et sans se faire rayer du barreau. Et la réalisation de Brad Furman a beau être assez poussive (il n’arrive même pas à créer de grandes envolées lyriques lors des plaidoiries des parties adverses), le scénario retords concocté par Connelly suffit amplement à maintenir l’attention jusqu’au bout. La dernière demi-heure est à cet égard assez jouissive, lorsque le plan d’Haller pour piéger son vil client se dévoile.
Niveau acteurs, Matthew McConaughey et Ryan Phillippe sont tous les deux excellents dans leurs rôles respectifs, le premier charismatique en diable, et le second effrayant et manipulateur malgré son visage d’ange. A leurs côtés, Marisa Tomei et William H. Macy incarnent malheureusement une fois de plus des seconds rôles sans réelle épaisseur, mais leur présence est toujours un atout, tout comme celle de John Leguizamo.
The Lincoln Lawyer ne restera certainement pas dans les annales, mais son scénario plutôt bien trouvé en fait un divertissement tout à fait recommandable.
Note : 7/10
USA, 2011
Réalisation : Brad Furman
Scénario : John Romano
Avec: Matthew McConaughey, Ryan Phillippe, Marisa Tomei, William H. Macy, John Leguizamo, Michael Paré
Pontypool
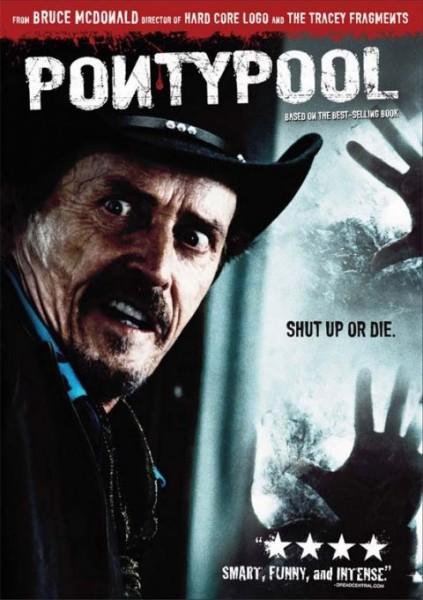
Enième histoire d’infectés surfant sur la mode du genre, Pontypool n’avait a priori rien de bien motivant. Pourtant, ce petit film canadien parvient à tirer son épingle du jeu grâce à deux facteurs. Tout d’abord le fait de se dérouler entièrement en huis clos, avec un nombre réduit de personnages, permet au film de Bruce McDonald de poser une atmosphère assez étouffante et paranoïaque. A l’instar du héros, coincé dans sa bulle de verre, le spectateur ne sait quasiment rien de la gravité des événements qui se déroulent dans la ville. Les seuls liens des personnages avec l’extérieur sont les lignes téléphoniques et un mystérieux signal en français. Du coup le sentiment de danger insaisissable est constant, même si on sent parfois que le film est très limité par la petitesse de son budget. Heureusement, Stephen McHattie est excellent dans le rôle de cet animateur désabusé, iconoclaste et alcoolique, et porte quasiment le film sur ses épaules. Ses partenaires à l’écran sont malheureusement un peu moins crédibles (notamment Hrant Alianik dans le rôle d’un médecin prodiguant de précieux conseils).
L’autre atout du film c’est l’originalité du mode de transmission du virus transformant les gens en zombies. Car en effet, dans Pontypool celui-ci se transmet par la parole. Et pour être plus précis, par certains mots de la langue anglaise (ce qui donne lieu à une scène assez marrante où les personnages parlent en français), qui font « bugger » les victimes. Une idée fichtrement originale et plutôt bien exploitée, même si on pourra regretter quelques facilités scénaristiques (le médecin qui a tout compris et qui débarque comme de par hasard pour aider les héros). Evidemment, le fait que le héros soit un animateur de radio est loin d’être innocent, puisqu’en tant que professionnel du langage, il est le plus à même de comprendre comment enrayer la contamination.
Même s’il est loin d’être parfait (on sent parfois que le budget était vraiment trop limité) et accuse quelques baisses de régime un peu gênante, Pontypool n’est pas sans évoquer le cinéma de John Carpenter, et mérite d’être découvert, ne serait-ce que pour l’originalité de son traitement.
Note : 6/10
Canada, 2008
Réalisation : Bruce McDonald
Scénario : Tony Burgess
Avec : Stephen McHattie, Lisa Houle, Georgina Reilly, Hrant Alianak
