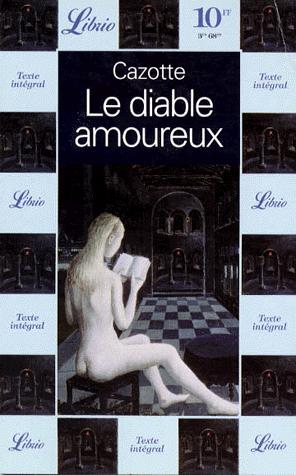
J'étais à vingt-cinq ans capitaine aux gardes du roi de Naples : nous vivions beaucoup entre camarades, et comme de jeunes gens, c'est-à-dire, des femmes, du jeu, tant que la bourse pouvait y suffire ; et nous philosophions dans nos quartiers quand nous n'avions plus d'autre ressource.
Un soir, après nous être épuisés en raisonnements de toute espèce autour d'un très petit flacon de vin de Chypre et de quelques marrons secs, le discours tomba sur la cabale et les cabalistes.
Un d'entre nous prétendait que c'était une science réelle, et dont les opérations étaient sûres ; quatre des plus jeunes lui soutenaient que c'était un amas d'absurdités, une source de friponneries, propres à tromper les gens crédules et amuser les enfants.
Le plus âgé d'entre nous, Flamand d'origine, fumait sa pipe d'un air distrait, et ne disait mot. Son air froid et sa distraction me faisaient spectacle à travers ce charivari discordant qui nous étourdissait, et m'empêchait de prendre part à une conversation trop peu réglée pour qu'elle eût de l'intérêt pour moi.
Nous étions dans la chambre du fumeur ; la nuit s'avançait : on se sépara, et nous demeurâmes seuls, notre ancien et moi.
Il continua de fumer flegmatiquement ; je demeurai les coudes appuyés sur la table, sans rien dire. Enfin mon homme rompit le silence.
“Jeune homme, me dit-il, vous venez d'entendre beaucoup de bruit : pourquoi vous êtes-vous tiré de la mêlée ?
– C'est, lui répondis-je, que j'aime mieux me taire que d'approuver ou blâmer ce que je ne connais pas : je ne sais pas même ce que veut dire le mot de cabale.
– Il a plusieurs significations, me dit-il ; mais ce n'est point d'elles dont il s'agit, c'est de la chose. Croyez-vous qu'il puisse exister une science qui enseigne à transformer les métaux et à réduire les esprits sous notre obéissance ?
– Je ne connais rien des esprits, à commencer par le mien, sinon que je suis sûr de son existence. Quant aux métaux, Je sais la valeur d'un carlin au jeu, à l'auberge et ailleurs, et ne peux rien assurer ni nier sur l'essence des uns et des autres, sur les modifications et impressions dont ils sont susceptibles.
– Mon jeune camarade, j'aime beaucoup votre ignorance ; elle vaut bien la doctrine des autres : au moins vous n'êtes pas dans l'erreur, et si vous n'êtes pas instruit, vous êtes susceptible de l'être. Votre naturel, la franchise de votre caractère, la droiture de votre esprit, me plaisent : je sais quelque chose de plus que le commun des hommes ; jurez-moi le plus grand secret sur votre parole d'honneur, promettez de vous conduire avec prudence, et vous serez mon écolier.
– L'ouverture que vous me faites, mon cher Soberano, m'est très agréable. La curiosité est ma plus forte passion. Je vous avouerai que naturellement j'ai peu d'empressement pour nos connaissances ordinaires ; elles m'ont toujours semblé trop bornées, et j'ai deviné cette sphère élevée dans laquelle vous voulez m'aider à m'élancer : mais quelle est la première clef de la science dont vous parlez ? Selon ce que disaient nos camarades en disputant, ce sont les esprits eux-mêmes qui nous instruisent ; peut-on se lier avec eux ?
– Vous avez dit le mot, Alvare : on n'apprendrait rien de soi-même ; quant à la possibilité de nos liaisons, je vais vous en donner une preuve sans réplique.”
Comme il finissait ce mot, il achevait sa pipe : il frappe trois coups pour faire sortir le peu de cendres qui restait au fond, la pose sur la table assez près de moi. Il élève la voix : “Calderon, dit-il, venez chercher ma pipe, allumez-la, et rapportez-la-moi.”
Il finissait à peine le commandement, je vois disparaître la pipe ; et, avant que j'eusse pu raisonner sur les moyens, ni demander quel était ce Calderon chargé de ses ordres, la pipe allumée était de retour, et mon interlocuteur avait repris son occupation.
Il la continua quelque temps, moins pour savourer le tabac que pour jouir de la surprise qu'il m'occasionnait ; puis se levant, il dit : “Je prends la garde au jour, il faut que je repose. Allez vous coucher ; soyez sage, et nous nous reverrons.”
Je me retirai plein de curiosité et affamé d'idées nouvelles, dont je me promettais de me remplir bientôt par le secours de Soberano. Je le vis le lendemain, les jours ensuite ; Je n'eus plus d'autre passion ; Je devins son ombre.
Je lui faisais mille questions ; il éludait les unes et répondait aux autres d'un ton d'oracle. Enfin, je le pressai sur l'article de la religion de ses pareils. “C'est, me répondit-il, la religion naturelle.” Nous entrâmes dans quelques détails ; ces décisions cadraient plus avec mes penchants qu'avec mes principes ; mais je voulais venir à mon but et ne devais pas le contrarier.
“Vous commandez aux esprits, lui disais-je ; je veux comme vous être en commerce avec eux : je le veux, je le veux !
– Vous êtes vif, camarade, vous n'avez pas subi votre temps d'épreuve ; vous n'avez rempli aucune des conditions sous lesquelles on peut aborder sans crainte cette sublime catégorie…
– Eh ! me faut-il bien du temps ?
– Peut-être deux ans…
– J'abandonne ce projet, m'écriai-je : je mourrais d'impatience dans l'intervalle. Vous êtes cruel, Soberano. Vous ne pouvez concevoir la vivacité du désir que vous avez créé dans moi : il me brûle…
– Jeune homme, je vous croyais plus de prudence ; vous me faites trembler pour vous et pour moi. Quoi ! vous vous exposeriez à évoquer des esprits sans aucune des préparations…
– Eh ! que pourrait-il m'en arriver ?
– Je ne dis pas qu'il dût absolument vous en arriver du mal ; s'ils ont du pouvoir sur nous, c'est notre faiblesse, notre pusillanimité qui le leur donne : dans le fond, nous sommes nés pour les commander…
– Ah ! je les commanderai !
– Oui, vous avez le coeur chaud, mais si vous perdez la tête, s'ils vous effraient à certain point ?…
– S'il ne tient qu'à ne les pas craindre, je les mets au pis pour m'effrayer.
– Quoi ! quand vous verriez le Diable ?…
– Je tirerais les oreilles au grand Diable d'enfer.
– Bravo ! si vous êtes si sûr de vous, vous pouvez vous risquer, et je vous promets mon assistance. Vendredi prochain, je vous donne à dîner avec deux des nôtres, et nous mettrons l'aventure à fin.”
Nous n'étions qu'à mardi : jamais rendez-vous galant ne fut attendu avec tant d'impatience. Le terme arrive enfin ; je trouve chez mon camarade deux hommes d'une physionomie peu prévenante ; nous dînons. La conversation roule sur des choses indifférentes.
Après dîner, on propose une promenade à pied vers les ruines de Portici. Nous sommes en route, nous arrivons. Ces restes des monuments les plus augustes écroulés, brisés, épars, couverts de ronces, portent à mon imagination des idées qui ne m'étaient pas ordinaires. “Voilà, disais-je, le pouvoir du temps sur les ouvrages de l'orgueil et de l'industrie des hommes.” Nous avançons dans les ruines, et enfin nous sommes parvenus presque à tâtons, à travers ces débris, dans un lieu si obscur, qu'aucune lumière extérieure n'y pouvait pénétrer.
Mon camarade me conduisait par le bras ; il cesse de marcher, et je m'arrête. Alors un de la compagnie bat le fusil et allume une bougie. Le séjour où nous étions s'éclaire, quoique faiblement, et je découvre que nous sommes sous une voûte assez bien conservée, de vingt-cinq pieds en carré à peu près, et ayant quatre issues.
Nous observions le plus parfait silence. Mon camarade, à l'aide d'un roseau qui lui servait d'appui dans sa marche, trace un cercle autour de lui sur le sable léger dont le terrain était couvert, et en sort après y avoir dessiné quelques caractères. “Entrez dans ce pentacle, mon brave, me dit-il, et n'en sortez qu'à bonnes enseignes…
– Expliquez-vous mieux ; à quelles enseignes en dois-je sortir ?
– Quand tout vous sera soumis ; mais avant ce temps, si la frayeur vous faisait faire une fausse démarche, vous pourriez courir les risques les plus grands.”
Alors il me donne une formule d'évocation courte, pressante, mêlée de quelques mots que je n'oublierai jamais.
“Récitez, me dit-il, cette conjuration avec fermeté, et appelez ensuite à trois fois clairement Béelzébuth, et surtout n'oubliez pas ce que vous avez promis de faire.”
Je me rappelai que je m'étais vanté de lui tirer les oreilles. “Je tiendrai parole, lui dis-je, ne voulant pas en avoir le démenti.
– Nous vous souhaitons bien du succès, me dit-il ; quand vous aurez fini, vous nous avertirez. Vous êtes directement vis-à-vis de la porte par laquelle vous devez sortir pour nous rejoindre.” Ils se retirent.
Jamais fanfaron ne se trouva dans une crise plus délicate : je fus au moment de les rappeler ; mais il y avait trop à rougir pour moi ; c'était d'ailleurs renoncer à toutes mes espérances. Je me raffermis sur la place où j'étais, et tins un moment conseil. On a voulu m'effrayer, dis-je ; on veut voir si je suis pusillanime. Les gens qui m'éprouvent sont à deux pas d'ici, et à la suite de mon évocation je dois m'attendre à quelque tentative de leur part pour m'épouvanter. Tenons bon ; tournons la raillerie contre les mauvais plaisants.
Cette délibération fut assez courte, quoique un peu troublée par le ramage des hiboux et des chats-huants qui habitaient les environs, et même l'intérieur de ma caverne.
Un peu rassuré par mes réflexions, je me rassois sur mes reins, je me piète ; je prononce l'évocation d'une voix claire et soutenue ; et, en grossissant le son, j'appelle, à trois reprises et à très courts intervalles, Béelzébuth.
Un frisson courait dans toutes mes veines, et mes cheveux se hérissaient sur ma tête.
A peine avais-je fini, une fenêtre s'ouvre à deux battants vis-à-vis de moi, au haut de la voûte : un torrent de lumière plus éblouissante que celle du jour fond par cette ouverture ; une tête de chameau horrible, autant par sa grosseur que par sa forme, se présente à la fenêtre ; surtout elle avait des oreilles démesurées. L'odieux fantôme ouvre la gueule, et, d'un ton assorti au reste de l'apparition, me répond : Che vuoi ?
Toutes les voûtes, tous les caveaux des environs retentissent à l'envi du terrible Che vuoi ?
Je ne saurais peindre ma situation ; je ne saurais dire qui soutint mon courage et m'empêcha de tomber en défaillance à l'aspect de ce tableau, au bruit plus effrayant encore qui retentissait à mes oreilles.
Je sentis la nécessité de rappeler mes forces ; une sueur froide allait les dissiper : je fis un effort sur moi. Il faut que notre âme soit bien vaste et ait un prodigieux ressort ; une multitude de sentiments, d'idées, de réflexions touchent mon coeur, passent dans mon esprit, et font leur impression toutes à la fois.
La révolution s'opère, je me rends maître de ma terreur. Je fixe hardiment le spectre.
“Que prétends-tu toi-même, téméraire, en te montrant sous cette forme hideuse ?”
Le fantôme balance un moment :
“Tu m'as demandé, dit-il d'un ton de voix plus bas…
– L'esclave, lui dis-je, cherche-t-il à effrayer son maître ? Si tu viens recevoir mes ordres, prends une forme convenable et un ton soumis.
– Maître, me dit le fantôme, sous quelle forme me présenterai-je pour vous être agréable ?”
La première idée qui me vint à la tête étant celle d'un chien : “Viens, lui dis-je, sous la figure d'un épagneul.” A peine avais-je donné l'ordre, l'épouvantable chameau allonge le col de seize pieds de longueur, baisse la tête jusqu'au milieu du salon, et vomit un épagneul blanc à soies fines et brillantes, les oreilles traînantes jusqu'à terre.
La fenêtre s'est refermée, tout[e ?] autre vision a disparu, et il ne reste sous la voûte, suffisamment éclairée, que le chien et moi.
Il tournait tout autour du cercle en remuant la queue, et faisant des courbettes.
“Maître, me dit-il, je voudrais bien vous lécher l'extrémité des pieds ; mais le cercle redoutable qui vous environne me repousse.”
Ma confiance était montée jusqu'à l'audace : je sors du cercle, je tends le pied, le chien le lèche ; je fais un mouvement pour lui tirer les oreilles, il se couche sur le dos comme pour me demander grâce ; je vis que c'était une petite femelle.
“Lève-toi, lui dis-je ; je te pardonne : tu vois que j'ai compagnie ; ces messieurs attendent à quelque distance d'ici ; la promenade a dû les altérer ; je veux leur donner une collation ; il faut des fruits, des conserves, des glaces, des vins de Grèce ; que cela soit bien entendu ; éclaire et décore la salle sans faste, mais proprement. Vers la fin de la collation tu viendras en virtuose du premier talent, et tu porteras une harpe ; je t'avertirai quand tu devras paraître. Prends garde à bien jouer ton rôle, mets de l'expression dans ton chant, de la décence, de la retenue dans ton maintien…
– J'obéirai, maître, mais sous quelle condition ?
– Sous celle d'obéir, esclave. Obéis, sans réplique, ou…
– Vous ne me connaissez pas, maître : vous me traiteriez avec moins de rigueur ; j'y mettrais peut-être l'unique condition de vous désarmer et de vous plaire.”
Le chien avait à peine fini, qu'en tournant sur le talon, je vois mes ordres s'exécuter plus promptement qu'une décoration ne s'élève à l'Opéra. Les murs de la voûte, ci-devant noirs, humides, couverts de mousse, prenaient une teinte douce, des formes agréables ; c'était un salon de marbre jaspé. L'architecture présentait un cintre soutenu par des colonnes. Huit girandoles de cristaux, contenant chacune trois bougies, y répandaient une lumière vive, également distribuée.
Un moment après, la table et le buffet s'arrangent, se chargent de tous les apprêts de notre régal ; les fruits et les confitures étaient de l'espèce la plus rare, la plus savoureuse et de la plus belle apparence. La porcelaine employée au service et sur le buffet était du Japon. La petite chienne faisait mille tours dans la salle, mille courbettes autour de moi, comme pour hâter le travail et me demander si j'étais satisfait.
“Fort bien, Biondetta, lui dis-je ; prenez un habit de livrée, et allez dire à ces messieurs qui sont près d'ici que je les attends, et qu'ils sont servis.”
A peine avais-je détourné un instant mes regards, je vois sortir un page à ma livrée, lestement vêtu, tenant un flambeau allumé ; peu après il revint conduisant sur ses pas mon camarade le Flamand et ses deux amis.
Préparés à quelque chose d'extraordinaire par l'arrivée et le compliment du page, ils ne l'étaient pas au changement qui s'était fait dans l'endroit où ils m'avaient laissé. Si je n'eusse pas eu la tête occupée, je me serais plus amusé de leur surprise ; elle éclata par leur cri, se manifesta par l'altération de leurs traits et par leurs attitudes.
“Messieurs, leur dis-je, vous avez fait beaucoup de chemin pour l'amour de moi, il nous en reste à faire pour regagner Naples : j'ai pensé que ce petit régal ne vous désobligerait pas, et que vous voudriez bien excuser le peu de choix et le défaut d'abondance en faveur de l'impromptu.”
Mon aisance les déconcerta plus encore que le changement de la scène et la vue de l'élégante collation à laquelle ils se voyaient invités. Je m'en aperçus, et résolu de terminer bientôt une aventure dont intérieurement je me défiais, je voulus en tirer tout le parti possible, en forçant même la gaieté qui fait le fond de mon caractère.
Je les pressai de se mettre à table ; le page avançait les sièges avec une promptitude merveilleuse. Nous étions assis ; j'avais rempli les verres, distribué des fruits ; ma bouche seule s'ouvrait pour parler et manger, les autres restaient béantes ; cependant je les engageai à entamer les fruits, ma confiance les détermina. Je porte la santé de la plus jolie courtisane de Naples ; nous la buvons. Je parle d'un opéra nouveau, d'une improvisatrice romaine arrivée depuis peu, et dont les talents font du bruit à la cour. Je reviens sur les talents agréables, la musique, la sculpture ; et par occasion je les fais convenir de la beauté de quelques marbres qui font l'ornement du salon. Une bouteille se vide, et est remplacée par une meilleure. Le page se multiplie, et le service ne languit pas un instant. Je jette l'oeil sur lui à la dérobée : figurez-vous l'Amour en trousse de page ; mes compagnons d'aventure le lorgnaient de leur côté d'un air où se peignaient la surprise, le plaisir et l'inquiétude. La monotonie de cette situation me déplut ; je vis qu'il était temps de la rompre. “Biondetto, dis-je au page, la signora Fiorentina m'a promis de me donner un instant ; voyez si elle ne serait point arrivée.” Biondetto sort de l'appartement.
Lire la suite :
