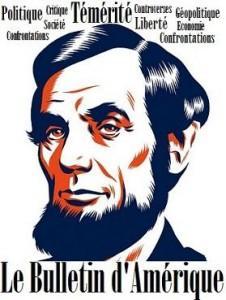
Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.
Par Damien Theillier*, pour le Bulletin d’Amérique.
Le 20 janvier 1981, il y a trente ans exactement, Ronald Reagan était investi comme quarantième président des Etats-Unis, après avoir été gouverneur de la Californie entre 1966 et 1974. Ecoutons (à l’aide du lecteur ci-dessus) un extrait de son discours d’investiture à la présidence des Etats-Unis : « In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem ».
« Dans cette crise actuelle, l’Etat n’est pas la solution à notre problème ; l’Etat est le problème. De temps en temps nous avons été tentés de croire que la société est devenue trop complexe pour être contrôlée par la discipline de chacun, que le gouvernement par une élite était supérieur au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et bien, si personne parmi nous n’est capable de se gouverner lui-même, alors qui parmi nous a la capacité d’en gouverner un autre ? »
Reagan disciple de Bastiat
Cette idée, qu’il faut démystifier l’Etat et réhabiliter la responsabilité individuelle, Reagan la tient directement de Frédéric Bastiat. Toute la pensée économique et politique de Reagan s’inscrit dans l’héritage intellectuel de Bastiat. Dans La Loi, le célèbre ouvrage de l’économiste français (1850), on peut lire : « Jetez les yeux sur le globe. Quels sont les peuples les plus heureux, les plus moraux, les plus paisibles? Ceux où la Loi intervient le moins dans l’activité privée; où le gouvernement se fait le moins sentir; où l’individualité a le plus de ressort et l’opinion publique le plus d’influence; où les rouages administratifs sont les moins nombreux et les moins compliqués; les impôts les moins lourds et les moins inégaux; les mécontentements populaires les moins excités et les moins justifiables; où la responsabilité des individus et des classes est la plus agissante ». Et Bastiat d’ajouter : « Il faut le dire: il y a trop de grands hommes dans le monde; il y a trop de législateurs, organisateurs, instituteurs de sociétés, conducteurs de peuples, pères des nations, etc. Trop de gens se placent au-dessus de l’humanité pour la régenter, trop de gens font métier de s’occuper d’elle. »
Et voici ce que disait Reagan dans un entretien avec le magazine Reason en 1975, alors qu’il était gouverneur de Californie : « I’m an inveterate reader. Bastiat and von Mises, and Hayek and Hazlitt. I’m one for the classical economists… »
De General Electric à Barry Goldwater
L’histoire commence dans les années 50, quand une grande entreprise américaine, la General Electric, décide de former ses cadres à la pensée économique. En partenariat avec la Foundation For Economic Education (Leonard Read et Henry Hazlitt), elle choisit les œuvres de deux Autrichiens, Hayek et Mises, de deux Anglais, Cobden et Bright, et d’un Français, Frédéric Bastiat. Et plutôt que de recruter un professeur d’économie, elle recrute un communicateur professionnel, capable de faire passer le message en termes simples : Ronald Reagan. En 1964, après 10 ans passés à transmettre les enseignements de Bastiat à travers tout le pays, Reagan soutient la campagne présidentielle du candidat républicain conservateur Barry Goldwater. Il prononce le 27 octobre à la télévision un discours resté célèbre : « A Time for Choosing ». Parlant au nom de Goldwater, Reagan y défend la nécessité d’un « small government ». Extrait :
« Soit nous croyons en notre capacité d’auto-gouvernement, soit nous abandonnons la révolution américaine et nous admettons qu’une élite intellectuelle peut, dans une capitale lointaine, planifier notre vie pour nous mieux que nous-mêmes. (…) Les Pères Fondateurs savaient qu’un gouvernement ne peut pas contrôler l’économie sans contrôler les gens. Et ils savaient que lorsqu’un gouvernement se propose de faire cela, il doit user de la force et de la coercition pour arriver à ses fins. Donc nous sommes arrivés au temps du choix. »
L’engouement des américains fut tel qu’il se traduisit par le versement d’1 million de dollars pour la campagne de Goldwater. Remarqué par des membres influents du parti républicain, Reagan se laissa convaincre d’entrer en politique. On connait la suite : élu comme gouverneur de Californie en 1966 et finalement à la présidence en 1980, remportant une victoire écrasante dans 49 Etats.
Du « New Deal » à la « Great Society » : une Amérique en crise
Revenons au discours d’investiture d’il y a trente ans : « La crise que nous devons affronter aujourd’hui exige que nous nous efforcions, avec toute la volonté dont nous sommes capables, de croire en nous-mêmes et de nous persuader que nous sommes en mesure d’accomplir des exploits. »
Reagan, en arrivant au pouvoir héritait de cinquante années de croissance ininterrompue du pouvoir étatique et de l’ingénierie sociale. En effet, l’extension de la sphère d’activité du gouvernement fédéral, inaugurée en 1933 par l’élection de Roosevelt à la Présidence des Etats-Unis, s’était poursuivie jusqu’à Jimmy Carter, en passant par John Kennedy et Lyndon Johnson. Le modèle dominant chez les intellectuels, dans les médias et jusque dans la Cour suprême était keynésien en économie, avec une intervention massive de l’État sur le marché de l’emploi, et progressiste en matière sociale, avec une politique des quotas et des programmes sociaux en tout genre. Il faut ajouter à ce tableau la contestation des valeurs morales traditionnelles avec la révolution culturelle sur les campus et le désastre de la guerre du Vietnam. Bref, au moment où Reagan accédait à la présidence, la société américaine était en proie à une profonde crise d’identité.
En annonçant sa candidature, Reagan avait prévenu : « nous allons défendre les principes de l’autodiscipline, de la morale et surtout de la liberté responsable de chaque individu ».
Seize jours après avoir pris ses fonctions, le 5 février 1981, il faisait le point sur l’état de l’économie dans son« Adresse au pays » et proposait ses premières réformes. Le texte est un peu long mais il mérite d’être cité tant il rappelle la situation de la France aujourd’hui :
« Bonsoir,
J’ai demandé ce temps de parole, ce soir, pour vous offrir un compte-rendu de l’état de l’économie de notre pays. Voici quelques jours, on m’a présenté un rapport que j’avais demandé aux fins de disposer d’un bilan complet de notre situation économique. Vous n’aimerez pas ce rapport, je ne l’ai pas aimé non plus, mais nous devons regarder la vérité en face, et nous remettre au travail pour améliorer les choses. Et que ce soit clair, nous pouvons tout remettre en ordre.
Je ne vais pas vous noyer sous la masse des statistiques, des chiffres et du jargon économique qu’on trouve dans le rapport, mais essayer de vous expliquer où nous en sommes, comment nous en sommes arrivés là et comment nous pouvons nous rétablir.
En préliminaire, cependant, je vais vous donner quelques « points saillants » du rapport. Le budget fédéral est hors de contrôle, et nous faisons face à un déficit croissant, 80 milliards de dollars pour l’exercice budgétaire qui s’achève le 1er octobre de cette année. Le déficit est plus élevé financièrement que le budget fédéral tout entier ne l’était en 1957. Tout comme les 80 milliards de dollars que nous payons en intérêt sur la dette nationale chaque année.
Voici vingt ans, en 1960, le registre des salaires de notre gouvernement représentait moins de 13 milliards de dollars. Aujourd’hui, la somme s’élève à 75 milliards de dollars. Au cours de ces vingt années, notre population ne s’est accrue que de 26,3%. Le budget fédéral, lui, a augmenté de 529%.
(…) En 1960, les taux d’intérêt pour les prêts d’accession au logement s’élevaient à 6%. Ils sont deux fois et demi plus élevés aujourd’hui, et atteignent 15,4%. Le pourcentage de notre revenu global que le gouvernement fédéral prélevait en taxes et impôts en 1960 a, depuis, doublé. Et enfin, 7 millions d’Américains sont prisonniers de cette indignité humaine et de cette tragédie personnelle qu’est le chômage (…). Qu’est-il arrivé au rêve américain : devenir propriétaire de sa maison ?
(…) En 1960, notre dette nationale s’élevait à 291 milliards de dollars. Le Congrès, en 1971, a décidé de plafonner à 400 millions de dollars notre capacité nationale d’emprunt. Aujourd’hui, la dette s’élève à 931 milliards de dollars. Le plafond de notre capacité d’emprunt a été relevé 21 fois au cours des dix dernières années, et je dois demander aujourd’hui un autre relèvement du plafond, car sans cela, notre gouvernement ne pourra plus fonctionner au-delà du mois de février. Et je ne suis là que depuis deux semaines…
(…) Une réponse aux déficits pourrait être d’augmenter les impôts de façon que le gouvernement n’ait pas besoin d’emprunter ou d’imprimer de la monnaie. Mais pendant toutes ces années où le gouvernement n’a cessé de grossir, nous avons atteint, et même dépassé, les limites de ce que notre peuple peut supporter en matière de charge fiscale. (…) Certains disent qu’il faudrait faire glisser la charge fiscale vers les entreprises ; or, les entreprises, ne paient pas d’impôts. Oh ! Ne vous faites pas de fausses idées : bien sûr que les entreprises sont imposées, et elles le sont tellement que les prix qui résultent nous excluent des marchés mondiaux. Mais les entreprises incorporent leurs coûts de fonctionnement, dont les impôts font partie, dans le prix des produits qu’achète le consommateur. Seuls les gens paient les impôts, tous les impôts. Le gouvernement se contente d’utiliser les entreprises d’une façon sournoise pour parvenir à collecter davantage d’impôts.
(…) Au cours des décennies passées, on a parlé de la nécessité de réduire les dépenses gouvernementales aux fins de pouvoir ensuite diminuer le fardeau fiscal. (…) Mais on a toujours dit que les impôts ne pouvaient être diminués tant que les dépenses n’étaient pas réduites. Nous pouvons reprocher à nos enfants de trop dépenser, et ce jusqu’à en avoir une extinction de voix : nous pouvons aussi remédier à la situation en diminuant la quantité d’argent que nous leur donnons. Il est temps de comprendre que nous sommes arrivés à un tournant. Nous sommes face à une calamité économique de proportions incroyables, et le vieux traitement habituel ne peut plus nous sauver. (…) Nous devons accroître la productivité, et cela veut dire remettre les Américains au travail. (…) Nous avons déjà décidé le non-remplacement des employés du gouvernement qui prennent leur retraite ou démissionnent. Nous avons ordonné une coupe dans les dépenses consacrées aux voyages du gouvernement, réduit le nombre de consultants travaillant pour le gouvernement, gelé l’achat d’équipements de bureaux, entre autres (…).
(…) Le 18 février, je présenterai un programme économique détaillé au Congrès, et ce programme donnera chair et consistance aux grandes lignes que je viens de tracer. J’y proposerai des coupes dans les budgets de presque tous les ministères du gouvernement. (…) Dès que les chefs de cabinet prendront la charge de leurs ministères, ils traqueront les gaspillages, les extravagances et les frais généraux inutiles qui, une fois supprimés, pourront permettre les réductions ultérieures. Tout en faisant cela, nous devons avancer dans le direction d’une baisse générale des impôts. Je demanderai une réduction de 10% de tous les impôts sur le revenu pour les trois prochaines années. Des propositions seront soumises visant à simplifier les formalités administratives des entreprises, et pour leur permettre aussi de disposer du capital pour créer des emplois.
(…) Nos coupes dans les dépenses ne se feront pas au détriment des vrais nécessiteux. Nous chercherons, cela dit, à éliminer les avantages sociaux accordés à ceux qui ne sont pas vraiment dans le besoin. Comme je l’ai dit plus haut : le 18 février, je présenterai de façon détaillée cet ensemble économique de coupes budgétaires et de réformes fiscales à une session jointe du Congrès, ainsi qu’à vous. Notre système est fondamentalement bon. Nous pouvons, avec compassion, continuer à assumer nos responsabilités envers ceux qui, sans que ce soit leur faute, ont des difficultés et ont besoin de notre aide. Nous pouvons pleinement assumer les autres responsabilités légitimes du gouvernement. Nous ne pouvons continuer plus longtemps le gaspillage qui se fait aux dépens de ceux qui travaillent et de nos enfants. »
(Source : Les écrits personnels de Ronald Reagan, traduction Guy Millière, Editions du Rocher)
La révolution Reagan n’a pas été le fruit d’un miracle ou d’un hasard, elle a été inspirée notamment par un économiste et écrivain français du XIXe siècle, Frédéric Bastiat. Reagan a-t-il été toujours fidèle à Bastiat ? Certains en doutent. Mais bien que la dette nationale américaine ait augmentée sous son double mandat, en grande partie du fait de l’ampleur des investissements dans le secteur de la défense, Reagan a réduit les dépenses intérieures, il a privatisé un certain nombre de services publics et a réduit fortement le fardeau fiscal sur des pans entiers de l’économie américaine, faisant baisser le chômage et générant une croissance durable. Et, chose remarquable, il a accompli cela malgré le contrôle de la Chambre par les Démocrates et, pour une partie, du Sénat.
______________
* Damien Theillier est président de l’Institut Coppet et enseigne la philosophie.
