On me demande souvent quel(s) livre(s) je retiens d'une année écoulée. La question est doublement difficile. D'abord, elle vous emmène sur un terrain glissant : celui des classements. Je commencerai à croire en leur vertu le jour où l'achat d'un livre ne sera plus lié aux conseils de mass media qui confortent trop souvent l'ordre établi, y compris « culturel ».
Comment choisir un seul ouvrage dans les plus de cent que je lis chaque année ? Comment en valoriser un alors que je ne suis pas sûr d'avoir eu en mains les romans les plus novateurs, les plus audacieux ? Et d'ailleurs, que signifient ces termes ? J'ai l'impression d'être assez éclectique dans mes choix mais je suis sûr que certains lecteurs de ce blog pourraient soutenir le contraire et conclure que je ne suis toujours attiré par une catégorie bien précise de livres.
En cette fin d’année, je veux bien consentir à vous dire quel est le livre qui m'a le plus marqué cette année. Il s'agit du dernier opus de Reinhard Jirgl, « Renégat, roman du temps nerveux », traduit de l'allemand par Martine Rémon aux éditions Quidam. Voici un livre que j'aurais volontiers défendu dans l'émission « Jeux d'épreuves » sur France Culture si un chroniqueur n'avait pas eu l'idée avant moi. Le journalisme, c'est aussi une question de rapidité.
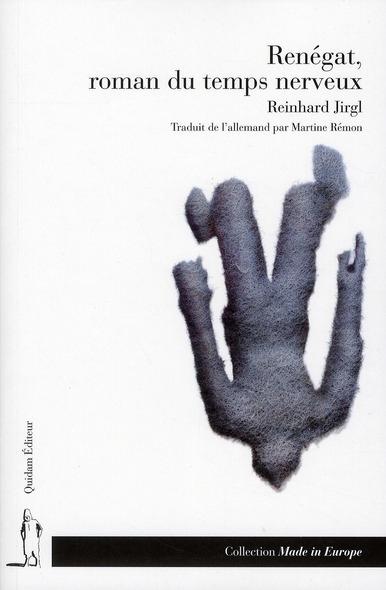
Drôle de titre dans lequel cohabitent trois termes qui sonnent agréablement à mes oreilles. Rappelons que le substantif « renégat » vient de l'italien rinnegato « qui a renié sa religion ». On peut lire positivement ce mot. Renier ses idées, ses opinions, sa patrie ou son parti est parfois nécessaire. Je pense qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un acte de faiblesse. « Roman du temps nerveux » : j'apprécie cette référence aux bruits du monde, à sa vitesse, à l'intranquillité à laquelle il conduit certains humains. Ce titre pose donc une ambition : celle de raconter la dissonance croissante entre une époque et un de ses « sujets ».
Cette dissonance est évidente au premier coup d’œil. La langue choisie ressemble de très près à la nôtre. Mais ce français a été attaqué, tronçonné, maltraité - saluons le formidable travail de Martine Rémon -.
Toutalentour les hommes & leurs histoires, qui font main basse=sur moi é qui me terrifient. Je les enfermerai dans Monlivre. Car la peur est la prison des mots. Je m’avance vers eux et m’aventure dans un Paysage Inconnu.
Nous voici à Berlin dans une période allant de 1989 à 2001. Le roman met en scène deux protagonistes. Ils déambulent dans la ville si chère à Alfred Döblin, l'auteur, entre autre, de Berlin Alexanderplatz. Parfois, ces deux voix ne semblent faire qu'une. Elles rappellent celle, souvent détraquée, de Bardamu dans le Voyage au bout de la nuit.
Etrange graphie donc à laquelle s'ajoutent des renvois à d'autres pages du livre, comme des encadrés. Je n'avais jamais vu cela avant. La difficulté de lecture qui s'ensuit est passagère. La distorsion entre une écriture classique et celle-ci est déroutante. Comme il est agréable d'être dérangé.
Si ce livre est un roman, ses traditionnels « codes » volent en éclats, tout comme la vie des deux protagonistes dont il est impossible de vous résumer les « aventures ». Disons que l'un poursuit une femme. L'autre en attend une. Le premier est journaliste, le second est garde-frontière. Nous suivons leur itinéraire. Où plutôt, nous les écoutons décrire cette vie, cette ville et les vices d'une société déshumanisante.
Comme du bétail, 1 prérogative d’esclave travailleur – chômeur – bénéficiaire de l’aide sociale - : aumône=quémandeur ; la chasse cynique à LARGENT dominateur du cerveau, du regard & de la volonté. C’est !ça la-ligne-d’horizon des voleurs et des agitateurs, des spéculateurs, des avocats sans causes, des boutiquiers & des politiciens de Parti, é : ça ne trouve pas plus de justification juste parce que LARGENT réussit à s’imposer par=Tout.
Les deux hommes sont des êtres pris dans un mouvement perpétuel. Le mouvement, c’est l’horreur. Il empêche l’homo-sapiens de se reposer. Il le tue lentement jusqu’au moment où la victime ne pourra plus rien contre les coups de boutoir de cette société qui vous jette comme un mouchoir quand elle considère que vous n'êtes plus bon à rien.
Mon père aussi fut licencié sans autre forme de procès. Après avoir travaillé plus de trente ans comme ingénieur – on l’avait souvent récompensé dans toutes-ces-années=passées, on lui avait donné primes & médailles ; et là d’1 jour-à-l’autre il valait moins que la vieille ferraille.
L'écriture de ce roman rend compte de tout ce qui se brise à l'extérieur comme à l'intérieur des êtres. Les mots deviennent alors comme de éclats de verre.
Car finalement, après tant=d’années de mariage, le-toujours-pensé n’arrivait plus à se penser jusqu’au bout - & ce-qu’il-y-aurait-à-en-dire revenait à regarder en-face la lumière vive du soleil : yeux=fermés et le point brûlant sur la rétine qui revient inlassablement comme une série d’échos du cerveau.
La brutalité environnante est omniprésente dans ce livre, elle s'invite presque dans chacune des phrases. Et pourtant, elle donne lieu à une forme de poésie qui m'a parfois rappelé l’œuvre d’un Georg Trakl.
Les compartiments des trains de banlieue plongés dans une brumasse de chaleur boursoufflée – les trains se frayent leurs voies en rugissant, - de bizarres ouvrages en fer ponts galeries canaux, la Spree qui a viré au goudronneux, la crasse des guerres putréfiées au fond, des murs barbouillés d’amères couleurs dégeulbitantes, des arbres dressés entre, dans un verre luisant d’après l’orage -, des nuées d’oiseaux ricochent sans bruit dans le ciel.
Ce roman du bruit, de l'assourdissement continu montre bien combien l'Homme est petit. Mais ne pas aller plus loin que ce simple constat serait, à mon avis, passer à côté de ce livre. Le roman peut être aussi compris comme un signal d'alarme. Il prévient que nous allons être dévorés tout cru par ce rouleau compresseur qu'est le turbo-capitalisme. Reinhard Jirgl apparaît alors comme un digne descendant d'Emile Zola et de certains futuristes, du moins ceux qui n'ont pas cédé aux sirènes de l'ordre noir.
Et la renaissance des temps bruyants d’autres moteurs ) scies à chaîne se risquant au début-de-coupe dans le bloc urbain, un crissement qui laisserait croire qu’elles viennent de déraper sur un clou, ces brèves amorces sans cesse répétées, & les suivantes sans plus attendre ; éclats de bruits piaillements d’enfants ferraillant le long des rues, et puis taris comme si la voie d’asfalte avait basculé & laissé d’insondables fosses à ordures engloutir tous ces cris comme autant de morceaux de verre éparpillés.
Ici, les mots claquent, ils restituent la pulsation d'un monde.
?Est-ce que ton cœur fait boum boum-boum pour ?moi
Dans cet univers de bruit et de fureur, les moments d'intimité sont rares, voire impossibles. C'est peut-être pour cette raison que la lecture de ce livre est si intense. L'intimité est dangereuse puisque, aux yeux de ceux qui nous gouvernent, il faut rentabiliser le temps qui est forcément de l'argent, symbole de puissance.
Ces business-créatures, tough guys, qui forts de leur pouvoir=autocratique à donner des ordres au travail et via les sports démocratisés de l’extrême font éclater leur homoérotisme basal refoulé en du mâle-dominant, en des sado/masochismes d’un mode-d’existence où ils ne ménagent rien ni personne.
Cette société révèle une absence de sentiments, mais pas de sexe. Le sexe lié à la violence sinon dans les gestes, du moins dans les mots. C'est flagrant quand l'un des protagonistes discute avec la mère de Sophia, la femme qu'il poursuit. Elle lui dit que sa fille est nymphomane que, chez elle, « ça hurle entre ses cuisses ».
Ça hurle entre ses cuisses mais ça hurle aussi tout autour de soi. Le point d'orgue de ce cri continu est le 11 septembre 2001, événement auquel l'auteur fait référence comme pour faire écho à ce Berlin de bruit et de fureur.
11 septembre 2001 : le CHOC après la castration symbolique de la puissance=financière impérialiste, - puis la restauration du premier & dernier Pouvoir=Médias : au point zéro de l’information, la catharsis par épuisement.
Et dans cet univers urbain, les media sont parfois dénoncés comme les complices de l’ordre économique établi – bravo -. Ils suscitent l’attention par le choc permanent signifie Reinhard Jirgl qu’on ne peut pas pour autant ranger, à mon sens, dans la catégorie des nostalgiques de l’Allemagne communiste. Il suffit pour s’en convaincre de lire le rapprochement suivant sous sa plume :
Noblerouges : la ErDéA
« Renégat, roman du temps nerveux » est un long questionnement sur le devenir de l’Homme. Mais, au lieu d’utiliser le ressort de la science-fiction qui envisage souvent les scénarios extrêmes, Reinhard Jirgl cible les vingt dernières années, période, à mon sens, d’importantes transformations sociales, économiques, financières, technologiques. Quand le roman prend ainsi la dimension d’un essai sans jamais renier la notion de fiction, cela frise le chef d’œuvre.
Et même si le temps renvoie l’image de notre intimité solide comme un roc, une confiance comme taillée dans la pierre - : 1 geste 1 mot à contretemps ; 1 grain-de-poussière=pour-enrayer – et ce roc qu’on croyait solide s’effondrera comme un morceau de papier. Combien d’adieux éclatent sur nos têtes comme autant de nuages d’intempéries tandis que nous dormons… ?Où est ?Maplace dans l’existence de Cètefemme. Moi, minuscule fibre arrachée à l’étoffe humaine, n’appartenant ni à elle ni à moi-même dans ce no man’s land d’1 appartement=communo-taire. Ce qui me reste : le tourment du vide é : de n’être rien.
J’ai parfois eu l’impression, en lisant ce roman ayant Berlin comme toile de fond de vivre dans un lieu en friche. Vous remarquerez d’ailleurs que cette expression est le titre du premier chapitre.
Tout le monde ignore quel type-d’homme naîtra des cendres.
Un lieu qui peut donc produire une société nouvelle – j’en doute – ou préparer le terrain à d’autres folies, comme celles qu’a connu le vingtième siècle mais sous d’autres formes. Je pense que l’auteur est un pessimiste raisonné et qu’il ne s’attend pas à une quelconque amélioration lui non plus. En voici un exemple :
Les tautologies sont néanmoins les signes caractéristiques permanents des régimes totalitaires.
Dans les régimes totalitaires, si l’on se souvient bien de George Orwell, même les mots sont vidés de leur substance. Rappelez-vous du novlangue et de ses slogans « La guerre, c’est la paix », « La liberté, c’est l’esclavage », « L’ignorance, c’est la force ». Ne peut-on voir cela dans la langue de Reinhard Jirgl ?
En conséquence de quoi il n’y a plus lieu d’établir de différence de sens entre les antonymes suivants car la séléctivité a disparu : « martial » et « civil » ; « privé » et « collectif » ; « moi » et « nous » : « individu » et « masse » ; « ennemi » et « ami » ; « travail » et « loisirs » ; et pour finir « sujet » et « objet » - car comment l’intelligence artificielle serait-elle à même de saisir raisonnablement la division entre « sujet » et « objet ».
Livre aux multiples entrées, « Renégat, roman du temps nerveux » est à conseiller à tout le monde. Surtout ceux qui croient dans la main invisible, force régulatrice, soi-disant, du libéralisme. Il est à conseiller à tous ceux qui s’émerveillent de l’hyper-technicité, de la disparition de l’homme au profit des robots. Il est à prescrire à la majorité silencieuse qui juge inutile de dire non. Un renégat est un homme qui dit non. Et l’on sait depuis Camus ce que cela signifie.
Amis lecteurs, si vous cherchez de quoi vous redonner le goût du combat, lisez ce roman d’utilité publique.
Belle et heureuse année.

