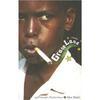« J’ai l’impression d’être à deux pas de toi, et pourtant un gouffre nous sépare », p. 11.
« J’ai l’impression d’être à deux pas de toi, et pourtant un gouffre nous sépare », p. 11.
Son père est mort. Nina qui avait déjà perdu sa mère, une française venue s’installer à Abidjan pour le bien de la carrière de son époux rencontré lors des études à Paris, doit se rendre dans une Côte d’Ivoire qui lui est depuis longtemps étrangère pour assister aux obsèques. Impossible de déroger à l’obligation, son absence serait une offense faite à cette famille ivoirienne qu’elle connaît si peu. D’ailleurs ce père aimant et juste, un des premiers médecins ivoiriens et haut fonctionnaire de la République, ne les a-t-il pas, elle et sa sœur Gabrielle, menées sur le bon chemin de la raison à la lumière d’une éducation occidentale. Non que les traditions africaines fussent moquées, mais pour un intellectuel, il était préférable de voir ses enfants évoluer dans un univers moderne, celui des temps présents et à venir. Du moins le pense-t-elle. Arrivée sur sa terre native, elle prend la mesure de l’écart qui la sépare de ses personnes qui l’accueillent et se disent ses parents : des tantes aux souvenirs plus ou moins précis, des cousins pour la plupart bien trop lointains et d’autres qui n’ont d’affiliation que le village et la tradition : « Elle avait atterri sur une scène de théâtre où les acteurs principaux manquaient et où le décor ne correspondait plus à rien », p. 19. Justement pour décor, l’Abidjan qui s’offre à elle est si différente de celle de ses souvenirs : une ville chaleureuse, gaie où il faisait si bon vivre. La guerre civile est passée par là : au-delà d’un quotidien faussement ordinaire, les réfugiés se massent dans des baraquements de guingois, fourmilière du chômage, des tensions et des rumeurs. Aucun réconfort ni repos à attendre non plus dans la concession qui est investie par une foule rassemblée pour l’organisation des obsèques qui ne laisse nulle place à l’improvisation et au court terme : les funérailles exigent des jours de préparations et parfois même des semaines ainsi qu’un ordonnancement quasi militaire :
« Au cours de la réunion, les moindres détails des cérémonies à venir furent passés en revue. Plusieurs groupes se formèrent spontanément : comité accueil, comité transport, comité restauration et vaisselle, comité location des chaises et des marquises, comité sécurité et autres. Des volontaires proposèrent de s’occuper des arrangements floraux et de la décoration. Chacun avait une tâche spécifique. Un trésorier fut désigné. Son rôle était d’encaisser les dons en espèces qu’il devait soigneusement répertorier dans un grand cahier en précisant bien les montants, les noms, les dates, etc. Même chose pour les dons en nature qui, depuis l’annonce du décès, avaient déjà commencé à arriver. Une équipe fut chargée de les réceptionner et de les répartir selon les besoins journaliers. Il fallait en effet nourrir les nombreuses personnes qui logeaient dans la maison… », pp. 25 et 26.
Touchée par cette solidarité africaine mais aussi débordée, Nina s’isole dans la chambre du défunt afin de se retrouver mais aussi pour communier avec le disparu ; une pièce qui va se révéler coffre-fort à secrets d’une vie d’un père qui se montre toute autre de celle dont elle croyait connaître. Rationnel qu’il était dans les apparences, un manuel de sorcellerie montre sa grande superstition. Des factures et des lettres attestent d’un grand endettement provenant de la rémunération d’un marabout qui contre magie sonnante lui promettait de retrouver un poste de haut fonctionnaire après son bannissement.
« Nina referma le livre (traité de sorcellerie). C’était sinistre. Elle aurait voulu croire que cet ouvrage se trouvait dans le tiroir par hasard. Mais les pages écornées révélaient qu’il avait été consulté maintes fois. Des larmes lui montèrent aux yeux. Dans quel monde son père a-t-il vécu ? Elle compris qu’ils avaient été séparés l’un de l’autre par une distance bien plus grande que des milliers de kilomètres entre eux », p. 69.
Et que dire des enfants inconnus d’elle d’un père qui a entretenu plusieurs maîtresses ? A l’instar de cette élite qui a fait les indépendances, bien que pétri de culture occidentale il n’a pas pu échapper aux traditions de sa terre africaine, ici la polygamie et les croyances locales. Peut-être cela explique-t-il les longues journées de sa mère enfermée dans une chambre faite studio de musique pour l’occasion où elle travaillait son piano. Peut-être que ceci est aussi à l’origine de la fugue définitive de Gabrielle alors adolescente et qui a fait de Nina une enfant unique. D’ailleurs sa sœur rebelle acceptera-t-elle de venir pour une dernière fois saluer le défunt ? En face d’une réalité que Nina ignorait et qui fait de son père un homme bien différent de celui de son quotidien, de ses souvenirs et de son imaginaire, elle ne juge pas bien qu’étant bien sûr troublée. Aucune leçon de morale en l’occurrence. D’ailleurs le faire serait condamner des frères et des sœurs aucunement responsables. Ne ressort-il pas qui plus est de ce passé caché une satisfaction, celle que de la mort naît la vie, une nouvelle famille en l’occurrence ?
Dans un style simple et limpide faisant la part belle aux phrases courtes, l’immersion du lecteur dans le monde feutré de Nina – autobiographie ? – fait de celui-ci le voyeur complice et confident ; complicité avec un écrivain qui partage un univers introspectif avec pudeur où la tradition, les origines, le métissage, la place de la femme, sont évoqués non sans gravité mais toujours soucieux du refus de toute dramatique. Loin de mon père est un roman magnifique d’une grande sensibilité dans lequel il est si bon de s’abandonner et de partager cette preuve d’humanité.
 Tadjo Véronique, Loin de mon père, Actes Sud, 2010, 189 p.
Tadjo Véronique, Loin de mon père, Actes Sud, 2010, 189 p.