Le néant à pas de velours
Le triomphe de l’intimisme dans la littérature contemporaine n’est plus à prouver. Même le Québec, longtemps marqué par un lien étroit entre écriture et politique, voit se multiplier les productions à base d’intrigues conjugales et de vastes réflexions sur le sens de la vie. Espèces, le dernier roman de la sino-québécoise Ying Chen, s’apparente à cette catégorie. On y constate que le travail de mémoire présent dans les premières fictions de l’auteure est bel et bien achevé : cette onzième pièce d’une œuvre désormais reconnue comme majeure semble s’inscrire dans la tendance générale de la littérature québécoise. Mais une inquiétante étrangeté sème le doute, et jette sur l’intime un regard neuf, perturbant.
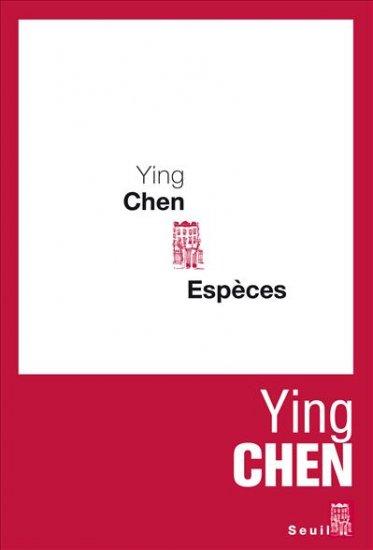
A prime abord, nous croyons avoir à faire une simple histoire de rupture, au tournant banal d’une vie de femme. A travers un récit à la première personne, une existence apathique passée entre une cuisine et un fauteuil est dépeinte. Rien de bien exaltant, à priori. Mais cet horizon bouché appartient à une période révolue. Soudain coupée de sa vie terne, narratrice entame quelque chose de radicalement différent. C’est là que les choses deviennent intéressantes : on apprend très vite que la paisible ménagère s’est transformée en un animal en passe d’imposer à l’homme sa supériorité. Plus précisément, la voilà devenue chatte, et c’est avec un regard d’une acuité nouvelle qu’elle se lance dans des réflexions originales sur la décadence du genre humain.
Bien différente de la métamorphose kafkaïenne, celle qui a lieu ici ne provoque ni terreur ni étonnement. Naturel aux yeux de la protagoniste, ce curieux phénomène est présenté comme une évolution inéluctable. Sans fioritures, dans un style simple, presque plat, la victoire du chat sur l’homme est présentée comme un fait avéré. Aussi nous ne nous étonnons guère en lisant des affirmations catégoriques telles que « Nous sommes presque des enfants d’humains, notre nombre égalera celui des enfants et le dépassera même. ». Cela semble même tellement évident qu’on en oublie tout à fait le caractère fantastique, impossible, d’une narration menée par un animal de compagnie.
Le quotidien de la créature est très minutieusement décrit, avec une lenteur parfois proche de celle du Nouveau roman. Mais ce regard a une direction : par bribes, de façon erratique, il fait ressurgir le passé. La personnalité de A., le mari de la métamorphosée, nous est alors révélée, à demi mots, au fur et à mesure que la chatte découvre les bonheurs de la soumission absolue à un maître. Avec une ironie certaine, l’auteure dresse un parallèle entre cette relation fondée sur l’inégalité et les rapports qui, autrefois, unissaient l’homme et la femme. Car cet étrange récit, sans linéarité ni véritable intrigue, tend à initier une réflexion sur l’avenir des rapports humains.
Menacés par un individualisme croissant et par le processus vers le néant qui selon Ying Chen concerne toute civilisation, les hommes n’ont plus qu’à réinventer une autre façon de vivre ensemble. Si le roman semble suggérer à chacun de chercher son propre maître et d’accepter la faiblesse qui « est une originalité dans un monde où règne la loi du plus fort », toutes les voies de l’évolution sont ouvertes. Il ne tient donc qu’à nous de les emprunter…
Espèces, Ying Chen, Seuil, 213 p., 17 €
Article paru dans Témoignage chrétien le 16/12/10
