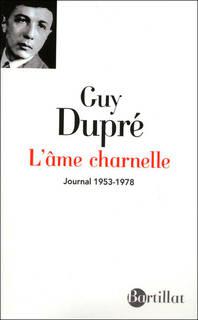 Devant le journal d’un écrivain, genre littéraire à part entière, le lecteur s’interroge : quelle est, dans le texte qui lui est soumis, la part de sincérité et celle de l’autocensure, voire de l’autosatisfaction ? Le journal éclaire-t-il l’œuvre ? L’auteur cherche-t-il à témoigner de son époque, à arrêter le temps, à régler des comptes ? L’exercice relève-t-il de l’exhibitionnisme pur ? La dimension littéraire travestit-elle ou, au contraire, sert-elle le registre de l’intime ?
Devant le journal d’un écrivain, genre littéraire à part entière, le lecteur s’interroge : quelle est, dans le texte qui lui est soumis, la part de sincérité et celle de l’autocensure, voire de l’autosatisfaction ? Le journal éclaire-t-il l’œuvre ? L’auteur cherche-t-il à témoigner de son époque, à arrêter le temps, à régler des comptes ? L’exercice relève-t-il de l’exhibitionnisme pur ? La dimension littéraire travestit-elle ou, au contraire, sert-elle le registre de l’intime ?
On sait que Paul Léautaud revendiquait la sincérité, alors qu’une étude génétique de son Journal littéraire montre combien il fut retravaillé (l’un n’excluant toutefois pas l’autre). Dans un souci de vérité Julien Green rétablit pour les rééditions de son Journal des passages qu’il avait supprimés lors de sa première publication, tandis qu’à l’opposé, Montherlant avoua avoir éliminé des notes de ses Carnets des années 1942 et 1943 dans lesquelles il donnait son sentiment sur l’attitude des Allemands pendant l’Occupation.
On pense aussi au Journal des Goncourt qui offre un précieux témoignage sur les mœurs artistiques du XIXe siècle et recèle d’innombrables « vacheries » dont les amis des deux frères furent les cibles privilégiées. On pense enfin aux extraordinaires Journaliers de Marcel Jouhandeau (28 volumes, publiés entre 1961 et 1982). Un jour que je les évoquais avec Roger Peyrefitte, celui-ci eut un commentaire cruel – il en avait l’habitude – : « Jouhandeau, c’est l’harmonium et le tube de vaseline ! » C’était résumer en peu de mots un texte où voisinent les réflexions sur la littérature, les interrogations religieuses, les scènes de la vie quotidienne, les querelles de ménage et les aventures homosexuelles de l’écrivain, incluant ses visites au bordel que « Madame Madeleine » tenait à Pigalle, un lieu que l’on disait, sans doute à juste titre, sordide, mais qu’il tentait toujours de sublimer. C’était surtout balayer d’un revers de main la véritable dimension littéraire des Journaliers, qui reléguait au second plan la part d’exhibition de Jouhandeau, laquelle s’apparentait finalement à une confession.
C’est cette réelle dimension littéraire que l’on trouve encore dans le journal de Guy Dupré, L’Ame charnelle (Bartillat, 286 pages, 20 €). Peu connu du grand public, Guy Dupré est l’auteur de trois romans, dont le premier, Les Fiancées sont froides, souleva l’enthousiasme d’André Breton et de Julien Gracq. Homme de l’ombre volontaire de la littérature (un quart de siècle s’écoulera entre son premier et son second roman), il n’en est pas moins l’un des plus singuliers représentants, l’un des rares vrais stylistes de son époque.

Des esquisses de portraits apparaissent, où l’on retrouve, pêle-mêle François Mauriac, Julien Green, l’énigmatique Raymond Abellio, Julien Gracq, Cocteau, Jean Cassou, Nathalie Barney, Malraux, Lise Deharme ou encore la belle Sunsiaré de Larcône (Suzy Durupt), qui mourut accidentellement dans l’Aston-Martin de Roger Nimier – autant de personnages qui, en définitive, suggèrent la fin d’une époque. Comme le suggère, discrètement, l’allusion au merveilleux restaurant Chez Georges, qui servait, rue Mazarine, l’une des meilleures cuisines russes de Paris et ne survécut pas à son propriétaire sympathique et haut en couleurs, Georges, dont la vodka au piment, préparée par ses soins, relevait de l’œuvre d’art.
Sans fard, sans aucun souci de se ménager un rôle gratifiant, Guy Dupré parle également de lui, de ses lectures, de sa place au sein du petit monde des lettres et de l’édition parisienne. Dans la première partie du livre, le lecteur suit au quotidien les aventures de ce nomade sexuel, décrites sans réel cynisme, mais avec une crudité chirurgicale dont il n’hésite pas à faire les frais, comme lorsqu’il rend compte de l’érosion de son propre désir. Aime-t-il simplement les femmes ou un sentiment plus obscur le pousse-t-il à les choisir mariées, comme s’il voulait se venger des hommes – d’un homme en particulier ? On pense au père, bien sûr, père inconnu qui, comme le soldat inconnu, avait acquis à ses yeux vocation d’universalité.

Trois femmes dominent toutefois le livre. Pauline, avec laquelle l’auteur entretient une amitié amoureuse, c’est-à-dire Pauline Benda, Madame Simone au théâtre, qui fut la maîtresse d’Alain-Fournier et, moins glorieuse alliance, la femme de François Porché. Un demi-siècle les sépare, qui justifie probablement l’inassouvissement des sens. Puis Marthe, sa mère, omniprésente, dont il peint avec émotion, dans la seconde moitié de l’ouvrage, le naufrage jusqu’à la mort. Le contraste entre les deux parties du journal est alors flagrant : l’âme, son éducation sentimentale achevée, se fait moins charnelle, elle gagne en dimension tout en s’abîmant dans d’éternelles inquiétudes. Enfin, l’écrivain évoque Thérèse, qu’il épousera, la seule femme, peut-être, qui aura su exorciser ses démons.
Un journal comme une psychanalyse, tel pourrait être le sous-titre des Ames charnelles de Guy Dupré, qui écrit, médecin légiste de lui-même (p. 118) : « Seule la réappropriation des mots peut me donner la sensation de reboutonner ma tunique de chair. Chaque page est comme un secret à révéler et à réensevelir. »
Illustrations : Guy Dupré, photographie - Robert Doisneau, Le Café de Flore.

