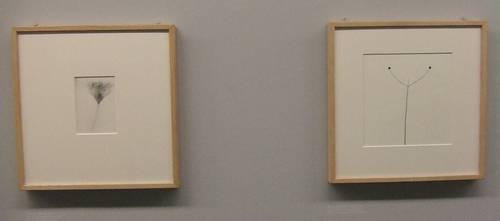L’exposition des photographies d’Harry Callahan (pas lui) à la Fondation Cartier-Bresson (jusqu’au 19 décembre), consacrée exclusivement à son travail en noir et blanc (donc avant 1977) permet de découvrir un photographe américain méconnu en France. Se disant opposé à la photographie narrative, il est connu d’abord par ses photographies de la ville (même si ses photographies de passantes prises à la volée ne sont pas aussi fortes, aussi engagées que celles d’autres ’street photographers’); bon nombre de ses scènes urbaines sont comme des plateaux éclairés au milieu des ténèbres environnantes, avec des personnages-acteurs jaillissant de l’ombre ou y retournant (France, 1956/58).
Il est aussi connu pour l’adoration qu’il avait pour sa femme Eleonora, ni très belle, ni très sexy, mais au corps de laquelle il bâtit un mausolée photographique : en voici un exemple, pendant son séjour en
France (1956/58), où ce corps nu, de dos, encadré par les portes et les murs du couloir devient irréel, symbolique, abstrait. Dans une autre, d’un noir profond (quasiment impossible à reproduire) une minuscule forme blanche se détache sur le fond noir, une virgule de lumière, son corps nu, encore de dos, avec la rondeur des hanches, et une seule jambe, l’autre ayant disparu dans l’ombre (Port Huron, 1954) : une simple forme, sans anecdote, presque sans référent.
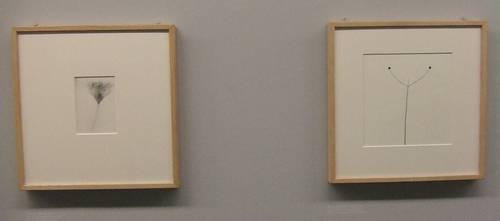
Et à mes yeux l’aspect le plus intéressant de son travail est bien cette capacité à frôler l’abstraction, à faire des photographies très formelles, épurées, d’une simplicité extrême. L’accrochage fait ironiquement voisiner une image surexposée des cuisses et du pubis de sa femme (Eleonora, Chicago, 1948) avec une brindille, autre trait noir sur fond blanc (Weed against Sky, Detroit, 1948) : au-delà de la drôlerie de la juxtaposition, ce qui compte ici, me semble-t-il, est sa capacité à faire jaillir des formes essentielles, sans la moindre fioriture.
Plusieurs de ses compositions quasi abstraites sont présentées ici, collages, surface d’un mur, rayons de soleil dans l’eau, jeux de neige, de sable ou d’herbe; bien qu’il n’ait pas photographié de nuages, il y a une similitude avec les
Equivalents de Stieglitz, photos sans cadre, sans découpe, sans champ ni hors-champ (lire
Rosalind Krauss et
Philippe Dubois sur ce sujet). Une des plus belles compositions est cet assemblage sous verre de petits bouts de lierre (
Ivy Tentacles on Glass, Chicago, 1952) dont on ne sait dire à première vue si ce sont des spermatozoïdes au microscope, le mouvement brownien d’une foule ou un dessin d’Henri Michaux. Allant au-delà de la représentation, Callahan (qui fut recruté par Moholy-Nagy comme enseignant à l’Institute of Design de Chicago) invente ici un nouveau vocabulaire photographique, qui fait date.
Un bon nombre de ses photographies urbaines ont aussi cette touche, qu’il s’attache aux signes au sol, ligne blanche sur le bitume au milieu de la chaussée ou éclat de lumière entre les masses noires des immeubles (là encore, Bob Fine, 1952, est quasiment impossible à reproduire, d’un noir trop intense fendu par un trait lumineux); il y a enfin ici deux
planches contacts de photographies d’immeubles doubles, inversés, se découpant sur des ciels blancs surexposés : Callahan faisait une première prise, puis tournait son appareil de 180° et refaisait la même prise en double exposition, créant ainsi ’de nouveaux hiéroglyphes de formes architecturales’(Peter MacGill*). C’est ce type de recherche, de dépouillement, de simplicité qui fait tout l’attrait de son travail, à mes yeux.
* Je remercie Agnès Sire et Peter MacGill pour ces explications.
Toutes photos © The Estate of Harry Callahan. Courtesy Pace/MacGill Gallery, NYC. Conformément à la demande de la Fondation, une seule photo restera en ligne après la fin de l’exposition (vous pouvez voter pour votre préférée…)