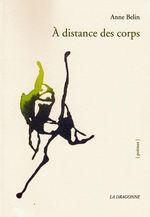 Ce livre montre qu’une poésie du quotidien n’est pas
nécessairement superficielle ou futile. L’écriture d’Anne Belin est simple mais
aucunement plate : elle utilise un vers libre assez heurté par les coupes,
parfois à l’intérieur d’un mot, qui créent des rebonds, des ruptures
inattendues. Chaque page forme un ensemble lié mais parcouru de tensions, de
décalages qui animent l’écriture. Il en va ainsi dans quatre des cinq séquences
qui composent le livre. Dans la quatrième, plus courte que les autres (trois
pages), on retrouve le vers libre habituel, presque sage, mesuré, sans doute
parce que l’objet du poème est précisément la difficulté à dire :
« on ne pourrait pas dire », « on ne peut parler de ça »,
« on ne peut en parler »… Ce qui est en jeu semble une expérience
(presque d’ordre mystique ?) du hors-champ langagier, comme en témoigne la
résonnance pascalienne de la chute : « cette joie ces flaques de
joie ».
Ce livre montre qu’une poésie du quotidien n’est pas
nécessairement superficielle ou futile. L’écriture d’Anne Belin est simple mais
aucunement plate : elle utilise un vers libre assez heurté par les coupes,
parfois à l’intérieur d’un mot, qui créent des rebonds, des ruptures
inattendues. Chaque page forme un ensemble lié mais parcouru de tensions, de
décalages qui animent l’écriture. Il en va ainsi dans quatre des cinq séquences
qui composent le livre. Dans la quatrième, plus courte que les autres (trois
pages), on retrouve le vers libre habituel, presque sage, mesuré, sans doute
parce que l’objet du poème est précisément la difficulté à dire :
« on ne pourrait pas dire », « on ne peut parler de ça »,
« on ne peut en parler »… Ce qui est en jeu semble une expérience
(presque d’ordre mystique ?) du hors-champ langagier, comme en témoigne la
résonnance pascalienne de la chute : « cette joie ces flaques de
joie ».
Pour la plupart cependant, les poèmes visent « le commun trouble profond
des communes perceptions quotidiennes ». On notera l’insistance sur le
commun, le banal, mais on n’oubliera pas le « trouble ». Ainsi,
lorsque Térésa brique sa cuisine, elle est bien consciente que ses gestes
simples ne sont pas innocents. « je brique alors je m’occupe à briquer
des tôles dit Teresa/les carreaux du sol les faïences des murs les vitres /
contre / la poussière de la rue je pense à mon pays où rien ne marche plus / je
m’occupe c’est fuir je m’occupe les
mains je fuis je me mets / des défis comment tenir propres les
grilles du / four je me mets / des petites protections tout autour pour tenir / debout car sinon » (p.29).
De même l’ordonnance impeccable de son potager est rempart contre son propre
désordre intérieur. L’auteur n’a pas besoin de développer, de raconter
l’histoire de Teresa ; le lecteur en devine assez à travers les bribes
saisies au passage. Le regard qu’Anne Belin porte sur les autres n’est jamais
méprisant ou agressif, mais il n’est pas non plus compassionnel ou larmoyant.
Elle note simplement la dignité humaine de chaque être : ainsi pour la
mendiante macédonienne rencontrée Cours Gambetta, à genoux devant son gobelet
en plastique. Lorsqu’elle lève la tête, « ses traits sont / nobles ».
La dernière séquence du livre naît d’une conversation entre la poète et sa
fille de neuf ans. « - comment me
dit-elle on se sent parfois // (elle
neuf ans c’est mai / des carrières s’ouvrent au galop )// on se sent dit-elle en dehors
/ à côté de la vie (neuf
ans de vie)//tu sais une distance /
comment on sent ça est-ce que toi aussi » (p.73) Et tout le poème va
travailler cette interrogation, cette peur au fond de toute vie jusqu’à la
dépasser par l’évidence première d’être là : « le bon dos des choses
qui nourrissent qui / maintiennent la vie-là / tiens mange ça tiens ça va passer avale finis par / avaler là tu es /
en vie tu vois je le disais bien tu vis tu sens ce qui se passe / qui bouge et
n’en finit pas d’être au monde nous y sommes » (p. 83)
On aura compris que dans cette poésie la simplicité n’exclut pas la profondeur.
par Antoine Emaz
Anne Belin
A distance des corps
Ed. La Dragonne - 90 pages – 15
euros

