Oublions les lions et ce triste sire de Pertuiset – voir fin de chronique précédente -.

Le titre de ce roman fait référence à un propos tenu par Mao : « L’impérialisme américain est un tigre de papier ». Mao, oui, le Grand Timonier, dont se réclama pendant un temps une partie de la gauche ultra-radicale de l'après-mai 68. C'est là-dessus que revient Olivier Rolin en mettant en scène Martin, le narrateur, et la fille de Treize, un de ses anciens camarades.
Nous avons ici la confrontation de deux générations. Elle va se faire le temps d'un trajet en voiture sur le boulevard périphérique. Encore cette figure du cercle qui a tant d'importance pour l'auteur comme le prouvent les mots qui suivent :
On va faire tourner cette histoire comme une balle de plomb au bout d'une fronde, qu'elle vole loin.
Balade nocturne, lorsque la parole est plus libre, voyage dans le noir, celui du passé dont Olivier Rolin, qui a pourtant cheminé avec la Gauche Prolétarienne, dit aujourd'hui ne pas conserver grand chose – voir interview plus bas -.
Tu aimes le nom de la nuit, aussi, navire night, noche triste, notta continua. En allemand, on ne dira pas.
Vous aurez sans doute remarqué la faute délibérée de l'auteur lorsqu'il a recours à l'italien. Il s'en explique aussi dans l'entretien.
C'est un livre qui m'émeut beaucoup à chaque fois que je le lis. Pas parce que, politiquement, je souscris aux idées de l'ancien numéro un chinois. J'en suis très éloigné. Non. Ce roman me touche par sa volonté de mettre à nu les raisons les plus profondes d'un engagement. Raisons multiples qui conduisent le narrateur à évoquer le souvenir d'un père mort en Indochine, victime d'une balle explosive – ça m'a rappelé Pertuiset – ou à expliquer le basculement dans l'idée révolutionnaire par la haine du mensonge.
Il nous semblait que les pauvres étaient moins faux.
Dans ce livre, on voit bien que ce que dit le cœur est ensuite récupéré par d'autres pour être bêtement théorisé. La « noblesse » des sentiments est bien peu de chose quand elle se laisse ensuite embarquer dans une autre aventure. Je trouve que l'auteur montre ici un grand courage. Il prend en effet le risque que son propos soit compris comme une condamnation du seul communisme. Or, et c'est là que l'on comprend mieux le passage du politique au littéraire, il s'agit d'une réflexion plus globale sur la notion d'idéologie. L'idéologie n'étant pas la forme ultime de l'idée. Au contraire.
L'idéologie, c'est la passion du faux témoignage.
Il est déroutant de livre ce livre dans un contexte de dépolitisation généralisée. Pour moi, le phénomène ne fait que s'accentuer. Au moins, peut-on se dire, il y avait à la base de l'entrée du narrateur en « résistance » une autre volonté. Celle d'être...
à la marge de tout
Faut-il rappeler les mots d'un autre ancien (?) maoïste, Jean-Luc Godard : « La marge, dans un livre, c'est ce qui fait tenir les pages ».
Pour moi, il ne s'agit pas d'une autocritique. Car cela signifierait que l'auteur n'a pas tourné la page avec les méthodes passées. Je pense qu'il s'agit davantage d'un travail d'inventaire personnel nécessaire pour celui qui se trouve ici une hypothétique ressemblance avec Daladier.
Il émane de ce roman une franchise inouïe dans le propos. Mais aussi et surtout une beauté des mots qui montre aussi l'évidente dimension romanesque de l'engagement révolutionnaire.
Il y a des gens qu'on aime pour une phrase, une pensée, un sourire.
Oui, il faut du cran pour accepter ce retour en arrière avec les risques que comporte cette démarche. Mais c'est grâce à elle que nous pouvons mesurer, nous lecteurs, le fossé qui existe désormais entre les deux Olivier Rolin, celui d'aujourd'hui, à la parole envoûtante et celui d'hier, à l'aveuglement saisissant :
La beauté de l'art, nous la détestions sans la connaître.
Je trouve qu'on peut donc lire aussi Tigre en papier comme une des plus belles déclarations d'amour à la littérature qui, finalement, nous empêche d'être...
en guerre contre le plus intime de soi.
Peut-être parce que la littérature est sans limite :
La littérature, est-ce que ce n'était pas en fin de compte un tas de variations plus ou moins profondes, plus ou moins véridiques, autour du thème de la dernière phrase, une façon de tourner autour du pot, du point où les mots s'arrêtent ?
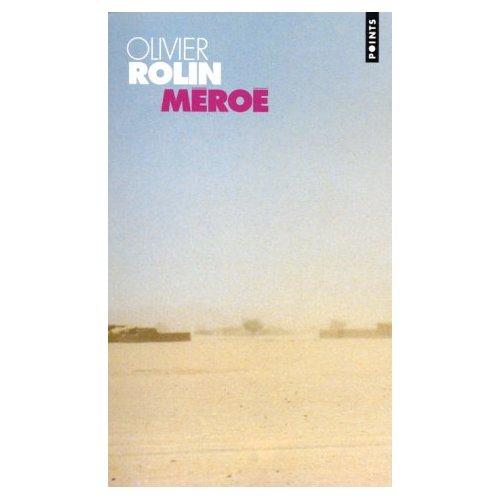
C'est le livre par lequel je suis entré dans l'œuvre d'Olivier Rolin. Comme je l'ai dit à l'auteur, je ne suis pas quelqu'un peut s'enorgueillir d'avoir un livre de chevet.
Dire qu'on a aimé un livre plus que les autres, c'est de la foutaise.
Mais s'il m'était permis d'en choisir plusieurs, Méroé en ferait certainement partie. Sans doute parce qu'il poursuit cette exploration de l'origine. Le narrateur est un Français qui a trouvé refuge dans une chambre de l'hôtel des Solitaires à Khartoum. C'est peut-être – on n'est jamais sûr de rien avec Olivier Rolin – une liaison ratée avec une femme qui explique cette quête d'ailleurs.
Deux autres étrangers gravitent dans cette capitale soudanaise : Harald Winterfield, que le narrateur confond parfois avec un oiseau et le Dr Vollender, citoyen d'un pays perdu, dont on ne pourra bientôt plus trouver l'origine : la RDA. Si ces hommes échoués là entretiennent peu de contacts ensemble c'est parce que chacun semble en questionnement par rapport à sa propre histoire, à l'image du narrateur :
Je n'étais qu'un tocard qui se prenait pour un artiste, un canasson mégalomane.
Et cette réflexion conduit à des prises de conscience très émouvantes :
Il arrive que la lucidité retrouvée regrette ces moments d'hébétude qui sont le bonheur des fatigués.
Vollender est archéologue. Précision importante : Méroé est le site le plus fameux du Soudan. Un lieu où se concentre donc la mémoire d'une civilisation. Mémoire dont chacun des personnages a du mal à empêcher le libre-cours, y compris quand les souvenirs sont douloureux.
Pour le narrateur, la douleur porte un nom : Alfa. La jolie jeune femme partie, comment la faire renaître ? Celui qui, on l'apprend plus tard, est venu à Khartoum pour y enseigner le français – activité totalement fictive – engage alors un mannequin pour tenter de redonner vie à son amour perdu.
Il me semble que le personnage d'Alfa peut-être compris aussi – par homophonie – comme l'origine de l'écrit – Alpha, première lettre de l'alphabet grec –, de la littérature. Il n'est donc pas surprenant, je crois, de lire ici et là quelques déclarations d'amour à la chose écrite, quelle que soit sa forme...
je ne croyais plus que la poésie fût affaire de subtilité, mais plutôt d'énergie, de vitesse, de beauté triviale, grandes carlingues trempées de nuages, feux animés d'un express dans la nuit, déclics de métal bleu d'une arme, seins, jambes en sueur sous l'étoffe froissée, des roueries matérielles.
... du moment qu'elle est envisagée de façon artisanale...
Le jour où écrire sera un métier, la littérature sera une Église.
... et qu'elle entre en résonance avec son « moi » profond...
Cela encore, Brecht, Kurt Weill – et la soûlographie nocturne... - faisait partie d'une culture, d'un temps qui étaient les miens
Roman sur l'origine, Méroé s'achève par une disparition. Celle d'une autre jeune femme, Else, théoriquement venue prêter main forte à l'étrange Vollender. Mais ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus. Et d'ailleurs, j'arrête là mes tentatives d'explication faisant mien le propos du narrateur :
Chaque livre possède un message crypté
Non sans m'être toutefois fait l'écho de ces deux splendides phrases :
L'écriture est la forteresse de l'incertain.
Plus loin :
les livres pour enfermer le monstre de l'angoisse.

Une fois n'est pas coutume, Olivier Rolin fait paraître ce livre aux éditions Verdier.
Il s'agit d'une commande de France Culture pour une création théâtrale originale à Avignon en 2000. La pièce met en scène deux acteurs : Anouk Grinberg et Didier Bezace.
L'histoire est impossible à résumer. Disons simplement que, sur scène, deux personnages, un homme et une femme, conversent. Où plutôt, tentent de converser. Car leurs propos semblent être parfois avalés par une télévision qui semble brailler en permanence.
les nouveaux maîtres avec leurs borborygmes
L'homme utilise une langue qui semble prendre davantage racine dans l'imaginaire - Les histoires viennent de nulle part - . La femme paraît plus terre à terre à défaut d'être « réaliste ». Le dialogue semble d'abord impossible. Est-ce parce que le premier sort de la maison des fous ? Mais où est donc la folie quand la parole est étranglée par la petite lucarne ?
Dans une postface intitulée Mal placé, déplacé, Olivier Rolin dit que « comme dans dans une ville il faut vagabonder dans une langue ». D'où l'importance d'aller se nourrir ailleurs car les idiomes sont « une assignation à résidence ». « Nulle part un écrivain ne trouve sa place », ajoute-t-il. L'auteur souligne une nouvelle fois l'importance d'élargir son horizon, pour, joli jeu avec la langue précisément, « échapper au lieu commun ». Ce n'est qu'à ce prix, comme le dit l'Homme dans Le langage qu'avec les mots on peut « agripper les choses ».
La littérature comme « anticorps au fléau de l'appauvrissement, du stéréotype » : on ne peut que souscrire.
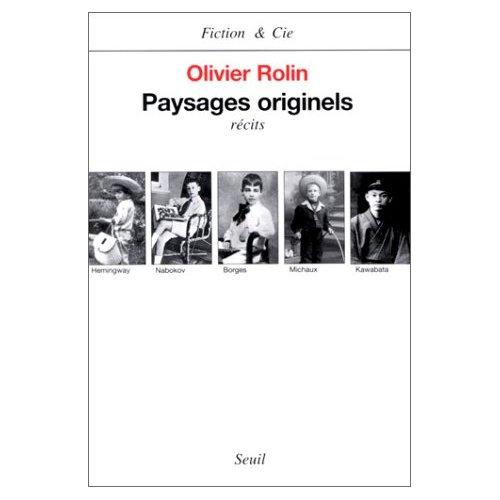
Ce livre m'a rappelé Trois auteurs de Pierre Michon. Sauf qu'ici ils sont cinq à passer entre les mains d'Olivier Rolin : Hemingway, Nabokov, Borges, Kawabata et Michaux.
C'est encore un voyage à travers les textes, les lieux – dont l'auteur ne retient parfois qu'un infime détail – de ces illustres hommes de lettres. On retrouve donc ici clairement la notion d'origine, ce qui semble l'avoir conduit sur le chemin de l'écrit. Voici ce je retiens de cet hommage à ses pairs. Cela se passe, je crois, de tout commentaire superflu.
Ce qui compte dans l’écriture, c’est la précision, la tyrannie du langage.
ce qui distingue l’écriture d’un écrivain de celles des « petits hommes qui aiment écrire », pour reprendre un sarcasme de Michaux, c’est la multiplicité des thèmes qui s’entrecroisent, des nœuds que chaque phrase serre. C’est la densité des bifurcations dans le labyrinthe de l’écrit. C’est pourquoi écrire, et lire, sont des activités qui font, selon le mot de Francis Ponge, « jouir la pensée » : plaisir, certes, mais plaisir intellectuel, il n’est pas vain de la rappeler.
Rien ne montre avec plus d’éclat, me semble-t-il, que la littérature est une pensée, la plus vaste qui soit, puisqu’il lui arrive même d’être pensée de ce qu’elle ne prétend pas penser.
L’enfance, pour Kawabata, c’est aussi, et paradoxalement, l’expérience de la laideur et de la dégradation des corps : le sien, celui des autres. (…) Il y a peut-être aussi (pas seulement), dans cette histoire de vierges livrées à des vieillards (Les Belles endormies), comme un lointain écho du temps où sa jeunesse était prisonnière de la maladie et de la mort des autres.
Aucune œuvre, digne de ce nom ne se laisse enfermer dans un déterminisme de terroir.
Écrire, c’est ce mouvement qui nous porte à reconnaître ce que nous sommes en nous éloignant de ce qui nous fait trop uniment, c’est-à-dire trop faussement nous-mêmes. Michaux, encore : « Rien jamais définitivement circonscrit, ni susceptible de l’être (…). Rien de fixe. Rien qui soit propriété » La propriété, comme disait un autre, c’est le viol.
J'espère que vous apprécierez la compagnie d'Olivier Rolin
Durée : 1h20

