Avant de prendre, moi aussi, mes quartiers d'été, je vous propose de partir à la rencontre de deux auteurs dont je suis le travail avec beaucoup d'attention et d'admiration depuis des années. Nancy Huston et Olivier Rolin ont, chacun de leur côté cette année, sorti un livre qui, quoiqu'en disent certains de mes confrères, sont d'enthousiasmantes rencontres, ces deux derniers opus marquant, selon moi, une rupture dans leur œuvre. Une fois n'est pas coutume, honneur aux hommes.

Cette photographie, sur laquelle il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire techniquement, me semble assez bien témoigner de l'ambiance de l'interview que m'a accordée Olivier Rolin. Interview entrecoupée de coups de téléphone portable – vous n'en saurez rien en écoutant les propos de l'auteur, je les ai coupés à mon tour ! - sans que jamais cela ne vienne rompre le fil de la discussion avec ce « vagabond littéraire » qui est, je vous l'assure, bel et bien vivant.
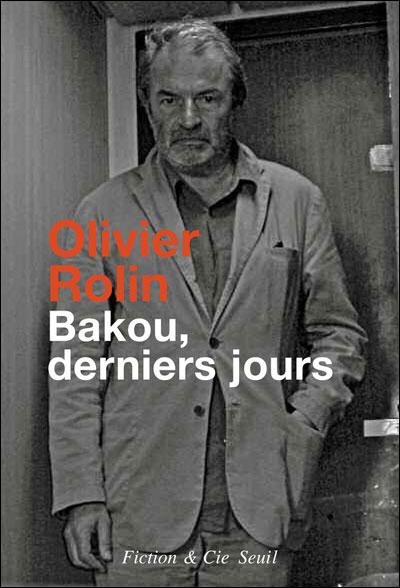
Contrairement à ce que pourrait signifier le titre en effet, la capitale azérie ne marque pas, heureusement, la fin du voyage terrestre pour Olivier Rolin. Il s'agit d'un clin d'œil à un livre précédent, Suites à l'hôtel Crystal – voir plus loin -, dans lequel l'auteur prétendait qu'il mourrait dans une chambre de l'Hôtel Abshéron en Azerbaïdjan. On peut donc voir ici une volonté de se jouer du destin final. Et tout cela, à l'occasion d'un voyage lointain. Tout cela m'évoque les mots d'Alphonse Allais : « Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup ».
Bakou, derniers jours se présente d'emblée comme un « récit ». Le substantif est à considérer dans sa globalité car on pourrait aisément, je crois, l'utiliser au pluriel. Chez Olivier Rolin déplacement géographique et voyage intérieur cohabitent savamment. Ceux qui s'attendraient donc à un guide touristique peuvent donc passer leur chemin. Ici, la déambulation ne donne pas matière à un déballage d'émotions convenues. Non, je crois qu'il faut plutôt l'entrevoir comme un élan bien plus vital. Peut-être comme le poumon même de l'écriture :
Ce sont des réflexions qu'on se fait quand on marche – comme sans y penser, ou plutôt au gré de ce soliloque intérieur que se tiennent les marcheurs, et qui est à la pensée ce que le grommellement est à la parole éloquente.
Ce qui me frappe toujours chez Olivier Rolin c'est que cette rencontre avec l'autre est toujours le prétexte à un questionnement sur soi qui n'est jamais, paradoxalement, égocentrique. Car l'auteur voyage armé de doutes.
Le voyageur loin de chez lui est comme un dé qu'on a lancé, pendant un bref moment il tourne sur lui-même, hésite, vacille, puis il trouve un équilibre et n'en bouge plus.
Si le titre évoque donc la mort et, par conséquent, un changement d'état je pense que ce n'est pas pour rien. Comme je l'ai dit plus haut, Bakou marque à mes yeux une rupture en tant qu'il est le prétexte à un regard rétrospectif encore plus en profondeur sur des convictions passées...
j'ai cru à d'autres farces sinistres
... sur un moi dont l'identité semble avoir, lui aussi, sans cesse voyagé :
j'étais amoché mais assez fécond à l'époque (à propos de Port-Soudan)
Plus loin :
L'invention du monde est mon livre le plus ambitieux.
De cette « terre de feu » qu'est l'Azerbaïdjan Olivier Rolin se joue aussi des frontières temporelles. On finit par oublier que le poète Essénine – à force de lui redonner vie - est mort depuis longtemps. Que le peintre Tahir Salakhov surnommé « l'apparatchik de la palette », lui, est toujours là. Mais ne croyez surtout pas que tout cela s'apparente à du name dropping. Si l'auteur rend hommage à des hommes de lettres et de toiles peu connus du grand public – vous allez me dire que ce n'est pas une référence -, il le fait aussi, je crois, pour signifier qu'ailleurs aussi, dans ce monde du bout du monde on écrit, on peint. J'y vois un hommage à des cultures trop souvent ignorées par ce que l'on nomme à tort la pensée dominante. Les chemins littéraires qui mènent Olivier Rolin vers ces poètes, ces peintres, sont donc aussi en soi un voyage.
Le livre est aussi une très belle invitation au rire. L'auteur sait se moquer de lui-même, de sa manie à trouver des ressemblances, de cette absence de vigilance qui le conduit à accepter de passer une soirée chez monsieur l'ambassadeur. Le contraste avec ces hommes de salon est éclatant. Pourtant, jamais l'auteur ne signifie qu'il est dans le vrai. Que lui seul aurait compris. Ses livres, d'une manière générale, sont marqués par une constante interrogation sur soi. Le doute, en ce sens, est l'autre moteur de son écriture. Ce que laisse supposer ces phrases :
Le cercle est ma figure
je suis seul dans une nacelle de la roue de Ferris, comme le narrateur à la fin de Méroé
Et la fin de Bakou justement ? Elle est bien moins cocasse. Le livre s'achève sur la mort, cette fois bien réelle, de deux amis d'Olivier Rolin. La boucle est donc bouclée si l'on peut dire. Le « monologue à voix basse » s'achève ainsi. Le voyage est terminé. Le vagabondage prend fin pour cette fois. Mais le lecteur devine qu'il ne s'agit-là que d'une étape intermédiaire. L'auteur ne se trahit-il pas lorsqu'il dit :
Il y a une disposition à l'exil à l'origine de l'écriture
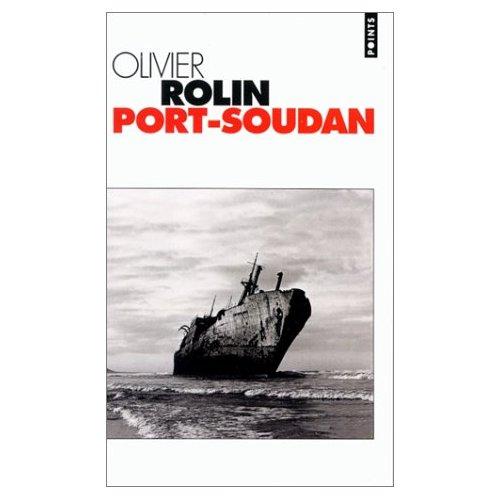
Si Bakou s'achevait sur les décès de proches d'Olivier Rolin, Port-Soudan s'ouvre sur la mort de A. Cet écrivain était l'ami du narrateur dont on apprend qu'il est ancien consul honoraire de la république malgache. Commence alors le roman sur une amitié perdue, prélude à un autre voyage dans le temps. Celui de la jeunesse, des croyances d'alors.
Lorsque j'avais quitté la France, il y avait une vingtaine d'années, il n'existait pas d' « opinion », on avait des jugements à l'emporte-pièce, souvent, mais c'étaient, il me semble des actes qui engageaient l'esprit, et souvent le corps avec. On se référait, pour vouloir ceci et rejeter cela, à une philosophie, à défaut à une tradition, qui en était comme la figure érodée. On ne baignait pas dans l'espèce de placenta majoritaire que je voyais nourrir une multitude folle, une immense gélatine de fœtus intellectuels. On tirait une fierté d'être minoritaires, de marcher derrière les drapeaux des grands réprouvés. La solitude n'était pas une honte. Des mots comme audace ou courage nous paraissaient beaux, nous faisions nôtre, témérairement, la devise selon laquelle il n'était pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Cela ne nous gardait pas toujours du ridicule, mais nous épargnait au moins le conformisme.
Le narrateur et l'ami perdu peuvent être considérés – l'auteur nous y invite en tout cas - comme un seul et même homme. Un homme frappé d'intranquillité. Ce regard porté sur soi est intéressant car jamais je n'ai senti une réflexion globalisante sur une génération. Celle du gauchisme, de ses combats. J'ai plutôt lu le « nous » comme la seule association du narrateur et de A. dont la disparition laisse place à un désert.
Et s'il n'est pas de plus haut bonheur que dans la coïncidence d'un amour et d'une grande espérance humaine, il n'est probablement de pire malheur que lorsque l'abandon vient tout vous ôter, de ce qui l'instant d'avant était encore le plus charnellement proche de vous, jusqu'aux vastes horizons que la pensée croyait embrasser.
Cette réflexion sur le temps qui passe prend à témoin le lecteur de ce livre. Pas pour lui dire que c’était mieux avant. Non. Il s’agit davantage, tel que je le comprends en tout cas, de lui signifier une certaine angoisse face à différentes évolutions de société à laquelle n’échappe pas la littérature.
La littérature, j'ai déjà dit que, tout en la fréquentant assidûment, je ne prétendais pas savoir ce sur c'était : au moins étais-je assuré que ce n'était pas le petit commerce dont ces gens-là vivotaient.
Tout s’éclaircit plus loin. L’accusé est progressivement dévoilé …
technique de l'éphémère qui était devenue la pensée majeure de l'époque
… jusqu’à devenir clairement identifié :
ce qui était honoré, en revanche, et prodigieusement, c'était l'argent
Olivier Rolin interroge donc la notion de relations troubles à l’argent, à l’éphémère, au factice. A tout ce qui, finalement, peut ternir celles qu’entretiennent les Hommes, y compris ici entre A. et sa compagne.
Il y a des passages très émouvants sur la trahison, sur le renoncement à ses idéaux.
La mort ne laisse pas aussi brisé que l'abandon.
Il me semble que ce livre, écrit en 1994, est anticipateur. L’auteur voit les ravages que va opérer une hyper technicité sur nos comportements. Notamment quand il est question d’écrit. S’agit-il aussi, dans les mots qui suivent, d’une interrogation sur sa – peut-être - disparition programmée - et dont parlera Olivier Rolin dans l’interview qu’il m’a accordée - ? Je le crois.
Donner à son amour mort, mais non enseveli, une sépulture de mots.
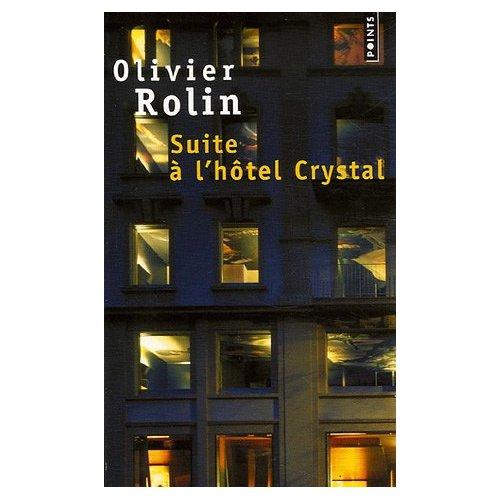
Je vous parlais plus haut de ce livre qui annonce Bakou, derniers jours. Suites à l’hôtel Crystal est une galerie de portraits souvent hilarants sur des anonymes ou des personnalités connues insérées dans un récit parfois loufoque. Ainsi « croisons »-nous Allan Greenspan, ancien président de la Réserve Fédérale américaine ou encore Jean-Claude Trichet, qui, lors de la sortie du livre, était encore le patron du FMI.
Mais il y a aussi des personnages bien moins gradés. Défilent donc une femme avec qui couche le narrateur, un philosophe qui lui a « révélé le marxisme scientifique » ou encore un ancien aviateur chargé de larguer totu un tas de bondieuseries. Chaque tableau commence après que le narrateur a poussé la porte de sa chambre d’hôtel dont il nous offre une description sommaire. Il y a ici une référence à Perec et au livre qu’il a toujours voulu écrire (cité dans Espèce d’espaces).
Si Bakou est un récit, Suites à l’hôtel Crystal est incontestablement un roman. Un roman qui me fait penser à cette scène mythique d’Alphaville de Jean-Luc Godard. Vous savez, ces ouvertures de portes dans un immense couloir qui semble infini. Un roman parce que tout cela sort de la tête de l’auteur. On se prend à imaginer que ces portraits pourraient être des masques que voudrait porter le narrateur (l’auteur ?). Le sociologue Jean-Didier Urbain ne parlait-il pas des masques que l’on met en voyage pour travestir sa véritable identité ?
C’est d’ailleurs dans ce livre qu’Olivier Rolin joue le plus au jeu des ressemblances. Cette fois, c’est lui-même qui est au centre de cette démarche ludique.
ma gueule de morse
Plus loin, il évoque une ressemblance avec Daladier.
Tant que ce n’est pas avec Eugène Pertuiset.
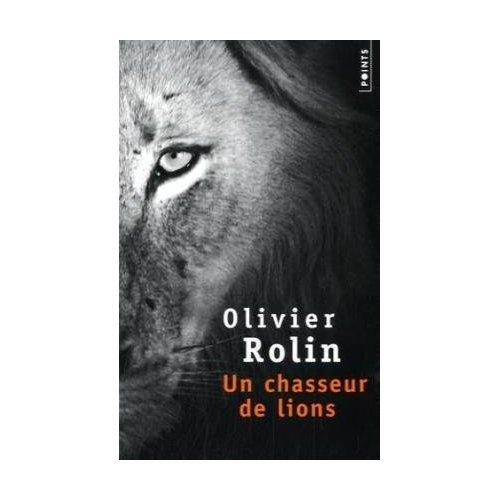
Eugène Pertuiset est un chasseur de lions qui figure sur une toile de Manet. Le narrateur est tombé dessus à Rio alors qu’il était parti pour voir une exposition consacrée à Degas. Signalons d’emblée que le tableau existe, contrairement aux Onze de Pierre Michon.
C’est la confrontation avec ce portrait qui est à l’origine d’une véritable entreprise de sape. On se souvient, grâce à Éric Chevillard, qu’on pouvait démolir Nisard en toute quiétude. Voilà donc qu'un autre écrivain assassine ce pauvre tueur de lions, titre que Pertuiset a hérité d'un spahi.
Mais qu'est-ce ce qui provoque donc chez Olivier Rolin une telle montée de température ? Au début, c'est difficile à déterminer. Le chasseur échafaude sans cesse des plans qui ne marchent jamais, ce qui le rend éminemment sympathique. D'autant qu'il y a chez lui quelque chose de Mr Bean :
il prend le cri des chouettes pour les appels d'une bande d'Arabes
Page après page, le ridicule de Pertuiset s'estompe pour laisser place à sa petitesse. Il veut faire partie du bruit du monde, être sur le devant de la scène même si, pour cela, il faut passer par le risible. Chez ce chasseur, le ridicule ne tue pas. Et heureusement : sinon il serait souvent mort.
tout ce qui pète, fuse, fulmine, est son domaine
Il veut donc occuper le devant de la scène. Si cela est tellement important pour lui, c'est qu'il en va de la prospérité de ses affaires. Car l'homme est avant tout fabriquant d'armes. Il est même l'inventeur de la balle explosible. On suit donc ce personnage essayer de tout faire pour rencontrer les grands de ce monde et écouler sa production.
Il est stupéfiant de constater que ce genre d'individu, sans foi ni loi sinon les siennes, continue de traverser les époques. Lire les descriptions qu'en fait Olivier Rolin c'est reconnaître certains hommes d'affaires qui aujourd'hui encore semblent jouir rien qu'à l'idée de rencontrer un jour les locataires du Palais de l'Élysée. Ces businessmen se prostituent. Même si c'est pour un petit os.
On suit donc les aventures de ce monsieur mais de façon parcellaire. Et quand l'auteur ne sait pas, il le dit :
après, que se passe-t-il ? On ne sait pas. Le roman ne sait pas, ne peut pas tout.
J'ai beaucoup aimé les quelques entrées en scène de l'auteur à un moment précis – ce qui m'a fait penser à certaines saillies de Jean Echenoz - : quand il se fait embobiner à Lima par une certaine Géraldine – une femme répondant au doux surnom de scène de Clochette de Miraflorès - :
il a gobé ça le gros mérou.
Il y a, comme dans Port-Soudan je trouve, une certaine forme de tristesse. Tristesse liée au fait de constater que la veulerie étend progressivement ses filets et contamine des pans entiers de la société. Et que l'art est un lieu et un moyen de résister parce qu'il éclaire les consciences.
La peinture dit ce qui s'en va. Les livres aussi.
Chez Olivier Rolin, les formes d'écriture sont un moyen de lutter contre l'imbécilité triomphante. Elles seules permettent de considérer le monde autrement que par le prisme d'individus comme Pertuiset. C'est une démarche condamnée à terme mais la minorité n'a-t-elle pas un devoir éternel, celui de proclamer la vérité (Robespierre).
Le lieu convient mieux à un adultère bourgeois qu'au prologue d'une épopée, c'est l'époque qui veut ça.
Voilà donc « notre » Pertuiset et sa troupe bouffonne avancer comme un seul homme. On a l'impression de ne pas pouvoir contenir le mouvement. Pas étonnant puisque le danger n'apparaît pas tout de suite :
Avec toute sa connerie, il n'est pas féroce.
Mais c'est peut-être là que Perthuiset est le plus retors, le plus fourbe. Pendant ce temps, il instille le poison chez ses contemporains et prépare le terrain à l'arrivée d'éventuels héritiers :
Peut-être ne meurt-il pas, jamais ? La lourdeur est éternelle.
On ne saurait écrire épigramme plus définitif, non ?

