J’ai une vieille affection pour Jean Anouilh, car j’avais tenu il y a quelques années de cela le rôle du garde dans « Antigone ». La force du texte et l’humour sous-jacent qui conduit pourtant à la tragédie m’avaient marqué. Quelques mois plus tard, j’avais vu au théâtre d’Avignon « Becket ou l’Honneur de Dieu », et Anouilh pour moi s’est longtemps limité à ces deux pièces, sans doute les plus poignantes et les plus emblématiques de son écriture.
Je referme ce soir le « Ornifle » de Anouilh, la dixième pièce de lui que je lis. Dixième, alors que j’apprends par internet qu’Anouilh est né il y a tout juste un siècle, en 1910 et qu’il est mort l’année de ma naissance. Mais rien n’égale jusqu’à présent ni « Antigone », ni « Becket »…
Je me souviens de la représentation à Avignon. Deux moments en particulier ; une discussion entre le roi Henri II et Thomas Becket sur la bute, et le roi demandant à Becket s’il n’a pas froid, et ce dernier qui jusqu’alors ne s’en était jamais plaint, avoue d’une voix empreinte de nostalgie qu’il a lui aussi froid, aveux de la fin d’une amitié, et d’une guerre ouverte entre l’archevêque et la couronne ; et puis il y avait cette scène d’ouverture en flash-forward, le roi drapé s’avançant au centre de la scène et tombant soudain à genoux, torse nu, implorant Becket mort…
« Extinction de la salle, murmures, silence. Sur la scène, un décor vague avec des piliers. Le tombeau de Becket est au centre, proposé par un cercle de lumière. Le roi entre par le fond, nu sous un vaste manteau. Il a sa couronne sur la tête. Il hésite un peu devant la tombe puis, soudain, enlève son manteau et tombe à genoux. Il prie, seul, au milieu de la scène. »
Ce sont ces mots-là qui m’ont frappé, à la lecture de « Cher amour » de Bernard Giraudeau. Lorsque j’ai soudain réalisé que celui-ci ne s’est pas contenté d’être un acteur à l’écran que j’avais apprécié le temps d’un téléfilm, mais également ce personnage sur scène qui m’avait confirmé la beauté des textes d’Anouilh, accompagné de Didier Sandre pour lui donner la réplique dans le rôle de Becket.
Voilà, le constat est étrange : Bernard Giraudeau n’a pas été simplement un être désincarné – ou plutôt réincarné – à l’écran ou l’auteur caché derrière ses lignes. L’espace d’un soir, il y a dix ans, il avait été entier, dans le rôle d’un autre, ou plutôt dans son seul véritable rôle, celui de comédien…
Et me voilà aujourd’hui, à remonter le fil du temps, à renouer avec des scènes oubliées de ma vie et à rencontrer à retardement le jeu de Giraudeau.
Par le théâtre donc, mais également par le cinéma, le temps de visionner « Le ruffian » dans lequel il donne la réplique à Lino Ventura dans un film sans prétention, classique, où les deux hommes martèlent leurs charismes respectifs à chaque scène, élevant un peu plus une histoire efficace mais banale, typique des années 70-80 et des rôles de Ventura, Belmondo ou Delon à l’époque…
Et puis il y a ce « Cher amour », refermé hier.
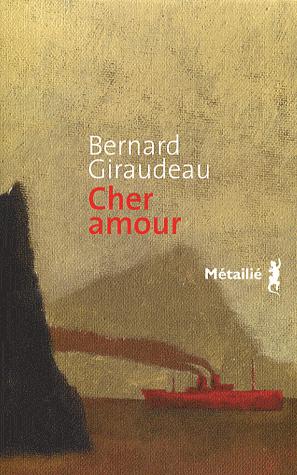
Parfois inégales mais presque toujours fascinantes, les pages de Giraudeau se tournent pour suivre le périple de l’homme, naviguant entre fiction et réalité, entre les déplacements du corps et les errances de l’esprit. La découverte est toujours au rendez-vous, teintée d’exotisme, de romantisme ou d’humanisme, un voyage qu’on ne regrette pas une seule ligne, à se laisser bercer par le rythme des vagues ou les crachotements d’un moteur.
Le jeu d’acteur, l’exotisme, la mer. Et puis il y a les femmes. Et toujours, toujours le voyage comme mot d’ordre, voyage des corps, voyage de l’esprit, voyages réels et voyages imaginaires. Le dépaysement est assuré.
Il y a un mouvement léthargique chez Giraudeau, une dérive laconique. « Cher amour », c’est avant tout une contemplation douce-amère. Et elle ne laisse pas indifférent.
