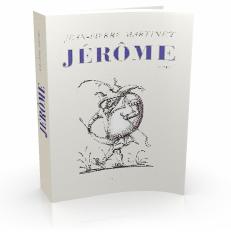 Encore un livre impossible, incroyable, incommensurable, noir. J’ai découvert ce texte par hasard avec trente ans de retard puisqu’il a été publié la première fois en 1978, mais je l’ai découvert. Croyez moi, ce n’est pas une mince affaire que de vous en parler tant il est difficile de pouvoir traduire en mots ce que j’ai vécu tout au long de sa précieuse lecture. L’histoire est en elle même tout un poème, voire une promenade au milieu des tableaux de Jérôme Bosch.
Encore un livre impossible, incroyable, incommensurable, noir. J’ai découvert ce texte par hasard avec trente ans de retard puisqu’il a été publié la première fois en 1978, mais je l’ai découvert. Croyez moi, ce n’est pas une mince affaire que de vous en parler tant il est difficile de pouvoir traduire en mots ce que j’ai vécu tout au long de sa précieuse lecture. L’histoire est en elle même tout un poème, voire une promenade au milieu des tableaux de Jérôme Bosch.
Jérôme Bauche, puisque c’est le nom, est un enfant assez volumineux de quarante ans et de cent cinquante kilos. Il vit seul avec sa mère et aurait un retard mental pour certains, pour d’autres, serait resté un grand enfant, quand ce n’est pas pour d’autres personnages, un faux attardé. Quelque soit le point de vue, toujours est-il que rester plus ou moins cloitré dans son appartement aussi longtemps n’est pas une mince affaire, et donc, il doit bien y avoir un peu de tout cela. Nous allons alors suivre, ou plus exactement accompagner, Jérôme dans sa quête de son Éloïse (avant qu’Abélard ne l’ai conquise). Cette Éloïse s’appelle Paulina Semilionova et Jérôme en est fou, au sens propre du terme, amoureux. Cette quête ne durera pas longtemps, juste deux jours, mais que les journées peuvent être denses quand Jean-Pierre Martinet nous les décrit. Voilà pour l’histoire, mais vous vous doutez bien que tout ce livre va au-delà, par dessus, en dessous de cette pale présentation.
Jérôme est le roman d’une éprouvante, épouvantable, épaisse, conversation avec soi-lui-même ; conversation dont les contours, les limites entre l’intérieur et l’extérieur sont flous, vaguants. Cette porosité propre à chaque humain, porosité qui est le lieu du passage, des échanges de vie et de mort, se trouve augmenté en surface par son corps énorme, et diminué en qualité par la couche de graisse tout autant protectrice que frein naturel à ces échanges. Il y a de la misère, de la noirceur, des cadavres, des viols, mais ce qui est tout bonnement impressionnant, c’est que c’est toujours effleuré, décrit avec grâce, légèreté. Les mots sont choisis, les phrases aériennes, nous plaçant toujours en recul des situations, distance de la folie propre à Jérôme qui vit entre réalité partageable et délire singulier.
A la fin, le diagnostic est impossible. Effectivement, des actes répréhensibles par la loi ont été commis, mais pour autant, Jérôme relève-t-il du pathologique ? Si les critères sont le niveau de souffrance et le niveau de partageabilité, alors oui, il y a de la pathologie. Mais comme nous pouvons partager avec lui - et c’est la magie de Jean-Pierre Martinet que de rester majestueux dans son écriture - alors, non Jérôme n’est pas fou. Il est juste vivant contrairement aux personnes qu’il croise tout au long de son odyssée. Il est plein d’une vie débordante d’attention à l’autre, de désir de relation, d’échange, d’amour. Il erre parmi des fantômes qui ne sont que le décor de la vie, de la ville, décor accessoire de cette errance obsessionnelle.
Au fur et à mesure de cette lecture, des noms d’auteurs, de personnages me sont apparu : Georges Bataille, Pierre Guyotat, Mikhaïl Boulgakov, Héloïse et Abélard, Antonin Artaud, Louis Calaferte et pourquoi pas, le Woyzeck de Georg Büchner. Un style d’écriture impressionnant, riche, puissant, fourni.
Extrait de Jérôme :
« Pas un seul un seul regard : poursuivant leurs affaires s’obstinant se contorsionnant agitant des idées savourant leur médiocrité douillette et à la fin revenant à leur point de départ et le piétinant avec rage. Un rendez-vous des affaires urgentes un film à voir une femme à caresser des enfants à promener des vitrines des morts à veiller des fleurs à cueillir dans les jardins un peu de ciel à regarder avec sa couleur ses nuages ses musiciens dans les kiosques. Vite vite : car le pou car le pou. Les plus pressés enjambaient dédaigneusement le cadavre de la petite Lisa, de la cervelle aux testicules ils ne pensaient qu’au pou, mais ils faisaient semblant de ne pas y songer. Car le pou. Personne n’avait une pensée pour le doigt coupé, pour les chaussettes blanches, les aisselles dorées, les cheveux bleus d’innocence de terre nocturne de foutre. Pour la molaire solitaire avec son plombage de métal, un plombage de pauvre. Cela aussi, disparu. Dévoré par le pou. Sa petite bouche vorace. Ne perd pas un morceau. Peut-être qu’un jour, ce sera au tour de Polly d’être dévorée. Oui mais. Se défendra ? Ce n’est pas si sûr. Alors, gonflé de sang, s’endormira ? Peut-être. N’empêche, j’avais bien du mal à me relever. Solange aurait dû cesser de me torturer avec son pou, car moi, maintenant. Les jambes lourdes la tête lourde et ces cent cinquante kilos de chair morte à traîner. »
